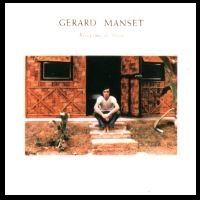
BOUCHE D’OMBRE :
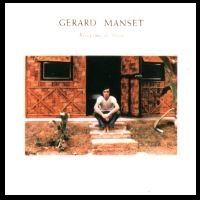
« Ce qui te
fait fuir, c’est le monde et les hommes ». Que reste-t-il
alors à Gérard
Manset – cette étoile mystérieuse du rock français -, sinon l’ombre des
studios
et les machines pour seules amies ?
Chronique parue
dans Rock’n’Folk (1979) par Bruno T.
Gérard Manset
est un grand bonhomme de trente ans au cheveu noir et au profil
trouble.
Habitué des masques, enveloppé de silence et de mystères, poète
difficile et strict
au code très secret, aux thèmes sibyllins et à l'expression rarissime,
il ne se
laisse appréhender que comme MYTHE naissant. Manset, l'homme sans
visage.
Manset l'obscur.
Manset — légende.
Dix
ans déjà.
Début d'un cycle en grenade. Il est né des vapeurs
urbaines de 1968. Premier disque
: «Animal On Est Mal». Le Sphinx compte ses
écailles, Ses décoctions de sons
sataniques, les paroles obscures et les thèmes si singuliers de
ses compositions
pleines d'écorchures, de malaise et d'abstractions scalpel,
d'emblée le placent
« à part ». Il y est resté. Superbement
énigmatique. Avec son second disque, «
La Mort d'Orion», ambitieux opéra électrique au ton
d'épopée cosmique, qui a
été salué par la critique comme «un
prodigieux événement musical». Gianni
Esposito — autre bizarre du temps » qui avait donné
sa voix à ce disque
funèbre, est mort après. L'album, noyé dans un
mysticisme provocant, empli
d'une sorte de «sacré» anachronique,
théâtral et démesuré (qui aurait pu
être
composé par Malraux), mise en scène étonnante d'un
vertigineux malaise en
musique, cet album noir d'anticipation a fait date. Le suivant —
« Manset » »
tout en longs monologues ininterrompus, à peine troués de
cris de guitares
épisodiques, au ton plus simple et plus intime à la fois
(« S'il chante/C'est
qu'il est deux/C'est qu'il est heureux/Dans son monde à
lui »), creuse la
première rupture. C'était une manière de
«Malone Meurt» gravée sur cire.
L'ampleur se
déplaçait, s'enfonçait. Gérard était « Jeanne la Folle»
marchant au feu,
Pas tout à fait Dieu au calvaire, mais presque. Une étape. Le thème de
l'animal-homme
était repris (« L'oiseau de paradis/Chante toute la nuit ») et le thème
de la route,
avec «Long, Long Chemin » (« Où que tu ailles/Il y aura du lait, de la
paille »), était nettement tracé. Vint le
«Voyage en Solitaire».
Le mythe se ciselait. Manset se sculptait avec science. Recto: un quai
de gare
(Montparnasse) et un homme (étrange) vu de dos. Manteau de cuir noir.
Verso:
une sorte de Portrait de l'artiste en Grégoire Samsa. (Manset, qu'on
croirait «
transformé en une véritable vermine», se cache dans un coin de pièce,
Il est
indéchiffrable, sombre, barbu et chevelu.) Le personnage se stylisait
fortement. Et l'inspiration éclatait. Ce nouveau disque de nuit
ressemblait à
un disque d'Aurore. Sonorités jazz et allégresse d'un enterrement à
New-Orleans, La maîtrise technique proprement ahurissante de cet album
et ses
instants de joie communicative le firent remarquer du grand public.
Deux
tubes de
l'été : «Un Homme de Paille» (« Un
homme exilé/Est rie/Sous la mitraille/Comment
voulez-vous que sa chemise lui aille ?») sur refrain
clarinette. Et « Il
Voyage en Solitaire » dont le son fêlé —un
piano plaintif et comme désaccordé —s'inscrivit
bizarrement sur la première ligne des hit-parades
périphériques. Quand les
veaux se mettent à avoir des papilles d'esthètes !...
Mais il y a maldonne. Manset
semble s'être fourvoyé. Un cinquième disque —
«Je N'ai Rien à Raconter », ou,
plus précisément, « Manset-Manset»»
— a suivi, qui remettait nettement les choses
en place. En anéantissent soigneusement le bel espoir qu'avaient
pu nourrir les
industriels du disque de Variété de voir Gérard
Manset rentrer dans l'ordre.
Gérard, une nouvelle fois, décapitait Manset («
Rouge-gorge/Ouvre ta gorge/Rouge/Gorge
»). L'homme lacérait son image. Le son était
brisé, lui aussi. Multiplié. Brise
de samba pour «Rouge-Gorge », rock électrique
violent pour « Cheval-Chevaux»,
accompagnement acoustique rudimentaire pour «La Liberté
». Le disque fit un
demi-tube: «Rien à Raconter». Ce qui était
déjà une performance, vu le
caractère paradoxal – pour ne pas dire cynique — du
texte (« Le Figaro
l’Humanité/Voyez la personne à
côté !»). Un vaste pan de silence
s'ensuivit. (Presque aussi long que celui qui avait
séparé «Long, Long Chemin»
(1972) de « Il Voyage en Solitaire» (1975).) Un hiatus que
« 2870 », nouveau
«chiffre» ésotérique de la lice
sacrée, vint coder.
Plus de visage,
même. La pochette — réalisée par Hypgnosis — constituait une épure de
sens. Et
représentait une ombre de présence — indistincte — derrière la grille
d'un masque
d'escrimeur. Le disque fut très fraîchement accueilli par la critique -
«
Rock'n'Folk » en particulier. On le jugeait «pas assez génial», c'était
un «
malentendu » de plus. « Le Pont», sur ce disque de transition, compte
parmi les
moments les plus impressionnants de Manset. Et le disque, bâti entier
comme une
manière de transcription électronique — impossible mais hallucinante —
du
vertige, est essentiel. Sa violence, ses paroxysmes, ses invectives, en
sens
comme en sons, en faisaient un pivot idéal entre « Rien à Raconter» et
le septième
L.P. « Parle-moi de Ton Ame Heureuse », sur « 2870 », entrouvrait « Le
Royaume
de Siam ». Dix ans déjà... Fin d'un cycle. La mangue après la grenade.
Il se voit
volatile. Avec insistance. Tantôt «oiseau de paradis», tantôt «
rouge-gorge à
la gorge ouverte et rouge», et tantôt « oiseau sans tête». Point commun
avec
cet animal: NE PAS PARLER. Et s'exprimer, malgré tout, en CHANTANT.
Pourquoi?
Pour rien.
Il
est
réellement tourmenté, et vraiment dédoublé
(« Y'a que mon .ombre qui me suit/Mais
quand il faut descendre au fond du tunnel/Quelqu'un tient la lampe
droit devant
elle »). Il est aussi Beckett — homme de RIEN —
« Ça va finir. Ça va peut-être finir,
» Et Gaspard Hauser l’exilé de nulle part —
« Suis-je venu trop tôt ou trop
tard ?». Beckett conduit à Keaton. Chez Gérard
Manset, le rire est à peu
près mort. Les rares apparitions de l'humour ne sont jamais que
des formes
subtiles du Tragique (« Je me suis pris la gorge/Et j'ai
serré/J'ai serré/J’essaierai/d’être
meilleur ou pire/A l’avenir
»). Pas
vraiment de quoi rire dans ces jeux de mots qui ressemblent à des maux
de tête.
Alors? Alors, le problème de Manset, comme de beaucoup de ses
contemporains,
est de trouver —d'urgence! — un Sens à Etre. Et, entre autres, à
travers ses
chansons. Comment aller droit ? « On marche de travers/Comme un
crabe/Et la
mer/Descend, » Manset ne se juge sûrement pas poète. Encore moins
musicien.
Nostalgie mêlée
d'amertume. On le sent obsédé par certaines scènes imaginaires — ou
très
réelles? — de rupture (« Un Homme Une Femme »), de départ, d'abandon («
Le Jour
Où tu Voudras Partir»), de solitude.
Mais, comme
l'Ami, elle est sans doute morte à ses yeux; absente. Devenue prétexte,
thème
sur quoi faire grincer la solitude idéale: « Quand on est/Malheureux/
On se
tait/On parle peu ». Il est dramatique. Et pourtant, il dit les choses
sans
drame: « Un jour/Lamour/l/a quitté/S'en est allé/Faire un tour/De
l'autre côté/D'une
ville ou y'avait pas de place pour se garer». Il parle des enfants de
même. De façon
symbolique, stylisée à l'extrême.
Reste ? Presque
rien. Le vrai tracas. Il y a des couloirs interminables, des escaliers,
des
portes, des ponts, des degrés, des grilles, des vides, des tunnels, des
rivières qui y conduisent. Des peuples d'Orion qui y volent ou qui y
marchent.
Mais ce Rien reste toujours à redire, à identifier, à analyser.
Le mot «VIDE» se
retrouve absolument partout chez Manset. Cela est morbide, si l'on
Veut. Mais
le «Journal» de Kafka, ou son « Terrier», sont pleins de la même
morbidité, et
pourtant il se trouve des gens pour trouver du plaisir à s'y plonger,
comme à
entrer dans « L'histoire
d'une de Mes
Folies » de Rimbaud. Manset est —aussi — prodigieusement «intéressant»
parce
qu'il est tourmenté, et que sa tourmente, dans sa particularité même,
porte celle
de toute une société.
Mais techniquement,
c'est aussi impeccable. Il faut sans doute chercher d'abord là, et
ensuite
seulement dans la Légende qui entoure son nom, le sens de cette sorte
de «
culte » étrange, discret et obstiné, dont
A moins qu'il ne
s'enfuie un jour en Afrique. Pour jouer face au soleil avec la forêt
derrière.
Gérard Manset a peur du jour. Et il a raison. Pour plus de sûreté, il
se passe
de tout le monde. Et invente ses clavecins, ses trombones, ses
percussions. ses
clarinettes, ses pianos, ses cors, ses accordéons, ses banjos, ses
saxophones
et ses chœurs tout seul. Il faut aussi sa voix et ses souffles, ses
silences.
Ses photos, ses textes, ses arrangements, ses orchestrations. Tout son
opéra
fabuleux. En local clos. On pense à Brian Jones et à ses flûtes
enchantées.
Manset passe le temps, et il y passe sa vie. « Qu'il est loin le temps
devant
nous/Un jour ou l'autre il est pourtant au rendez-vous. » Quand son
album-masque
« 2870 » est sorti, noir, la légende voulait que Gérard Manset
eût besoin d'une
main pour le guider dans la foule. Entre deux séances nocturnes de
studio. Dehors,
il fait nuit. Il cache ses yeux sous des verres de ténèbres. Il n'est
en paix qu'en
lui. Est-il seulement en lui? Il s'enfouit dans un cocon d'ondes et
d'ombres.
Il va jusqu'à sa limousine. La légende funeste raconte que la vie lui
fait peur
(« Ce qui te fait fuir/C’est le monde et les hommes i»). Et la mort
aussi
l'épouvante (« Attends/Que le temps/Te brise/Comme un œuf»). L'ère de
la
machine-écran. Gérard Manset entre dans sa berline aux vitres
offusquées comme
on entre dans la légende. Nous sommes en 19?... « Y'a une route/Tu la
prends
qu'est-ce que ça coûte ? » C'est peut-être la dernière bande.
Ça tourne.
Comment fait-il dans ton âme. Gérard !