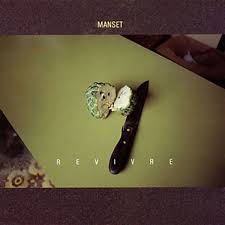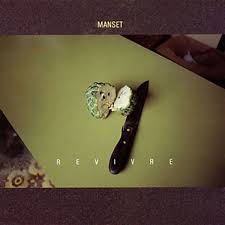RECOMMENCER MANSET
Chronique
et interview parue dans Libération le 8/4/1991 par BAYON
Entre Rimbaud et Dire Straits, Lévi-Strauss et Fitzcarraldo, le dernier
Manset funeste et lent comme une descente de
l ’Orénoque ou une mort du père, est avancé. Son commentaire
rituel.
Introduction
: Disque d’or avec Matrice, n° 3 du « spécial 45 tours 1950-1990 » de
l’Obs., derrière Dutronc et Brel, auto-mausolisé en coffret-CD
préraphaélite il y a quelques semaines, on aurait pu espérer Manset
calme pour un moment. Mi- Sting (pour l’écosystème),
mi-Morrissey
revu Mark Knopfler (pour les grands airs et le cinéma), rien moins
qu’attendu, il remet ça. Pfff. Voire... La majesté plus noire que
jamais, suintant le morne par tous les sillons de son corps harassé, à
renvoyer Melancholia de Dürer au rang des accessoires farces, en deux
temps sept mouvements, ce Lancelot du Lagon nous laisse défaits.
Refaits par Revivre.
La composition. Sous pochette évoquant soit
l’envoutement vaudou, soit un livre de recettes de cuisine (exotiques),
sans intérêt autre que celui de placer l’aventure sous les auspices
manifestes du vert forêt vierge, ce volume XIII de Manset, CD de
trente-sept minutes et sept chansons à la tonalité monocorde et au
rythme medium, empreint de noblesse, s’ouvre, se développe et se ferme
amplement sur une question métaphysique.
La question: Tristes Tropiques
Alors
que des confidences extasiées récentes de l’artiste relatives aux
Mémoires d’Outre-tombe (1) pouvaient laisser augurer quelque variation
variétés sur le mode Natchez, l’ouverture Tristes Tropiques,
communication socio-écolo-sexuelle à l’académie binaire sur les
Indiens, est plutôt, deux fois paradoxalement, une manière de Lettres
Persanes inclusion Cortez The Killer de Neil Young; d’où, à peine
scolaire, ce registre passablement inédit dans la rhétorique Manset (ou
sinon inédit ancien: Animal, Orion…un quart de siècle) : la satire
(variante : « protest-song »).
Citons : « On nous parle
d’Indiens qui souffrent et se font rares /Ne sommes-nous pas nous-mêmes
des peuples opprimés? / Pas d’étui pénien pas de curare (…) ». Zadig,
Swift, Montesquieu donc - ou Leni Riefenstahl?
Mais le titre?
A
son éminent sujet, référencié certes et pertinent (1955; autobiographie
initiatique narrant la naissance de sa vocation anthropologique chez un
philosophe français, à travers sa première expédition -ou Mission?-,
chez les Nambikwara du Brésil), on se rappellera d’abord qu’autour de
sa précédente livraison, Matrice, ethnologie médiumnique de
Vaulx-en-Velin, (...les Minguettes-Sartrouville via Banlieue Nord rap
grégorien), l’auteur de Caesar, Maubert ou Route de Terre, un voyageur
comme on le sait, évoquait Mauss, disciple de Durkheim; voici la
prévisible séquence Lévi-Strauss, impeccable compromis impossible de la
rigueur scientifique (ethnologie), de la rigueur poétique (le « mot de
la tribu»), et de la rigueur dandy (le « blue-jean »
implicite,
bure moderne du pénitent-routard).
En passant, on se souviendra également à propos de cet autre
titre-livre: (les Secrets de) la Mer Rouge (1982).
On
évoquera aussi Et l’or de leurs corps, blason a la Femme à la fleur,
c’est-à-dire à son peintre exilé Paul Gauguin d’Ira Oa (« là où il
mourut »). On n’oubliera pas, enfin, que, depuis Rien à raconter, qui
donnait en 1976, dans la foulée du classique-best-seller 1975 Il voyage
en solitaire/Y’a une route, le signal de la débandade Ailleurs, l’homme
est résolument passé, d’Iles de la Sonde en Chambres d’Asie, « tropical
» -Potocki, Boas, Isabelle Eberhardt, Artaud... ou Antoine Muracciole
le caboteur?
Or donc, pour en finir avec ce préambule broussailleux,
que dit le texte de cette simili-thèse lyrique sur les Jivaros et
consorts Opi (« qui souffrent et se font rares»)? Ceci: « Ne
sommes-nous pas nous-mêmes Indiens des plus rares ?/ Pour nous sauver,
peut-être, il n’est pas trop tard… » La question posée est celle du
Salut
Des réponses. A cette interrogation « essentielle » vont
dès lors se colleter tour à tour, en attendant le verdict final, les
cinq plages intermédiaires qui suivent. Sur le mode général de
l’ «approche
de donnée » philosophique et dans deux directions, dynamiquement et
géographiquement divergentes: l’immobilité (ici, contemplation et
fatalisme -chansons2 et 3 : le chant du cygne et le Lieu désiré); ou le
mouvement (là-bas, révolte et voyage -chansons -5 et 6: Capitaine
courageux et Eden Bay).
Le tout, hante non par les animaux (2),
contrairement à ce que suggère l’artiste dans une insolite prière
d’insérer en javanais poétique, mais par les Indiens (c’est-à-dire
l‘état sauvage), l’eau (c’est-à-dire le non-être des limbes), et la fin
(c’est-à-dire la mort), s’articule et concentre en symétrie inverse
autour du morceau-titre pivot Revivre, double dénégation patente, cœur
du légume brésilien maléficieux coupé en deux sur la pochette
;
le même tout dichotomique étant appelé à trouver sa solution dans la
chanson du septième jour, extenué de cette (re)création, Territoire de
l’Inini, ode aux « cendres », au « sommeil » et aux « eaux ». Passons
au déluge.
Réponse Chant du cygne. Disque de la réitération (« re»),
du sursis –sans sursaut, ce laser-noyau tourne littéralement, selon
l’expression populaire, autour du pot. Le pot, ou « blinde » de ce
tapis de poker existentiel, c’est Revivre -comme on dit: « se
refaire»... quand on a tout perdu. Mais avant d’en arriver là, d’en
venir au fait (« Pour voir... »),proprement chamanisé, écrasé entre «
forêts », « pluies » et « rios»; l’album vert de « l’0iseau de Paradis»
perdu, peut-être dans “un délire de possession orichaque digne du
candomblé baian, déploie ses fastes vieille France sur un Chant du
cygne typiquement symboliste - même si plus baudelairien que mallarméen
à vrai dire, en dépit de son dictionnaire de « ténèbres» et
d’«étang».
Que dit Manset, Rouge-Gorge brésilien d’antan recyclé «
cygne » des temps? « Escalier dans le noir où l’on s’appuie»; que dit
Baudelaire? « Monte dans l’air du Soir comme une mélodie/ Un parfum
d’encensoir, de paradis »; que dit Mallarmé? « Et ce que l’on croit
voir, ce qu’une main désigne/ Ce sont les ailes noires, le chant du
cygne ». Ne manque plus que Rodenbach; le Swan(n) aux yeux de ciels
brouillés des béguinages amorphes et des canaux de Bruges la morte. La
réponse proposée est: « l’avenir, soit les enfants (Ce sont eux qui
seront légion, légion... ») .
Réponse le Lieu désiré. Du « cygne »
aux canards il n’y a qu’un « coup d’aile ivre »; la scène suivante se
passe à peu près au bassin du jardin du Luxembourg, entre « kiosque à
musique » de rendez-vous d’automne et attractions (cf. photo puérile
sur livret), à deux pas du Théâtre de Marionnettes (à gaine). Alentour
rodent pigeons, familles; « enfants qui volent», voyeurs - avec ou sans
visée pédérastique. Là où dans le domaine de Guermantes, aux Tuileries,
ou n’importe où où l’on s’ennuie en somme, mais nécessairement au pays,
ce Lieu désiré.
Autre Matrice, si l’on veut, ce Lieu désiré selon
Manset c’est évidemment « là où l’on est né » et où l’on est pour
toujours, en actes ou pensées,-Vendômois ou Neuilly-Les Sablons, Royan,
où l’on se retrouve toujours; c’est la mère, ce sont les rues, les
signes, la patrie, le square, la choucroute, c’est la « maison ».
Vaille que vaille.
Ce qui se dit: « Ainsi les choses passent, les
quartiers se vident / Et lui revient livide, la chemise ouverte »,
évocation sûre, après Charles et Stéphane, du poète pochard du « grand
parc solitaire et glacé» rimbaldien, dont le fantôme aux « lèvres
molles » (dont « on entend à peine les paroles ») reviendrait toujours,
« vagabond » « au vent mauvais » hanter « l’allée déserte » et, « sur
le banc glacé/ Venir se placer »... Entre ritournelle de limonaire (le
45 tours du disque) et air d’orphéon fané, pas tout à fait une valse de
Vienne; la Pavane pour une « enfante » défunte.
La réponse proposée,
double, est: a)s’arrêter (« Comme chienne met bas»), b) la
schizophrénie (« Cadenasser les portes et les serrures »).
Revivre.
Voici notre héros « à demeure »; une nostalgie l’agite, le
ronge
-de quoi? d’avant ou d’après? Il n’en sait rien ni nous (terrains
vagues périphériques? « future vigueur »? romanichelles de préaux .sans
chaussures? « Carthage et ses éléphants»? « ciels de nacre
»?...). En attendant, chaque seconde qui s’écoule ici c’est un peu de
Lumière qui s’éteint, or un jour il sera trop tard, comme tous les
jours, il sera l’heure d’Est-ce ainsi que les hommes meurent? ou de
Seul et chauve, « le temps venu qu’on» se repose », heure dernière de
ne plus vivre... « Vite, est-il d’autres vies ?», donc, vite Revivre.
C’est-à-dire? « On se voit se lever / Recommencer / Sentir monter la
sève» (outre une des nombreuses licences poétiques de l’album, une
autocitation musicale cryptée du passage suivant de la Mort d'0rion 70:
« [Is ont petits/ Grandi / Démesurés/ N’essayez de les/ Mesurer» -le
Paradis Terrestre). Mais encore? « Tout vendu, tout donné », partir à
la recherche du « point de non-retour», « toujours se dire adieu »,
traverser la ville « au milieu d’enfants endormis » vers la gare, ou
prendre le Train du soir pour nulle part : « Allons! La marche, le
fardeau, le désert, l'ennui et la colère. »
Ou François-René de
Chateaubriand, « habitant, avec un cœur plein, d’un monde vide », et
auteur du Voyage en Amérique, rejoint l’ « homme aux semelles de vent
», auteur des Assis.
Tout anxiété, instabilité chronique,
cette typique danse de l’ours « danse et magie» dans sa formulation
maison 1991(1983, en fait avec velléité de publication 1989 au lieu de
Bergère, inédit compromettant remplacé par Juste avant l’exil),
s’intitule donc pleinement: Revivre. Piètre programme. Vouée à l’échec
total, si l’on réfère à la chute fêlée du morceau (« Mais ça ne se
peut/Mais ça ne se peut…»), ces regrets de « re-vie »
antérieure
sont une méditation rien moins que funèbre, l’enterrement de Vies
monotones dont ce piano-blues en B (Beckett, Bernhard, Blaise P.,
Bossuet...) serait comme la retombée expirante, voix tombale déjà
enlisée, vie enfonçant, avec les pelletées d’inspiration bredouille : «
On croit qu’il est midi / Et le jour s’achève / Rien ne veut plus rien
dire… »
Réponse Capitaine courageux, « Fini le rêve »? Une seule
issue, on l’a vu, sempiternelle, inlassable, inévitable, à cette
panique du rien en tout: l’errance. Celle du trouvère ambulant éternel,
avec ses lais, ses vapeurs, son luth, ses visions d’Embarquement pour
Cythère à la Lorrain. La déroute en chantant, I’0dyssée,.le périple,
l'invitation au voyage.
Dans la lignée des grandes « dérades »
Manset, type Marchand de rêves, Comme un guerrier, Camion bâché et
autres chansons-fleuves, la course à l’abîme du Capitaine
courageux (7’37"), bien loin d’un hommage à Jules Verne ou à son
capitaine Nemo nihiliste, est un évident Bateau ivre (3), radoubé 2870,
dont la fin, « quille éclatée »/ « Sur le flanc, sur le côté », trente
fois convertible de l’aveu même de l’auteur (« Capitaine/ Que le vide
entraine/ Sous les étoiles/ Comme pollen/ Ta peine/ Dans le grand
tumulte des cieux /etc. »), pourrait être celle, pré-atomique, des
Aventures d’Arthur...Gordon Pym, aboli dans « Les gouffres
ultramarins aux ardents entonnoirs ».
La réponse proposée est: perdre la boussole.
Réponse
Eden Bay. Mais non. Une pause après le tourbillon, ce maelström
d’images du grand passage sous le signe du « cargo percuté » : le port.
Un autre, perdu « à l’autre bout du monde » - l’ultime escale ? Notre
Corto du Drugstore, rendu à son déterminisme baroudeur, y jette
l’ancre; mataf endurci touchant terre titubant pour la millième fois,
et partant illico en piste (« yo-oh! une bouteille de rhum!»).
On se
retrouve avec lui, soutier d’un « Amazonian Queen » rescapé du « Delta
d‘Andromède» ou assimilé Vaisseau Fantôme, dans le rade typique, annexe
du Marin Bar inoubliable de 1981: Eden Bay. Après vous...
Là où,
sans identité ni espoir, « au-dessus du Kangooroo Bar », « les grands
fauves viennent boire» (« Ces féroces chasseurs retour des pays chauds
» actualisés Manset), là « à des milliers de kilomètres », à l’abri de
ses « rideaux sales », est « le plus bel endroit du monde»;
là,
“dans ce Heartbreak Hotel du « spleen et chagrin » antipodin, vivent «
les sirènes»: Maria-Té-(« corps de mendiante, profil de reine ») ou
Estelita (« des coups de rasoir plein les bras »); là, le « grand
Viking aux yeux d’or» et « Nora » nous rejouent le Hollandais
volant ou Amsterdam sur un air syncopé de Sarbacane (à drogue ou
fléchettes empoisonnées, une spécialité du pays des piranhas) ; et
voilà le morceau le plus guillerettement enlevé du disque, avec le Lieu
désiré : lugubre.
C’est une chronique, une page de Journal écornée,
carte postale pittoresque d’un « consul » qui se serait trompé de
latitude et de (« cantina ») fatale. Là-bas, « au-dessus du Golden Gate
», alors que « la longue nuit s’installe », on imagine le Voyageur, «
passant considérable »1891 rectifié « anonyme passant » 1991, entamant,
tel le Gérard Philippe transcendant des Orgueilleux, entre « les tables
branlantes » et « la caisse de San Miguel », une farandole
triste
avec l`esprit des lieux, gentille hérédo-syphilo-sérop’ aux « yeux sans
paupières ».
Au fond de cette nuit de grâce pourrie amérindienne, de
toute façon, « la chambre 311», aux probables et souhaités. «murs
moisis », puis la « petite entaille / Rouge et dure comme une écaille/
Comme une marque sur du bétail ». Bonne nuit noire, « sinistre nuit ».
La réponse proposée est: le divertissement (sens pascalien).
La
réponse: Territoire de l’Inini. Et après? Fuir encore au petit matin?
Encore se rappeler? Partir re-tuer d`autres futurs souvenirs, « marques
et brûlures» à effacer, « traces et blessures» à laver, mesures de la
vie qui passe autrement sans laisser rien? Toujours s’envoler, condamné
à s`embarquer, se reperdre, ce qui veut dire « revivre»?
Repartir
au signal: « Assez ! Voici la punition -En marche! », encore et encore,
sans repos, à perpétuité? Jusqu`au jour de tomber par terre « la tête à
côté du corps », mort sans phrase?
Jusque-là, cancer du genou ou
« langue colombienne», quoi? Voici le programme : « Il faut
refaire encore ce que l’on aime», définition épatante du bonheur selon
l’artiste-peintre (-chanteur-graveur-compositeur-trafiquant d’art
-producteur -photographe -maquettiste -père de famille (4) –écrivain
(5)-karateka...): refaire peut-être le même « grand parcours » et le
même petit disque sempiternel, les mêmes discours,: « repartir le
matin, revenir le soir », remonter « la même allée déserte»
jusqu’au « bout du monde », le même «escalier dans le noir », reprendre
tout à zéro, la mer (« l’océan, suivant la pente « ), la route (« tu la
prends, qu’est-ce que ça coûte?»), l’avion (« Puisqu’on sait
pas
toujours où l’avion se pose/ Et qu’on a peur de perdre et, peur de
rater quelque chose... »), le camion (« Depuis tant d’années /
Tant de coups bas/ Camion s’en va »), le voyage (« en solitaire/ Qui se
passe de commentaire/ Pendant des années entières...»), éternellement «
vivre juste une seconde », en n’oubliant jamais que « jusqu’au dernier
instant, il faudra être digne», revenir, « chien dans un jeu de quilles
» repartir, marcher de travers « comme un crabe », flottant toujours, «
saumon qui monte et qui descend », au fil du même arroyo du temps, et
enfin….
Conclusion. Enfin, fini-Nini, l ’Inini; un peu-inane, un peu
« ni, ni », un peu lianes, un peu inné, un peu nihil, un peu igname, un
peu Ninive, un peu nu, un peu nina, un peu nul, résumant au passage la
conception, très Thomas Edward Lawrence de l’Eden selon Manset, pèlerin
du désastre en milieu primitif « pré-logique» (« Du fond de leur
sinistre nuit / C 'est comme un bout de paradis » : gla-gla). Enfin,
cette pure berceuse « Chaud comme un nid»), suavement abandonnée au
dodelinement de l’émotion (« Glisse sur le Maroni ») telle une Claire
Fontaine croupie au pays d’Aguirre le Cortezuma, messie des macaques
(Enfin, métrique épurée, rime nettoyée jusqu’au lustral, boucle
bouclée, sans plus ni début ni fin, ni bien ni mal, l`Eldorado de la
Méduse: Territoire de l’Inini.
Écho à l’antique Ailleurs (« Rien ne
fait peur /On vit on meurt /Et personne ne pleure»), réponse différée à
la question du salut du début, Territoire de l’Inini, mélopée aux airs
immémoriaux de complainte migrante arménienne au dibouk, c’est la
plénitude dans le dénuement (« Dans la cabane pour la nuit... »), la
lumière par la pénombre (« Flamme d’une bougie...»), l’éveil dans
l’assoupissement de la conscience (« Dans le village endormi...»).
C’est
le rachat par la malaria (« Fièvres, maladie/ Territoire de l’Inini »)
la rédemption par le déluge (« Pluie sans répit / Sur le rio Kamopi »),
c’est le salut dans la perdition (« Tout y finit/ S’enfonce vers
l’infini…»). Saumâtre eurythmie, déréliction suave au rythme
atemporel des « piroguiers aguerris», antienne du « tronc équarri»,
dérivant... tout aboli part à vau-l’eau, album compris (jusqu’au
prochain -mais pourquoi sent-on à ce point passer sur celui-ci le
souffle des adieux à la vie ?, litanies.
Ce qu’un Chateaubriand eut
ainsi exprimé: « D ‘où me vient, Ô mon Dieu, cette paix qui m
’inonde » et se dit aussi : « Pleure et prie » en Manset tel qu’on le
râle. Au nom du père, du fils et de l’Inini.
BAYON
Album Revivre CD/LP/K7, Pathé Marconi
Rappel : Matrice avant dernier album et Toutes Choses ( coffret-CD)
(1)Dernier
emballement littéraire de Manset, plutôt lecteur de « S.A.S. » sur la
Cathay, après Voyage au bout de la nuit (1986) et Illuminations (1988),
(re)découverts de même : debout en librairie.
(2)Mentionnés: singe,
bique, cygne, chienne, saumon, poulpe, abeille, sirènes, kangooroo,
bétail, fauves -rien de spécial.
(3)Bateau Ivre hallucinogène lui-même inspiré en son temps (septembre
1871), de Verlaine (Angoisse) et du Parnasse Contemporain.
(4)Marié, deux filles adolescentes.
(5) Royaume de Siam, roman, Aubier.
***********************************************************************************************************************
Tristes Tropismes
Le Nouvel Observateur -1991- par Serge Raffy
C’était
un temps de mousson. Un de ces jours poisseux où rien ne va, sous une
averse noire, boulevard de Saint Germain. Manset est arrivé avec son
costume traditionnel: Battle-dress élimé, jean, baskets usés, la
panoplie du routard éternel.
Comme d'habitude, il a parlé de Paris,
cette putain de ville où les gens ne se parlent plus et où la pluie
glace les os. Il a pris une feuille blanche et dessiné la carte de
l'Amazonie, puis a tracé un cercle quelque part à l’ouest d'Iquitos.
C'est
là, dans cette zone frontière humide entre le Pérou et le Brésil, qu'il
compte déguerpir. Rejouer son rôle de voyageur solitaire. Sa mission.
«
Je suis un volatile, dit-il. Mon problème, aujourd'hui, c'est la
température. Je ne supporte pas plus de 24 degrés dans la journée. »
Avant
la fuite ??, Manset l’anachorète veut bien parler de son dernier
disque, le quatorzième. Comme d'habitude, il ne veut pas s’attarder sur
les détails. Pour éviter les lectures déformantes, et raconter
l'histoire d’un quadragénaire qui ne veut pas se débarrasser de sa peau
d'enfant.
De cet homme lunaire qui prêche, comme Rainer Maria Rilke dans ses
Lettres à un jeune poète, le devoir de solitude.
Manset, première, Titre de l‘album : Revivre.
Sept chansons
Climat : cotonneux sur fond de guitares équalisées.
Explication : le Manset déchiré, marginal, chanteur fantôme ne veut pas
porter toute la douleur du monde.
L’ermite du rock a l'âme joyeuse.
«
J'ai voulu écrire un album soft. Je ne veux plus être le chantre de la
noirceur apocalyptique. J'ai réalisé que dénoncer ne sert à rien. Cela
ne fait que démolir davantage. Je ne veux plus participer à tout ça. »
Manset
en pleine métamorphose ? Pas vraiment. Simplement, il rajuste le tir,
se concentre un peu plus sur sa tâche, la chanson, ce genre bâtard et
pourtant délicieux:
« Je suis un type lâché dans un dédale, dans un jeu de pistes, et je
cherche des indices, des traces d‘amour. »
Pour
le reste. Manset ne change rien. Il ne veut toujours pas passer à la
télévision, même sur la Sept, jure que jamais il n’apparaitra dans un
autre clip.
Par mesure d'élégance mais aussi pour éviter les phénomènes
parasitaires.
Pas question de salir la poésie.
Il faut distiller cette potion avec parcimonie,
La poésie ? Manset parle de l‘artiste Rimbaud et sa peur de la tempête
qui va vers le trop-plein de mots, d'articles de presse.
La poésie est une confidence
«
La poésie contient elle-même son propre suicide, puisqu’elle ne peut
être qu'inaccessible, dissimulée, hors d‘atteinte. En théorie, elle
s’exclut d'elle-même. Après, il y des médicaments, des remèdes qu'on
distribue qu'au compte-gouttes. La poésie est un remède homéopathique. »
Retour
à la forêt amazonienne, au silence des fleuves moites. On the road
again. Kerouac and Co. La balade dans le poumon du monde. Manset évoque
la guerre de survie des indiens dans ses chansons, Tristes Tropiques et
Territoire de l'Inini.
« Indiennes nues, femmes sans âge
Serez devenues tourbes ou feuillage
Vous vous réveillerez, le marécage
Sera couvert d’acier jusqu’aux nuages. »
Manset écolo.
«
Non, non, » se défend-il. « Un simple électron qui veut fuir ce
merdier. Je cherche cette putain d'étoile qui va me conduire vers le
Sud. »
Sur le coin de la table, il récupère son croquis du fleuve
Amazone, va glisser son index le long des méandres de Bella vista,
Manaus, Iquitos. Il ira.
Avant, il visitera la poignée de
journalistes qu'il a choisi pour parler de lui. Une confrérie de ?? qui
dissèquent Manset au scalpel. Des exégètes accrédités.
Pour eux, il
a remixé trois titres qu'ils avaient jugés inaudibles. A cause de sa
voix. Organe métallique et rauque qui déclame le malaise d'un des très
rates poètes de notre époque.
«La voix est impudique, » dit-il. « Elle dénature les mots. Mais nous
n'avons pas le choix. Il faut faire avec. »
Il faut replonger dans le froid liquide des jours. Redevenir un
volatile.
Sur le boulevard Saint-Germain ou à Iquitos.
Gérard Manset, sous la pluie, est reparti. Sans parapluie.