Gérard Manset
portrait d'un homme sans visage
échanges avec les journalistes.....
Le Langage Oublié (2004) : Entretien
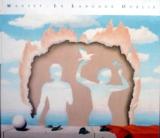
LE DERNIER DES MOHICANS
MAGAZINE LONGUEUR D'ONDES (MAI 2004)
Manset : Oui, c’est un peu le traquenard, la manie, c’est-à-dire que l’on ne doit pas parler des choses que l’on veut mettre en avant, donc on ne va pas parler d’un album. Ou alors c’est une chronique. Mais quand c’est une rencontre, c’est soit des entretiens, soit, plus rarement d’ailleurs, un portrait. Mais je vais commencer à être vigilant sur tout ça parce que, prioritairement, quand je rencontre quelqu’un, c’est plus pour parler de l’album ou de la musique que de moi et de mon ego.
S.F. : C’est dur de parler de la musique en soi.
Manset : Oui, et si on rentre dedans, on en parlerait pendant dix pages et ce n’est pas l’objet… Ou alors peut-être de magazines plus spécialisés, plus techniques.
S.F. : Mais ça vous plairait de parler plus de votre musique ?
Manset : Je ne sais pas. Parler trop de ma musique me dérangerait aussi. Parler trop de moi me dérangerait aussi… En même temps les deux sont intimement liés parce que je suis à la base de tout : orchestrations, pochette, typographie, paroles et musiques, bien sûr. J’ai surtout une autre dimension beaucoup plus importante qu’aucun artiste n’a (enfin aucun dans ce que l’on appelle le showbiz, la variété ou la musique) : c’est le droit de vie ou de mort sur les sorties, sur la configuration et les reconfigurations de mes albums. Sur une parution comme celle-là, y aura-t-il 10 titres ? N’y en aura-t-il que 7 ? Personne ne le sait, ça dépend de mes états d’âme, enfin c’est beaucoup plus compliqué qu’un simple caprice, c’est toute une alchimie personnelle qui fait qu’il y a une stratégie. Je pars en campagne, je dispose mes troupes comme je l’entends.
Je peux changer mon plan de bataille 8 jours avant la sortie. Tout ça, c’est des responsabilités. C’est pour ça que le titre de Libération, « Manset en soi », ça ne me gêne pas. A la limite, ce « Manset en soi » et le côté « sédimentaire » qu’ils ont mis en avant, cela me plait tout à fait, car ça correspond à cet album. En comparaison avec certains des albums précédents, là il n’y a en effet aucun exotisme. À part Demain il fera nuit qui traite un peu d’on ne sait quel tiers-monde, il n’y a surtout pas d’exotisme. Il n’y a pas le Vahiné ma sœur de l’album précédent, il n’y a pas La ballade des échinodermes de La Vallée de la Paix, il n’y a pas les Royaumes de Siam, pas Eden bay de Revivre…
S.F. : C’est un choix cette absence d’exotisme ?
Manset : Comme l’exotisme en lui-même commence à être de plus en plus portion congrue, ratatiné, ratiboisé par tous les bouts, peut-être que, par le fait, il a été évacué sans que je le cherche. Mais la réalité est tout autre : j’ai beaucoup de titres et c’est comme un petit train qui se met en branle, où les wagons s’accrochent les uns derrière les autres mais en fonction de la topographie, du terrain, de la couleur, de la lumière. Donc à partir du moment où Le Langage Oublié allait figurer sur l’album (il y en a eu différentes versions, jusqu’au dernier moment, je n’étais pas certain qu’il soit comme je voulais qu’il soit, donc que j’arrive à le mettre…) et qu’il allait être une sorte de clé de voûte, ça impliquait forcément que certains autres titres y soient et d’autres pas… D’autres, qui, peut-être, parlaient d’exotisme. J’en ai fait un qui est un peu dans l’esprit d’Eden Bay, qui est très rock, qui déboule sur 7 minutes et qui est un texte absolument, épouvantablement magnifique (qui sera polémique d’ailleurs), mais bon il n’est pas dessus. Il y en a comme ça un certain nombre qui pourraient être considérés comme traitant de l’exotisme et qui n’ont pas eu leur place sur cet album. Ce Langage oublié, c’est une sorte d’album parigot-parisien, banlieuso-banlieusard.
S.F. : C’est ici et maintenant ?
Manset : Non, pas ici et maintenant. C’est ici et il y a pas mal de temps, c’est ce que j’ai connu et ce que l’on perd, c’est ce monde en voie de perdition qui évolue en dehors d’un « langage oublié » qui est le langage amoureux, délicat et engagé avec toute l’estime et toute la réserve qui était due au sexe opposé. C’est aussi une sorte de nostalgie des années 60-70, de toute cette campagne et de toute cette banlieue ratiboisée, passée par les pelleteuses et que l’on ne retrouvera plus jamais, bien sûr.
« Jusqu’à ce que je crève, je continuerai »
S.F. : Vous écrivez pour d’autres : Raphaël, Indochine, Jane Birkin, Juliette Greco. Qu’est-ce qui vous a donné envie de sortir un nouvel album, d’exister encore en tant que Manset, auteur, compositeur, interprète ?
Manset : Ça peut paraître un peu abstrait, fantasque et inimaginable, mais c’est parce que j’ai des contrats. Jusqu’à ce que je crève, je continuerai, il y aura des albums qui sortiront parce que j’ai installé des contrats en amont. Et je remplis mes contrats. Alors les albums, je les retiens ou je les lâche, mais il y en aura, toujours.
S.F. : C’est une manière de vous fixer des deadline ?
Manset : Non, parce que malheureusement je me suis ménagé quantité de choses qui font que je n’ai aucune obligation. On s’interroge sur la légitimité de la création artistique : pour quelles raisons va-t-on sortir un album? C’est du nombrilisme, de l’ego : on a largement assez de matériel artistique pour ne pas encombrer le panorama. Je dis ça pour moi, je dis ça pour tous ceux de ma génération, aujourd’hui. On n’a pas besoin d’auteurs, on n’a pas besoin de compositeurs, on n’a pas besoin d’artistes plasticiens, encore moins que jamais de ceux-là, mais bon… Alors on est dans ce processus un peu privilégié de pouvoir s’exprimer, de s’interroger sur son nombril, de se regarder dans la glace, de se demander si, quand on prend un crème, ça va donner un roman, un ouvrage, un texte… Donc légitimité : point d’interrogation. La motivation ça peut donc être l’argent. Mais dans mon cas ce n’est pas l’argent, en ce sens que je n’ai pas besoin d’avion, pas besoin de Maserati, pas besoin d’acheter un club de football. Avant, avec cinq dollars, le bout du monde, on pouvait encore, c’était le paradis partout. Plus maintenant !
S.F. : Alors c’est l’envie de dire quelque chose qui vous a motivé ?
Manset : Ah, non. Ça pourrait être l’envie de parler, de s’exprimer, de polémiquer, mais non pas de message. C’est un peu le cas de tous ceux qui font de la scène aujourd’hui, qui ont toujours une sorte de message, en général c’est toujours le même, on le connaît.
S.F. : Vous dites ne pas avoir de message…
Manset : Non, je n’ai pas de message. Moi, mon message (ma langue, pour ne pas parler de message) c’est simplement la poésie, la sensibilité, la lumière, des trucs de tout temps. Ce n’est pas une revendication quelle qu’elle soit, ni sociale, ni politique. Ce monde m’exècre, enfin j’exècre ce monde. Donc ma motivation n’est pas le discours. Ça pourrait être la femme, enfin l’amour, une preuve d’amour : de tout temps on a fait des folies pour une blonde, une brune, une grande, une petite, une mince, une maigre…
S.F. : Pour ce disque aviez-vous envie de dénicher un concept, un terrain, un imaginaire commun où il pourrait s’ancrer pour que ce ne soit pas un album comme les autres, qu’il y ait quelque chose de nouveau…
Manset : Là, c’est autre chose, c’est-à-dire qu’à partir du moment où je suis dans le mouvement, qu’il faut que les albums sortent… D’abord, il y a des gens qui les attendent ces albums parce que forcément, avec le temps, ce que je dis aujourd’hui est devenu unique. Ce n’était pas encore un matériel totalement unique, il y a 8, 10 ou 15 ans, à l’époque de Royaume de Siam où j’aurais pu disparaître de la circulation, mais ça l’est devenu. Donc aujourd’hui, je suis un peu piégé par ça, j’ai quand même des scrupules… Ce que je fais est devenu lisible au premier degré.
S.F. : Quelle guerre avez-vous encore à mener avec vous-même pour devoir faire un nouvel album ? Il y a bien une envie personnelle qui est à l’origine de cet album, non ? Dans vos chansons, une sensibilité s’exprime encore…
Manset : Il y a toujours eu l’envie, il y a toujours eu la spontanéité, la création instantanée, très féconde, toujours, je remercie le Seigneur ; je touche du bois, je ne sais pas d’où ça me vient… C’est toujours venu instantanément, tout de suite, beaucoup. La seule chose qui change, c’est qu’avec l’âge, j’ai accumulé comme tout le monde des sensations différentes, des déceptions, des plaisirs, des bien-être, des visions, des regards personnels, qui font que tout cela se manifeste sous la forme d’une création légèrement différente, beaucoup plus affinée dans le texte, beaucoup plus exigeante…
S.F. : Vous sentez que vous arrivez encore à vous étonner et à vous amuser ?
Manset : Oui, heureusement, sans ça je ne le ferais pas. Dans cet album, Un Jet de Pierre est un texte miraculeux. Le Langage Oublié est beaucoup plus classique, à la limite ce serait celui qui m’étonnerait le moins, celui qui serait peut-être le moins signé, à part 2-3 endroits… Moi, je peux analyser mes textes de l’extérieur. Par exemple, un jour Cabrel avait repris, dans un CD qui s’appelait Route Manset, Prisonnier de l’inutile, et je m’étais dit un moment : « C’est magnifique, il aurait pu la faire. » Mais non, parce qu’il y a un ou deux mots qu’il n’aurait jamais pu sortir. Je n’ai donc pas besoin de signer la plupart de mes textes parce que personne n’aurait cette sorte de volte-face à un moment ou un autre. Dans cet album, il y a Quand on perd un ami, une chanson relativement conventionnelle que d’autres auraient peut-être pu écrire, qui serait un très bon matériel d’auteur-compositeur, mais dedans il y a par exemple les mots « fakir embaumé » et d’autres endroits où il y a la « paire de baffes ». Et cette paire de baffes dans le texte, personne ne l’a !
S.F. : Cette chanson se réfère-t-elle à un ami particulier ?
Manset : Non… Un jour, je livrerai quelques traces sur certains titres, je remonterai la filière, je donnerai quelques clés. Parce qu’il y a quand même beaucoup de chansons dont j’aimerais parler, oui.
S.F. : C’est vrai ?
Manset : Ah oui ! J’aimerais donner les clés de certains trucs, forcément. Rien n’est anodin. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai un public aussi fidèle qui, après 5 ou 6 ans d’absence, s’est rué chez les disquaires. Je vends beaucoup d’albums, enfin proportionnellement, parce que les ventes ont quand même énormément chuté par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Mais pour quelqu’un qui ne fait ni scène ni télé, je suis très bien placé dans les ventes.
S.F. : Vous avez quand même fait une télé récemment avec l’émission CD’aujourd’hui.
Manset : Mais je n’ai rien fait moi. On a fait ça sur le titre Le Langage Oublié et moi j’étais derrière. Le directeur de l’émission est quelqu’un qui aime beaucoup ce que je fais et il a voulu absolument que l’on trouve une formule. Donc j’ai dit : « Il n’y a pas de problèmes, sur cette intro il y a une fille qui parle, on va la montrer elle et puis pour le reste la caméra va se balader en studio ». Je suis tombé sur une équipe nickel, un très bon réalisateur, un monteur impeccable, des gens compréhensifs et ça s’est fait tout seul. Dès que l’on parle avec les gens, on voit bien que c’est très simple de mettre en chantier des choses qui, à l’origine, semblent paradoxales.
S.F. : Sur le disque, qui est la jeune femme qui chante l’intro sur Le Langage Oublié ?
Manset : C’est Camille, une artiste. Elle ne chante pas d’ailleurs, elle parle. Elle a une très belle voix. J’ai toujours beaucoup de difficultés quand j’essaie de travailler avec d’autres personnes sur mes propres disques, ce n’est jamais ce que je veux, jamais ce que j’ai en tête, on part toujours ailleurs. En ce qui concerne Le Langage Oublié, il y a même des moments dans la chanson où j’aurais dû garder ses interventions et finalement je les ai enlevées. Pour tout le monde, ça aurait été très bien, mais pour moi non, je suis un emmerdeur… c’est tout, c’est comme ça. Mais je suis aussi exigeant pour moi, depuis longtemps.
« La chanson, ce n’est pas de la littérature, mais chez moi, oui »
S.F.: On a l’impression que depuis Animal on est mal, votre premier album sorti en 1968, vos disques sont toujours les mêmes, qu’ils abordent les 2-3 mêmes thèmes…
Manset : Oui, mais enfin est-ce qu’une page de Céline prise dans n’importe lequel de ses ouvrages est différente ? Est-ce qu’on ne peut pas inverser les pages ? Oui, tout est pareil, c’est normal, tous les auteurs ont une personnalité, ils ne font que rabâcher, avec un petit peu de couleurs… Par exemple, toutes les toiles de Bonnard sont les mêmes. On peut les mettre les unes à côtés des autres, c’est la même toile qui continue.
S.F. : Comment se fait-il que vous fassiez tout le temps « le même album » sans que l’on vous le reproche, et sans que ce soit un mauvais album ? Auriez-vous touché au but dès le départ ?
Manset : Non, ça n’est pas ça. Avec la chanson, on est dans un registre très bas de gamme, donc, la plupart du temps, on me compare avec des choses qui n’ont aucun intérêt. Joe Dassin, Magma, Bashung ou Manset, tout ça est recouvert par la même appellation, c’est-à-dire showbiz, chanson, variété, ce que l’on veut.
S.F. : Mais vous dites justement ne pas faire de la variété.
Manset : Oui, moi je le dis. Mais les gens le lisent comme ils l’entendent. Quand ils ouvrent un journal, c’est écrit « une chanson » ; ils n’ont pas à savoir le travail qu’il y a derrière.
S.F. : Ils n’ont pas à le savoir, mais ils le sentent, en tout cas vous voulez qu’ils le sentent, non ?
Manset : Oui, je le veux, c’est la moindre des choses, que je me défende, que je me débatte là-dedans. Mais ce genre de message passe difficilement. D’ailleurs, il n’a peut-être pas à passer. On n’est pas dans un registre littéraire. Moi je pense y être, mais comme ce métier n’est pas dedans, je suis avalé par l’ensemble du reste. Quant au fait de dire que je fais le même album, alors oui, si c’est dans le sens laudatif. Trénet a toujours fait le même album. Seules les chansons diffèrent.
S.F. : On entend parfois dire que le meilleur album d’un artiste, c’est son premier…
Manset : Ça ne veut rien dire. Et puis il n’y a pas de point de comparaison. Je vais remettre les pendules à l’heure : j’ai fait 3-4 albums totalement hors normes, qui sont La Mort d’Orion, Animal On Est Mal, Y’a Une Route et Long Long Chemin. Les quatre premiers sont totalement hors normes, avec des erreurs, des approximations, avec énormément d’inspiration et beaucoup de risques pris, seul, sans équipe. Ensuite, pendant quelques albums, Royaume de Siam, Comme Un Guerrier, L’atelier du Crabe, 2870, il y avait toujours de l’inspiration, des choses très novatrices (2870 c’est une face entière de techno avant la techno et puis c’est très british, je l’ai gravé à Londres, les mecs étaient à genoux dans le studio), mais ensuite, j’ai joué un peu une sorte de showbiz pendant 4-5 albums. Ceux-là sont moins uniques. C’est un choix. J’avais 30-35 ans, je déconnais, je voyageais beaucoup, je m’éclatais… J’ai fait des choses moins prise de tête parce que j’étais à une époque plus légère. Et puis j’ai fait quelques petits titres au format radio, comme Marin’ bar, L’atelier du Crabe et Le Train du Soir qui ont beaucoup été diffusées. À l’époque, je passais en radio parce que j’avais des titres de quatre minutes un peu plus légers. Pas à 9h du matin, mais ces titres passaient. Il n’y avait pas les contraintes d’aujourd’hui.
S.F. : Mais selon vous, vous ne donniez pas le meilleur de vous-même ? Vous n’étiez pas totalement dedans ?
Manset : Non, c’était simplement une part de moi que j’ai laissé s’exprimer et dont je suis très content. Dans mon univers, si je laisse une chanson sortir c’est que je la valide. Je choisissais tout simplement dans mon inspiration les choses les plus immédiates, les plus « pêchues », où la musique était plus rock, plus accrocheuse, moins introvertie, moins réfléchie, moins nostalgique… Mais j’avais malgré tout des Marchand de Rêve de dix minutes ! Je partais dans un délire ou je mélangeais un peu tout. Mais depuis Lumières, Prisonniers de l’Inutile, Matrice, Revivre, ça y est là : j’ai largué les amarres, je suis absolument inaccessible pour tout le monde dans le showbiz !!! Personne n’aura jamais cette inspiration, ce travail de studio, ce travail d’orchestration. Ils font autre chose peut-être, ce n’est pas le problème, ils font de la scène, mais c’est à des années lumières de tout ce que les auteurs-compositeurs les plus féconds ont pu faire. Nougaro vient de disparaître. C’est quelqu’un que j’estimais beaucoup, mais finalement il a écrit des textes, pas tous, mais il n’a jamais écrit de musique, ou quasiment pas.
S.F. : Á sa mort, les journaux titraient : « La mort d’un poète ». Pour vous, c’était un poète ?
Manset : Évidemment que c’était un poète. Il a fait de très beaux textes. Mais sur le plan de la quantité, sur le plan de la démarche, encore une fois on est à des années-lumières. Il a fait 5-10 textes très beaux, d’ailleurs il a eu beaucoup de succès. Mais sur le plan de la fécondité et de l’inspiration, le seul à qui on pourrait me comparer (mais il vient d’une autre époque et n’a jamais fait d’orchestrations, n’a jamais joué ce travail d’auteur axé plutôt littéraire) c’était Trenet. C’est le seul, je n’en vois pas d’autres.
S.F. : Mais tout le monde n’a que 24 heures par jour et l’on ne peut peut-être pas en même temps faire de la scène et…
Manset : C’est vrai, c’est tout simplement ça. Et puis peut-être est-on plus ou moins prédestiné à une chose ou à une autre. Tous les gens peuvent prendre un pinceau, ils ne sont pas tous Bonnard et puis ils peuvent tous écrire, ils ne sont pas tous Céline. Simplement, il arrive un moment où l’on se rend compte qu’il y a pas de secret là-dedans : il y a une quantité d’informations artistiques colossales. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’écrire un roman de 150 pages et puis d’attendre une certaine notoriété, puis d’en écrire un autre 4 ans après et un autre 5 ans après. Tous ceux qui ont eu un nom dans la littérature ont écrit 250 bouquins de 500 pages. Et ils écrivaient toute la journée. De la même manière, moi je suis d’une époque où il y avait beaucoup d’auteurs-compositeurs qui étaient infiniment plus féconds que ceux d’aujourd’hui. Il m’est arrivé d’être derrière un bureau et de produire, et quand quelqu’un arrivait, il n’avait pas juste 4 titres : il avait 25 ans et 80- 90 titres terminés !
S.F. : Pour vous, la quantité est un gage de qualité ?
Manset : Oui, bien évidemment. C’est Victor Hugo. Chez lui, il y a un million de pages !
S.F. : Vous dites compter uniquement sur l’inspiration. Pour Nick Cave, par exemple, il ne croit pas à « l’inspiration ». Chaque matin il dit se forcer à s’asseoir à son bureau et écrire, écrire jusqu’à temps que quelque chose sorte.
Manset : Moi, ce n’est pas mon cas. J’ai toujours dit : « Moi, je suis Jeanne d’Arc, ça pleut, ça pleut en permanence ! » Mais bon, il n’y a pas de règle. Moi, j’ai juste beaucoup de chance de ce côté-là. Dans Picsou, je suis Cousin Gontrand, le mec qui a du pot. Gontrand il sort dans la rue, il se prend une brique, la brique se pète, il y a trois diamants dedans, voilà. Au niveau de la création, de l’inspiration, ça tombe.
S.F. : C’est une question de sensibilité ?
Manset : Ça, c’est être un artiste ou pas. Des gens sensibles il y en a, ce n’est pas pour autant qu’ils arrivent à créer. J’ai connu beaucoup de gens qui avaient toutes les compétences de sensibilité, et qui n’arrivaient pas à pondre plus d’une page. C’est d’ailleurs un des grands marasmes de l’époque : on les entretient dans cet état-là avec toutes les aides, toutes les subventions depuis Malraux et ses Maisons de la Culture. Moi, j’ai toujours été partisan de l’idée qu’un créateur n’a besoin de personne. Au contraire, plus les conditions sont difficiles mieux c’est. Sans ça il dégage. Aujourd’hui, s’il y avait un Rimbaud, il dégagerait. Il serait plus là.
S.F. : Il ne passerait même pas par la case poésie ?
Manset : Non, il ne passerait par aucune case sociale d’aujourd’hui, il serait rebelle avant d’être auteur et il aurait dégagé, il serait en Somalie dans une O.N.G. quelconque. Définitivement, à 20 piges, il serait parti. Mais moi je suis de la génération d’avant, j’ai donc pu m’exprimer quand j’avais 20-30 ans à une époque où le monde ne s’était pas encore cristallisé sur toutes ces imbécillités culturelles récurrentes. Donc, je continue. Mais j’aurais 25 ans aujourd’hui avec Animal On Est Mal, je finirais en Somalie !
« Je crois à une sorte de damier de la création »
S.F. : Tout à l’heure vous parliez de votre admiration pour l’inspiration féconde de Charles Trenet. Mais vous avez aussi dit que Léo Ferré vous plaisait beaucoup, que c’était un grand poète, qu’il ne s’agissait pas de savoir s’il était bon ou mauvais, mais qu’il fallait le prendre en bloc ou pas du tout parce que c’était un génie, un écrivain, un créateur.
Manset : J’ai dit ça il y a une dizaine d’années. Effectivement, Léo Ferré c’est quelqu’un dont j’admire l’expression scénique, vocale. La transe ! Parlons de transe, comme Brel, c’est une histoire de transe, une sorte de chaman. Mais c’est une sorte de mauvais rêve aussi, la transe, car lorsque l’on s’en réveille, au fond de la batée, question inspiration et création, il ne reste pas grand-chose. Brel a quelques chansons très belles, mais c’est surtout un homme de scène qui a effectivement pété les plombs, qui émouvait énormément dès qu’on le voyait mais dès qu’on sortait de la salle et qu’on se retrouvait dans sa bagnole pour rentrer chez soi, ça disparaissait, c’était un peu du vent, très peu de chose. Ferré, c’était un petit peu mieux parce qu’il y avait plus de texte. Mais il pêchait par son côté déclamatoire, répétitif et son côté fêlé. Moi, je me suis toujours méfié du côté fêlé, même si c’est l’apanage de tous les gens de ce métier, car dans le showbiz il faut être fêlé pour monter sur scène, chanter ses machins, lever le bras…
S.F. : C’est pour cela que vous ne montez jamais sur scène ?
Manset : Simplement, je ne suis pas fait pour ça ! Je ne suis pas comme ça !
S.F. : A quel niveau se joue votre transe ?
Manset : Ah ! Ma transe est strictement jouissive au premier degré, comme tout le monde, comme le pécheur de goujons qui va y arriver tout seul : il fout son asticot, il en voit quatre en transparence dans les dix centimètres d’eau, il balance son machin, putain le premier goujon, il voit l’asticot qui disparaît, il monte… voilà ! C’est simplement ça. Dans cette histoire, il n’y a pas de côté créatif, mais il y a quand même une sorte de cadre, de panorama où il faut respecter un certain nombre de paramètres : de la lumière, de l’heure, de la solitude… Et il faut le trouver ce coin ! Dans cette recherche du goujon, il y a une sorte de débusquage de l’inspiration. La jouissance vient du fait de débusquer une sorte de gibier qui serait l’inspiration. Ça, c’est le cas d’une bonne partie des auteurs.
S.F. : Y a-t-il une dimension artisanale dans cette quête de l’inspiration ?
Manset : Non, là on n’est pas dans l’artisanat, on est dans la magie, on est dans le chamanisme dont je parlais tout à l’heure, sauf que moi je suis un chaman très froid, je ne me laisse pas du tout aller à cette transe.
S.F. : C’est une transe austère.
Manset : Oui, austère, on est d’accord. Je suis plutôt jésuite que chaman.
S.F. : On parle beaucoup de chamanisme en ce moment. J’y vois comme un fantasme d’ouverture totale, à l’autre, à soi, à la Nature. Comme l’utopie d’un retour à une communication totale et primitive. Comme quoi il y a manque terrible de communication dans notre société dite « de communication »…
Manset : Les gens ne vivent plus, on leur a tout retiré, mais ça c’est votre génération. Tout le monde accepte, c’est votre problème d’accepter.
S.F. : Vous cherchez à remédier à ça ?
Manset : Non, je ne cherche rien. Moi, je suis un vague témoin, c’est une sorte d’aspirine ce que je fais, une sorte de remède pour ceux qui ont le désespoir qui leur colle aux basques, qui ne comprennent pas la marche en avant de ce monde qui va au fiasco le plus complet sur le plan de la communication. Je suis pour ces gens qui, dans leur petite solitude, seront peut-être rassérénés de trouver quelqu’un, non pas qui leur explique le pourquoi ou le comment, mais qui témoigne que ça n’a pas toujours été comme ça.
S.F. : Vous mettez une forme d’espoir ici…
Manset : Peut-être. Tant mieux si on le prend comme ça. Est-ce qu’il y a de l’espoir dans ce que je fais ? Si c’est le cas c’est indépendant de ma volonté et il peut en effet résider dans le fait de dénoncer clairement que le monde n’a pas toujours été ce qu’il est aujourd’hui. Alors, on peut peut-être avoir l’espoir qu’il redevienne un jour comme il a été. Je ne sais pas par quel cataclysme, quel raz-de-marée, quelle décennie ou quelle nouvelle génération ça peut arriver, mais en tout cas voilà : ça n’a pas toujours été comme ça, il y a eu un monde sans politique, sans déclarations permanentes, sans démagogie, sans communication, sans business et sans profit !
S.F. : C’est ça aussi le « langage oublié » ?
Manset : Avant on mettait 6 mois à conclure, pas 15 minutes. Il n’y avait pas de goujateries, de vulgarité, de business et de pognon. Je me sers donc de ce « langage oublié », qui est une sorte de langage galant et délicat vis-à-vis de la femme, pour dire comment le monde a changé. On pourrait décliner ça sous toutes ses formes car cette sorte d’approche sensée, était dans tout : les sciences, les arts, la famille, la société…
S.F. : Vous dites que cet album n’est pas exotique pourtant j’ai l’impression qu’il parle pas mal d’amour et de sensualité, thèmes que vous avez, je crois, peu abordé avant et qui sont donc des éléments un peu « exotiques » dans votre œuvre. (Pour ne pas dire « exotiques » tout court au vu de nos vies, du monde d’aujourd’hui.) D’ailleurs en écoutant ce disque j’ai pensé à des toiles de Gauguin…
Manset : Ah ! Gauguin oui, c’est aussi un de mes maîtres à penser ! Mais Gauguin était quand même une sorte de fou furieux lâché dans la nature, éminemment sensible, productif et créatif, inventeur d’un univers pictural unique, qu’il a défriché lui-même. Il a refusé le monde pour se trouver. De nos jours, il serait tout sauf politiquement correct. Je ne sais même pas si, aujourd’hui, il pourrait s’exprimer.
S.F. : Comme Rimbaud ?
Manset : Pire que ça. Parce que Rimbaud, à la limite, n’aurait personne à ses basques, tandis que Gauguin, pour quantité de raisons, n’aurait même pas le droit de cité.
S.F. : La pochette de cet album reprend une toile de Magritte. Pourquoi ce choix ?
Manset : Magritte est un surréaliste auquel j’ai souvent pensé… J’ai pris cette toile parce que je voulais quelque chose de très doux, très poétique, pour poser sur un album que je pensais être un peu plus hard qu’il ne s’avère être… Et puis Magritte a titré toutes ses toiles avec des noms qui pourraient être des titres de mes chansons. D’ailleurs je suis plus dans ce registre d’exposition de peintures, tous mes titres étant comme des toiles différentes, à la Magritte justement. Une sorte de diaporama dans lequel on entre.
S.F. : Quels sont les autres peintres qui vous plaisent ?
Manset : La peinture s’est écroulée après Picasso. Quelqu’un comme Combas, je suis assez étonné par sa quantité d’invention, sa permanence dans l’inspiration, je trouve ça très bien, mais on est plutôt dans la BD, dans la pub, dans l’art graphique, on n’est pas du tout dans la démarche picturale d’un Poussin par exemple. C’est peut-être révolu tout ça, mais le reste ne m’intéresse pas. Je crois à une sorte de grille artistique, de damier de la création dans lequel il y a des cases à remplir. On dirait : « Les nourritures terrestres ? » Un mec lève le doigt, c’est Gide : « Je l’ai ». On dirait : « Les filles de feu ? », Nerval au fond : « Je l’ai ». Et la case est remplie, on n’y reviendra plus. Voilà, moi j’avais une case, c’était Le Langage Oublié et je l’ai fait. Et il n’y a jamais eu ça sur des Nougaro ou des Léo Ferré, je suis sur un autre registre.
S.F. : Vous êtes sur un autre registre que Léo Ferré ?
Manset : Oui, bien évidemment, parce qu’ils ne font pas partie de l’univers absolu de la création, de la grille finie. Moi, oui. Je suis du sang des Nerval, des Rimbaud, des Bonnard, je le sais maintenant. Mais écrivez-le avec parcimonie. Parce qu’il y a un truc que vous ne visualisez pas (c’est normal, c’est une question d’âge et de génération) c’est que vous êtes abreuvés en permanence par des sortes d’amalgames, ce qui n’avait pas lieu d’être avant. Avant un professeur d’Académie c’était un professeur d’Académie, un orchestrateur c’était un orchestrateur. On ne va pas confondre Daniel Barenboïm avec Air. Maintenant on confond Barenboïm avec Air. On donne la légion d’honneur aux deux, on leur parle de la même manière. On met tout dans le même sac. Barenboïm non plus n’est pas dans le registre de l’univers artistique absolu avec un grand A. Pas plus que Air. Or il se trouve que moi, aujourd’hui ça y est, j’y suis.
S.F. : Maintenant, pas avant ?
Manset : Oui, c’est récent. C’est avec le recul que je vois ce que j’ai fait, ce qui s’est passé, je le vois de l’intérieur. Mais je n’en suis pas plus fier pour autant, c’est un fait, comme si j’avais une bosse ou une troisième jambe. J’en suis très content parce que je le vis, c’est comme si j’étais dans la peau de quelqu’un d’autre. Je le vis de l’intérieur, donc ça m’amuse de le vivre, mais en même temps il est probable que tout ça n’ait malheureusement pas de destinée. C’est ça « Le langage oublié », c’est-à-dire que c’est fini : il n’y a plus de peinture après Picasso, il n’y a plus de musique après Brahms, il y a peut-être Dvořák et encore c’est peut-être déjà une sorte de clone. Il n’y a plus de musique. Par contre on a eu des figures qui ont beaucoup compté. Par exemple, on a eu Lennon. Avec ses 10 années subversives, il a rempli une case. Le Rimbaud de notre génération c’est Lennon, ce n’est pas Mc Cartney, qui a produit trois fois plus, et qui va continuer encore....Manset en soi.
***************************************************************************************************************************************************************
Retour du voyageur solitaire avec «le Langage oublié», album sédimentaire.
Il attend comme on l'attendait. Tennis, blouson et verres fumés, tel qu'il s'imagine énigmatique à lui-même, en Corto Maltese de Calcutta, 58 ans, aussi beau que Larbaud le cosmopolite, cet homme «dont l'horizon s'étend bien au-delà de la ville», garçon de bords de Marne en Lewis Carroll des artères de Manaus, Amazonie. Ce jour-là encore, personne ne l'a vu venir. Il attend là, dans une salle de réunion de sa maison de disques, coincée au bout du pont de Boulogne, parce que «comme ça on ne sera pas gênés par la musique des cafés».
Lui absent six ans, ses chansons auront continué à se diffuser, via Jane Birkin, Indochine, Raphaël ou Juliette Gréco. C'est là qu'on mesure ce que sont les couplets de Manset, soustraits à l'hermétisme orchestral de leur père. Sans voix compressée, guitares de malaise et chambres d'écho, qui rebutent autant qu'elles font le style de Manset depuis trente-cinq ans. Comme une figure dont les difformités font qu'on la découvre à chaque regard. Un désir étranger, figé, auquel on revient pour en forcer la grille.
Conçu ces trois dernières années entre trois studios parisiens, parallèlement à un autre projet enfoui, ce dix-septième album s'expose hybride dans l'écoulement du temps et la lumière d'un jour égéen. Magritte en surface d'un blues rock progressif (Demain il fera nuit), reggae bancal (Mensonge aux foules) ou litanie folk désossée (Que ne fus-tu), s'appuyant toujours sur une architecture en couches déstructurées, la prophétie de nostalgie zinc réac («Ce monde est celui de la dérision/On substitue le mal au bien») croise Manset au nerf de l'intime. Dans les creux de cette «langue oubliée/Dont l'encre même a l'air d'avoir fondu» se dit la plus vive déclaration qui se puisse sur le catafalque. Etrange voix sur piano et cordes d'Orion : «Quand on perd un ami/C'est peut-être qu'il dort/Dans un autre univers/De gel et de bois mort.»
De quel langage parlez-vous dans «le Langage oublié» ?
Dans le Tour du monde en 80 jours, Jules Verne fait le portrait d'une femme indienne que les héros délivrent d'une tribu barbare à leur arrivée en Inde. Pour moi le langage courtois, c'est ça. Aussi dans l'Assommoir, lorsque le couvreur essaie d'approcher la femme avec qui il fera sa vie. Une page et demie pour les trois mots qu'il lui dit debout à une terrasse de café. Cette tchatche avant la tchatche, c'est ça le langage oublié : ce raffinement, cette précision, cette délicatesse, ces non-dits quand la femme était la femme, et l'homme, l'homme.
Le langage est-il oublié, ou vidé de sens ?
Oublié. De même qu'on ne peut plus lire un bouquin de plus de trois pages, on ne pourra bientôt plus écouter un morceau de plus de deux minutes trente. Et cette reconversion, je ne la fais pas.
De quelle école êtes-vous ?
Victor Hugo. Pour moi l'horloge a dû s'arrêter en classe de sixième. Des amis m'ont ensuite mis en main des ouvrages comme Céline, Gauguin. Voyage en Orient, je l'ai lu de moi-même. Puis j'ai découvert le Nerval des Filles de feu au détour d'une critique. Mais très peu de choses me marquent. Je fais mon miel d'une page et demie.
«Le veuf, l'inconsolé...», c'est vous ?
Pas «le veuf» mais «l'inconsolé», oui. Ce sentiment de perte est d'ailleurs assez récent. A 30 ans, je ne l'avais pas. La sensation était de l'ordre du momentané, du provisoire, de ce qu'on avait perdu la veille. Mon impression est plus grave aujourd'hui. C'est ce que l'humanité a perdu avec la Grèce antique. On a tout perdu. Inconsolé, inconsolable ? C'est la chanson «Que ne fus-tu une autre mère». Cette mère de l'âge d'or vers qui on ne peut même pas se tourner pour lui reprocher son mal-être. Car tout était beau dans l'enfance.
C'est autobiographique ?
Non, mnémonique. Voilà. Ça ressort, ça suinte, ça transparaît. Ce sont des choses de moi mais tellement labourées, recouvertes, ensevelies, de couches et de couleurs différentes, que chacun peut finalement y retrouver des parcelles. Dans le courrier que je reçois, chacun a l'impression d'avoir écrit Vahiné ma soeur.
C'est ça une chanson réussie : un creuset ?
L'expression me révulse. Mes textes me sont toujours venus au fil de la plume, en temps réel, après maturation, saturation, macération. Que ne fus-tu une autre mère, le titre est sorti comme ça. J'ai écrit trois phrases, pris la sèche et play-record. C'est tombé tout seul, en deux minutes. Mais, au niveau de l'énergie, c'est épouvantable : j'en sors vidé. Ensuite je tourne en rond la moitié de l'après-midi.
Le danger de perdre le fil ?
Oui. Tant que les trucs déferlent, je les prends. Mais ce n'est pas systématique. Le Langage oublié, j'en ai trois ou quatre versions, dont certaines «voix-guitare» à la manière de Jean Sablon ou Henri Salvador. Les deux m'intéressent, le croquis sur un coin de table et la toile de Poussin sur 10 m2.
Dans quel état écrivez-vous ?
J'ai toujours un carnet sur moi, car je sais le prix de l'inspiration. A Paris, je descends vers huit heures prendre un crème, je lis le journal, je regarde ce qui se passe. Je marche, je vois des choses, des conneries, je ne parle pas. J'ai encore des rêves en tête, des milliards de trucs, des souvenirs. Et, souvent en traversant une rue, une phrase me vient, sans lien logique. La fonction créant l'organe, à peine ai-je commencé à la noter que l'encre part. Là, je remonte et je prends la «sèche». Il est 9 h 30-10 heures.
Une ivresse du passé ?
J'avais fait un texte pour le passage à l'an 2000 sur un petit garçon des bords de Marne. Je suis toujours celui-ci. Ceux de ma génération ont vécu un truc extraordinaire. Moi, à 10 ans, j'allais chasser le rat sur les quais de la Seine avec ma carabine à plomb. Je rentrais à dix heures du soir et personne ne s'inquiétait de ce que faisait ce garçon. Voilà, on a connu la liberté. Aujourd'hui, il y a des massues et des pièges de tous les côtés.
Nostalgique ?
Si vous interrogez Vincent Bolloré ou Pierre Lescure, tous vous diront qu'ils sont nostalgiques de cette époque. Aucun garçon de 30 ans ne peut plus vivre ça aujourd'hui. La musique était merveilleuse. Et la campagne française... On prenait sa bagnole, les routes étaient désertes, les petits villages... Il n'y avait pas un bruit, pas une ligne jaune, rien. Et puis, il y a mes souvenirs. Toute cette enfance où j'ai été tellement libre et solitaire, j'en suis marqué, imprégné. A tel point que ces émotions remontent quand je me balade. J'ai retrouvé ça aussi dans mes voyages. Jamais je n'ai lu un guide, je sors de l'avion et j'y vais pif au vent. Les choses s'ouvrent comme dans ces petits livres d'enfant où les pages s'ouvrent en cathédrale, en panorama, en rivière, en village...
Et la musique ?
A 20 ans, j'écoutais beaucoup de classique, Beethoven surtout. Je n'en écoute plus. A quoi ça sert d'écouter des choses aussi magistrales, on en est tellement loin. Comme dans les rêves, on a toujours l'impression que c'est tout proche, que demain il suffirait de s'y mettre. Mais il y a une architecture, une connaissance pharamineuse. Les auteurs-compositeurs d'aujourd'hui me font penser à un type qui entrerait dans un amphi de maths spé en prenant la craie pour rectifier des équations comme si c'étaient simplement des dessins, une suite de signes sans sens ni hiérarchie. Ça ferait rire tout le monde, on l'enfermerait.
L.PERRIN Libération 1/3/2004
********************************************************************************************************************
Manset ne donne pas de rendez-vous. Tous les trois à cinq ans, il livre un recueil de chansons comme la suite d'un journal commencé en 1963. La démarche est on ne peut plus éloignée du circuit de la musique, de la promotion et plus généralement des médias. Il n'accorde que de très rares interviews. Et uniquement pour la presse écrite...Il a tendance à vous appeler personnellement, vous donne rendez-vous un matin, dans une brasserie, porte d’Auteuil. Il préfère connaître son interlocuteur, l'avoir déjà lu, comme s'il voulait savoir la matière voire la solidité de la passerelle qui existe à ce moment-là entre lui et le public. Physiquement, Manset ne change guère. Pourtant, l'homme n'aime toujours pas se montrer, même si chaque sortie de disque le rend avide de parler, de s'expliquer, d'écouter les réactions. Et si les rencontres avec lui sont très exceptionnelles, elles sont aussi extraordinairement denses.
Le langage oublié
Il nous avait quittés, à la fin 1998, sur « Jadis et naguère. », il revient avec « Le langage oublié », son dix-septième opus original, comme si la référence au passé devenait de plus en plus une constante. Gérard Manset n’aime-t-il pas souligner que « c'est toujours le même texte qui continue ». Ce nouvel album, il a fallu, mine de rien, attendre plus de cinq ans. Jamais il n’avait été à œ point infidèle. « Depuis quinze ans, je fais de la rétention artistique» admet-il. Question de tempérament. Mais c'est lié aussi à la marche du monde qui fait que plus ça va, plus il faut faire attention à la manière dont on dit les choses. Il n’y a plus que les fous furieux qui se permettent, sans réfléchir d’aller au-devant des marées populaires. On entre alors directement dans le discours de l’artiste. Nous y reviendrons. Car plus encore qu’une question de fond, la raison principale à ce « décalage » temporel est technique. »Je suis viscéralement attaché à l’aspect technique puisque j’ai démarré par là. Dans La Mort d’Orion, il y a tout un tas de procédés musicaux inventés. Aujourd’hui, notamment avec le numérique, beaucoup de choses ont changé. Ça prend donc du temps car il y a peu de personnes compétentes ou alors elles n’en ont rien à foutre de travailler avec ma génération. »
Manset distingue plus précisément cette jeune génération maniant parfaitement les nouveaux outils technologiques et musicaux, qui ont leur univers personnel (il cite le groupe Air), avec laquelle « il y a un fossé ne serait-ce qu’au niveau des contacts ». Et les arrangeurs, orchestrateurs, preneurs de sons ayant leur home-studio, « mais aussi leurs manies et leurs ego ». Guère compatible avec ses propres exigences. Résultat : « Il s’est produit ce que je redoutais. J’ai été obligé de m’y mettre pour maîtriser tout ça. J’avais pourtant autre chose à faire. »
Mais le perfectionnisme extrême du bonhomme lui impose cette épreuve : « Là où certains se contentent de trois-quatre sons, il me faut quatre cents couches. » Gérard Manset est un artisan, un alchimiste du studio qui n’a rien à voir avec l’à-peu-près. Il regrette aujourd’hui de ne pas avoir, à ses côtés, un complice avec lequel il pourrait avancer comme, dans les années 70, Jean-Paul Malek. Avec cet ami d’enfance, il avait fondé un studio d’enregistrement : le studio de Milan. « On me montre un truc, ça dure quinze secondes, je pars avec et je bosse dessus pendant six mois ! Je ne peux pas faire entrer des gens là-dedans. » L’historien de la musique devrait se régaler de ce cas unique. Depuis 1968, Manset écrit, compose et interprète à peu près de la même manière, au gré de l’évolution des technologies.
Il en bave donc durant trois longues années avec des titres à moitié terminés. Car il hésite à travailler les orchestrations comme il en a envie. Il estime ne pas posséder les éléments nécessaires. Juste avant de « tout foutre à la Seine. », il tombe sur le studio Damien à Paris et sur un certain Nicolas, « un jeune presque aussi emmerdeur que moi au niveau du résultat »…Manset retrouve une terre solide et non plus « la sensation de marcher sur l’eau. Nous avons tout remis sur la table en trois semaines. Il n’y a eu aucune erreur. »
D’un matériau bizarre
Entre-temps, une nouvelle personne est apparue dans son monde musical. Elle se nomme Caroline Manset. C’est sa fille, entrée dans la musique en tant que manageuse et directrice artistique du chanteur Raphaël. « Elle est arrivée subrepticement, presque à son corps défendant, en chatte un peu terrorisée qui vient flairer un bout de barbaque en se demandant s’il est frais ou pas. Avant elle, personne n’était venu au studio, mais je voulais avoir une opinion comme j’ai eu quelquefois l’avis de sa mère. Les femmes sont très sévères. C’est le meilleur garde-fou. Et Caroline a ce regard jeune doté d’un exceptionnel sens artistique à l’état brut. Elle a hérité du labyrinthe tortueux de papa. » Il y a eu quelques « échanges » entre le père et la fille lorsque celle-ci, sur certains des titres, préférait une version plutôt qu’une autre, dans les multiples enregistrées…avec des guitares différentes, des batteries recalées à la croche prêt…
Et les textes, l’os de l’aventure ? « J’ai beaucoup de choses d’avance à l’état de paroles et musiques. J’ai toujours cette stupéfiante inspiration qui, quand j’y pense, me surprend toujours. Je ne sais pas d’où ça vient. Personne aujourd’hui n’a de pareils thèmes. Je suis fait d’un matériau bizarre. » Sur cet album, deux-trois thèmes se dégagent : une certaine tristesse devant un monde qui part à vau-l’eau, l’espoir d’un monde nouveau et ces points d’appui essentiels que sont l’amour et la femme. Des thèmes guère surprenants pour lui, qui trouvent leur originalité dans la manière de les traiter (voir Disques)
Cela fait quelques disques que Manset se lâche sur une « époque à vomir ». Une des surprises du Langage oublié est le « Mensonge aux foules », chanson directement politique aux paroles on ne peut plus claires : « On préfère laisser le sol en friches / Aux dirigeants qui pillent, dirigeants qui trichent ». Et si on lui demande ici d’aller plus loin sur « les raisons de ce merdier », il aligne la lâcheté des dirigeants, leur imbécillité à ne pas s’entourer de ces gens compétents que sont les chercheurs, scientifiques, prix Nobel…Il aligne la surpopulation, la surrèglementation : « Quand est-ce que les jeunes vont s’en rendre compte et foutre le feu aux poubelles ? Bien sûr qu’il faut des lois…Mais des lois bouddhistes, contre la violence ».
Je crois en l’Éden
De ses voyages (moins fréquents), notamment en Asie, il ramène toujours des images qu’il aime comme celle de ces petits écoliers thaïlandais qui s’inclinent en passant, un à un, devant leur maîtresse d’école… « On s’imagine que c’est un discours rétrograde, réactionnaire. C’est simplement l’amour pour ses parents, les enseignants, les institutions, son pays…C’est le respect. » Sur l’exil, il a chanté il y a quelques années une chanson extraordinaire, mais il avoue avoir la valise trop pleine pour partir sans retour. Croit-il vraiment au monde nouveau qu’il évoque ? « On peut imaginer qu’il vienne, peut-être. Je crois beaucoup à Dame Nature qui sait réguler son histoire. Mais je ne pense pas à des catastrophes. Plutôt à une autre génération. Une intelligence qui se réveille…Je crois en l’Éden. Un monde où l’on n’aura pas besoin de parler pour se comprendre. » Quant à la femme et l’amour, ils se retrouvent justement dans le titre « Le langage oublié », c’est-à-dire le langage amoureux, « une approche très délicate et très sensée qui n’existe plus. L’amour est peut-être encore la seule chose incontrôlable, incontrôlée, irrépressible ».
Manset considère son nouvel album comme l’un de ses quatre ou cinq meilleurs. Et comme il n’est jamais le dernier dans l’autocritique, il se reproche, encore, de manquer un peu de légèreté. « Le premier jet peut l’être, mais ensuite… » Il trouve également ce disque un chouïa trop dense. « On trouve toujours que je ne propose pas assez de titres. Je suis donc allé jusqu’à dix. Ça fait un peu chargé…Idéalement, j’aurais préféré trois CD de trois titres. »
A 58 ans, Gérard Manset ne parait pas vieillir….D’ailleurs, il dit ne pas penser à la mort : « J’ai toujours eu cette sensation d’être pris dans un temps figé…Je crois qu’il faut que les choses arrivent sans qu’on le sache…Dans le bouddhisme, la mort est résolue puisqu’il n’y en a pas. » S’il veut sortir plus vite son prochain album, il ne tire toujours pas une croix sur de potentiels concerts : « C’est open…Si demain un acolyte me propose de tout prendre en charge… »
Manset est une légende. Les légendes ont la vie dure ; pourtant l’époque est cruelle pour la mémoire. Cinq ans après, son public ne s’est-il pas effiloché ? Et dans dix ans ? « Je n’ai pas d’ego à ce niveau-là. Je préfère vivre une vie totalement anonyme. Par contre, quand on met quelque chose en chantier et qu’on le fait sortir, il est difficile de se dire qu’on ne va pas le défendre, même si on a beaucoup de difficultés à le faire. Je n’ai pas envie que ce Langage oublié ne serve à rien parce que j’y ai quand même consacré plus de cinq ans de ma vie ».
« Auteur pour les autres »
C’est ma fille Caroline qui m’a un peu boosté là-dessus. Elle m’a suggéré l’éventualité d’écrire pour Raphaël. Elle m’a aussi glissé que Gréco (1) allait enregistrer un album : le texte m’est venu en marchant ; je me suis mis dans la tête d’une petite fille…Même si en même temps c’est toujours pour moi. Pour autant, je mesure le risque : l’interprétation de Raphaël est très bien et j’adore son univers mais j’ai été très frustré par son Rimbaud (2). Les équipes qui ont bossé pour lui n’ont pas été capables de reproduire la rythmique. Ça devient une belle ballade mais par défaut ; moi je n’aurais pas accepté cela…Françoise Hardy aime ce que je fais et j’aime énormément son timbre de voix ; mais dans la chanson qui m’est venue pour elle, elle n’a pas trouvé ce qu’il lui fallait. J’en ai écrit aussi une très belle pour Dany, qu’elle n’a pas enregistrée. Ça ne me gêne pas. C’est quitte ou double. »
NB : Gérard Manset avait déjà écrit pour Jane Birkin (« Si tout était faux », CD A la légère, 1998, Mercury) et pour Indochine (« La nuit des fées », CD Paradize, 2002, Columbia)
1- « Je jouais sous un banc », CD Aimez-vous les uns les autres ou bien…2003, Polydor
2- « Être Rimbaud », CD La Réalité 2003, Capitol
Article paru dans « Chorus » n°47 du printemps 2004 signé Michel Troadec
**************************************************************************************************************************
Gérard Manset : Le Langage oublié
Paris 19/03/2004 -Personnage à part dans la chanson française, Gérard Manset vient de publier son nouvel album, Le Langage oublié, qui vient presque six ans après son disque précèdent, Jadis et naguère. Secret, exigeant, ayant refusé jusqu‘à présent l'idée de jouer sa musique en public, il parle peu.
Mais c'est toujours avec une franchise et une puissance de feu étonnantes.
Manset ne cache pas son désir de livrer des disques apaisants, qui apportent un baume sur les souffrances et l’ennui de la vie contemporaine. « Ce disque-ci est moins sombre, prévient-il. Les thèmes sont tragiques mais le ton est peut-être plus prophétique, plus à distance.» Dans Le Langage oublié, il est question d’un monde disparu, et disparu depuis peu : la dilution de valeurs sur lesquelles vivait l’Occident depuis des siècles, que la brutalité d’une Société télévisée et « transparente» a rendu désuètes. « On est dans le mensonge permanent. Je ne pense pas que ce soit délibéré. Je ne pense pas qu'il y ait un responsable réel, ou des responsables ayant décidé de laisser circuler cette sorte de mal-être de plus en plus grave. Je pense que c'est inconscient, personne ne se rend bien compte. C'est Pandore, et la boite a été ouverte.»
Il a fallu du temps, depuis Jadis et naguère en 1998, pour que Manset sorte un nouveau disque. Mais ce qui l‘a retardé n’a rien a voir avec des problèmes d'inspiration: « Je ne voulais pas sortir un album comme Jadis et naguère ou La Vallée de la paix, mais faire une petite avancée dans le sens du numérique.» Et Manset est volontiers autarcique: auteur, compositeur, interprète et réalisateur de ses disques, il en est aussi, en général, l’ingénieur du son. Cette fois-ci autant que les précédentes, mais avec une nuance de taille: « En fait, ll y a avait un disque qui devait sortir l’année dernière, et que j'ai laissé de côté pour des raisons d’ordre technique. Sur le plan du son, nous sommes à une étape charnière avec le passage de l'analogique au numérique. ll n’y a presque plus de magnétophones analogiques, presque tout se fait sur Pro Tools mais il n’y a quasiment personne de compétent dans le domaine. Alors il m’a fallu réendosser la panoplie du preneur de son et de l’ingénieur C'est un peu fatiguant à mon âge de tout recommencer à zéro: ça a pris une ou deux bonnes années de plus. Comme je fais beaucoup d'images, je travaille depuis longtemps sur le logiciel Photoshop. Je n'aurais pas admis que Pro Tools ne soit pas aussi performant. Or ça l'est mais, en général, la hotline ne répond pas ou n’a pas la solution.»
Manset, dont le perfectionnisme est légendaire, a plongé dans les arcanes du logiciel Pro Tools, qui gouverne aujourd'hui la majeure partie des studios d’aujourd’hui, de la prise de son au mixage. « J'ai fait une petite incursion dans l’électronique qui élargit un peu le débat, éloigne des années 70. J‘ai fait ce travail sur quelques titres, Demain il fera nuit, Le Langage oublié (il y a dix ou quinze ans, je n'aurais pas pu avoir ce nombre de couches sonores successives, comme ce que j’avais fait sur Jeanne la Folle sur l’album Long long chemin ou sur Animal on est mal), A un jet de pierre et Quand on perd un ami.» Là, il entasse les couches, les sons, les textures d’une manière à la fois neuve et conforme à son univers sonore habituel - grandiloquences, vifs raccourcis, guitares acérées, claviers planants, voix doublées...
Et soudain, la chanson Que ne fus-tu évoque sa mère: « Comme je pense toujours à la scène, je voulais mettre dans ce disque un titre comme celui-ci, qui est une création en une prise. J'avais quatre phrases de jetées, j'ai pris ma sèche et, dans la foulée, en une prise, j'ai fait la chanson. C'est une trace de ce qu’est l'inspiration: il n’y avait rien trois minutes avant; et trois minutes après la chanson était faite.» Curieuse chanson, au demeurant, qui cherche derrière le bonheur d'une enfance sans nuages les racines d'une douleur d‘adulte: « Très bizarrement, je me suis aperçu que ce texte donnait l'impression de dire absolument le contraire de ce qu'il dit. C'est étrange que la langue soit ainsi déviée de son sens: je dis très précisément quelque chose de laudatif et on n'en reçoit que la décharge inverse. Je dis: « tout fut doré» - qui incriminer de ce mal-être, qui est celui de tout le monde, s’il n’y a même pas quelque à reprocher au sein de la cellule familiale, et plus précisément à la mère, si tout était parfait?
Puisque aujourd'hui il faut trouver des coupables à tout, que fait-on quand il n’y en a pas? Je revois ma mère me berçant avec « Couronnés de thym et de marjolaine/Les elfes joyeux dansent sur la plaine» de Leconte de Lisle, ma tante jouait Chopin. Certains ne doivent pas être abreuvés de beauté, de poésie et de bonheur ce qui peut être le moyen de les terrifier à vie d'avoir perdu ça ou de ne pas le retrouver c'est le problème de l'Eden, du paradis perdu.»
Ce paradis perdu, Manset n'en voit plus aujourd'hui que les décombres dans notre civilisation. « Pourrait-on revenir à un monde tel qu'il était il y a quinze ans, je ne sais pas. Mais on pourrait quand même limiter les dégâts.
Interdire l’affichage, soumettre la presse a une réglementation très stricte en ce qui concerne l'utilisation des images...» La télévision l’écœure, il ne trouve plus de plaisir au cinéma, s'ennuie dans la littérature actuelle, reproche à notre époque de vouloir partout et toujours la transparence: « Je ne crois pas qu'il soit bon de tout dire à tout le monde. ll y a des questions qui doivent rester sans réponse, et on vivait sur cet état de fait depuis cinq ou dix mille ans. En une dizaine d'années, on a passé tout ça par la trappe: maintenant, il faut une réponse pour tout, et surtout une réponse qui tienne en une ligne.»
Il rêve de solutions radicales, rêve de refontes majeures de nos sociétés: « Les dirigeants, une fois qu'ils sont élus, devraient être écartés de la vie publique, cesser d’apparaitre. Ça a l'air absurde mais c'est tout simple: on est élu? On disparait, on ne va pas sur les marchés, on ne répond pas à la presse, et le pays s'en porterait beaucoup mieux, je pense.» Et la musique? « J'ai vu la soirée des Victoires de la musique: c'est affligeant, un retour de trente ans en arrière, Régine à tous les étages..» Mais l’imprécateur balaye d’un geste son propre agacement devant l'état des variétés. Il revient à son ambition d’apaiser, d‘apporter soulagement et douceur à ses contemporains -
« Je ne veux pas donner l’impression d'être un censeur»
Gérard Manset: Le Langage oublié, 1 CD EMI.
Illustrations du livret : Mesdemoiselles de l’IsIe Adam, René Magritte, 1942
Bertrand Dicale pour RFI Musique
***********************************************************************************************
LES ÉMOTIONS DE MANSET
SAMEDI, 27 MARS, 2004 (L'HUMANITÉ)
Il n'a échappé à personne que le monde ne va pas bien. Ça n'a pas échappé non plus à Manset.
Sacrée question : que fait un artiste qui vit une époque sombre ? Que fait un artiste qui est à peu près ravagé par un temps qui semble voué à apporter de la misère et de la mort ?
Que fait un artiste qui a vécu la moitié de sa vie, et se rappelle les espérances de jadis ?
Il dit ses émotions.
Et ses émotions sont des images. Des images, des endroits où on peut se tenir, nous aussi, et dans ces endroits-là, remuent les chagrins, et les rêves.
Et l'artiste est grand, quand ses émotions à lui permettent à nos émotions à nous de se donner forme, quand on les ressent, à nous, et en même temps à d'autres, et que ces émotions n'enferment pas dans la stérilité du découragement, mais font danser de l'énergie qui donne le désir de transformer le chagrin en force, qui donne l'élan d'aspirer à un état différent, qui, du fond de la dépression, fait remuer le besoin exigeant d'une vie qui ne nous casse pas. C'est compliqué.
Parce que ce qui importe alors, c'est le jeu des contradictions.
Aujourd'hui, il y a foule de " sujets " en harmonie, si l'on ose dire, avec les douleurs actuelles : des guerres au sida, de la " mondialisation " au " devoir de mémoire "...C'est quoi, ce présent, ce sera quoi, notre avenir ? Qu'est-ce qu'on laisse aux enfants ? Ce n'est évidemment pas un hasard si l'enfant devient une figure centrale, tant dans la vie privée que dans les films ou les pièces : l'enfant massacré, ou l'enfant assassin, l'enfant est en danger, et l'enfant est dangereux... Tout comme ce n'est pas un hasard s'il y a aujourd'hui une sorte de fixation sur la " transmission ", ce qu'autrefois on nommait simplement l'éducation, la grande peur que les " adultes " n'aient pas su, pas pu devenir grands, et faire leur travail en faisant passer aux plus jeunes leurs valeurs et leur savoir, parce que, peut-être, leurs valeurs, leur savoir, étaient suspects au regard de la " modernité ", étaient périmés, étaient déplacés... Ah oui ! il y a du boulot sur la planche, pour les artistes et pour les autres, pour raconter ces peines et ces pertes et ces effrois, mais s'il s'agit juste de raconter que ça ne va pas, on s'en passe. Parce que c'est toujours plus compliqué. Qu'est-ce qui ne va pas, précisément ? Détaillons. Et dès qu'on détaille, on quitte la sentimentalité niaise pour le désir qui s'insurge. Ah ! Il y a bien sûr différentes façons de détailler.
Manset choisit de détailler son désespoir.
Et c'est ainsi que naît la contradiction, et c'est ainsi que l'on métamorphose
Le constat en chant de refus, en chant d'amour pour ce qui est dévasté, et qui en même temps se réinvente. Manset n'a jamais été une nature folâtre. Mais aujourd'hui, c'est l'Apocalypse qu'il décrit. " Demain il fera nuit / Et les enfants riront / En demandant pourquoi /Prolonger un peu plus /Ce besoin de vivre ". L'Apocalypse, dehors, dedans. " On voit la fin du dernier monde connu / La fin du dernier monde qu'on eut / La fin du dernier monde possible ", et un ami meurt, et la vie passe, et on a du mal avec soi, et le reste, il y a là des beautés, et il y a là des naïvetés, mais du fond de cette grande désolation, entre murmure intime et cauchemar de prophète, monte la musique, prière, transe, danse, la musique et la voix viennent donner aux mots un tremblé et un envol, viennent donner aux mots les vraies larmes et retournent la déploration en appel, c'est tout le corps qui part dans la voix qui s'élève, dans les guitares qui strient, et on est souffrant, mais à vif, et en nostalgie d'un monde à refaire, autrefois on parlait d'artistes " engagés ", mais tous les artistes sont engagés, engagés à vivre, et c'est parce qu'ils vivent les expériences les plus communes qu'ils peuvent devenir l'une de nos voix, et non parce qu'ils formulent des banalités de comptoir, ou de journal télévisé, c'est parce qu'ils vivent ici et maintenant, dans un monde douloureux et dans un corps qui vieillit, parce qu'ils acceptent les émotions ordinaires en en rendant sensibles la force, la vitalité, le rayonnement, qu'ils nous aident à vivre. Manset ici chante la douleur, celle de tous et la sienne. Et la musique chante ce qui nous fait défaut. Et la douleur, sans se perdre, devient insoumission à l'oubli d'un autre monde possible.
***********************************************************************************************************************
Gérard Manset dialogue avec Philippe Starck
DUO SUR CANAPÉ
Propos recueillis par FRANÇOIS ARMANET et I.AURE GARCIA
(Le Nouvel Obs, 28/02/2004)
Propos recueillis par FRANÇOIS ARMANET et I.AURE GARCIA
(Le Nouvel Obs, 28/02/2004)
Le plus secret des chanteurs français sort « le Langage oublié », un nouvel album crépusculaire, prétexte d'une rencontre avec un autre reclus : Philippe Starck, le plus célèbre des designers français, qui revendique l'œuvre de Manset comme une influence majeure
Régulièrement, Manset s'échoue sur nos rives et livre un album attendu par ses fidèles, « qui sauraient lire encore cette langue oubliée ». Depuis « Jadis et naguère », il y a six ans, l'ermite maniaque poursuivait le recyclage de ses disques et ses voyages en boucle (Marquises, Siam, Panama, Pérou ...) pour « vérifier que rien ne change ». Dans son dix-septième album: dix titres de guitares saturées, piano clair, orchestrations maison, lyrisme sidérant et obsessions. Manset cultive son jardin secret et joue de son mystère. Ni photos ni concerts, aucune manifestation publique.
Au printemps dernier, Manset apparaissait sur «Ombre », l'album compilé par Starck pour son exposition à Beaubourg. Parmi les musiques inspirant le créateur boulimique du Café Costes, de la brosse à dents Fluocaril, des restaurants Bon, de la maison Baccarat et d'un paquet d'hôtels luxueux autour du globe : « Le Paradis terrestre », extrait de « la Mort d'Orion », premier (sic) 33tours du chanteur. On apprenait alors que Starck, le grand communicateur, ne se sépare jamais de l'intégrale Manset. D'où l'idée d'un dialogue entre un bavard impénitent, exhibitionniste, lui aussi bricoleur de génie et enfant des beaux quartiers, avec le silencieux Manset, qui étudia aux Arts décoratifs avant de débarquer sur les ondes en mai 68 avec « Animal, on est mal ». Restait à les réunir, l'un en perpétuel voyage dans son jet privé, l'autre volontairement aux abonnés absents ...
Philippe Starck. La musique fait partie intégrante de mon travail. Avec en permanence un hémisphère en musique, j'ai une dette envers les compositeurs qui m'animent. Lou Reed, Laurie Anderson, mais surtout Manset. Le Manset est très pratique à l'usage. Dynamique quand je commence à mollir, ou mélancolique. Mon premier contact avec lui remonte à mes 20 ans, à l'époque du yéyé concon, quand j'entends chanter « la toile du maître fait deux mètres cinquante centimètres ». Ce fut totalement fugace : je n'ai jamais eu le disque, j'ai dû l'entendre trois fois dans ma vie, et il est devenu une obsession. « La Mort d'Orion » avait cette liberté totale : on y pénétrait comme dans un hologramme, un espace construit. Manset crée des fissures dans le langage, qui ouvrent des portes vers nos propres mondes. On s'engouffre dans les torsions de l'objet-son qui ressemblent à celles de l'espace-temps.
Gérard Manset, - Je suis sidéré, car Starck balaie mes doutes. On peut me cataloguer abscons, ténébreux, poétique, fumeux, mais bravo pour rationaliser ainsi ma musique, qui est réellement très cartésienne. Mais c'est peut-être parce que tu la définis dans le cadre particulier de ton travail.
Ph. Starck. - Je suis le lent le plus rapide du monde, et inversement. Je mets deux minutes à dessiner un objet que je ne retoucherai jamais, mais ça fait juste quarante ans que j'y pense. Je suis l'imprimante la plus perfectionnée qui soit, c'est pourquoi je n'ai pas besoin d'ordinateur. Je suis un fermier du magma au repentir inconscient.
G. Manset. - On va se revendiquer autodidactes. Je partage cette préoccupation de la rigueur. Je n'étais ni bon ni mauvais, anonyme. Les maths et les sciences exactes m'intéressaient pour leur quête de vérité ultime. En dessin, en peinture, c'est différent: la ligne pure n'est pas la bonne, il faut le repentir. Pour l'écriture aussi, le premier jet est bon à jeter. Il faut arracher des pages.
Ph. Starck. - J'ai passé toute mon enfance dans les portes cochères, à fuir l'école dans le stress le plus total, sur un banc du parc de Saint-Cloud où on a dû se croiser. Après deux ans cloîtré dans ma chambre, je me suis entièrement reconstruit, comme l'homme invisible met ses bandelettes. Etre autodidacte était vital. A côté de la rigueur, l'invention. J'étais aux Petits Chanteurs à la croix de bois, à Saint-Pierre de Neuilly. Par instinct ou séquelle de cette éducation, j'ai senti dans « Lumières » de Manset l'intuition avec un grand i. C'est le seul chanteur qui parle d'ailleurs et d'autre part. Ce qui m'intéresse dans son travail, c'est le non-dit, ces strates d'extrême violence, d'amour...
G. Manset. - On peut me taxer de parano, mais tout ce qui est dissimulé me va. Pas jusqu’à en faire un procédé, quoique ... J'aime les auteurs oubliés, la part enfouie de Gauguin ou de Céline. Il faut restituer le puzzle. Quand j'ai compris ça, je ne me suis plus montré physiquement. Qu'apporte l'image? Pas grand- chose. Je n'ai pas envie d'être juxtaposé, utilisé. Il faut le courage d'être rébarbatif. Toi, tout ce que tu touches se transforme en or.
Ph. Starck. - Mais je ne m'expose pas, la société m'expose! Elle a créé un Starck bis totalement mythique. Je vis seul avec ma femme, dans des endroits reculés, je ne vais jamais dans les cocktails. On ne va pas au cinéma, on vit en ermites. On s'arrange pour avoir de multiples maisons où l'on passe comme des fantômes modernes, il n'y a pas plus secret que moi. Ma fille me dit autiste, ma femme se plaint de ma disparition mentale permanente. En même temps, je veux absolument qu'on m'aime, alors je m'agite. Je ne peux pas m'empêcher de faire le clown, prêt à tout pour empêcher l'embarras des autres. Je fais partie de ceux qui parlent quand un ange passe.
G. Manset. - Je n'ai pas envie qu'on ne m'aime pas, mais je ne veux pas concourir. Je me dévalorise en permanence. Je navigue entre le malentendu d'être connu pour ce que je ne suis pas et définitivement méconnu. Tes chaises, stylos, paquebots ne parlent pas, c'est leur grande force ...
Ph. Starck. -Sauf quand on veut s'exprimer! Va faire dire quelque chose à un balai de chiottes. L'image ne m'intéresse pas même si je m'en sers. Ma façon de travailler se rapprocherait de celle d'Erik Satie. Très en retenue, basée sur la sensibilité ludique, la pudeur, la volonté de créer des surprises.
G. Manset. - Par comparaison, « le Langage oublié » ce serait, « les Mémoires d'outre-tombe », complexe, fourni, ennuyeux par certaines longueurs.
Ph, Starck. - Je suis un amoureux de l'ennui, mais le problème est que je n'y arrive pas. Je donnerais n'importe quoi pour m'ennuyer. Je pense même faire une chaine d'hôtels de l’ennui : mettre un immeuble haussmannien sur une plaine de Mongolie, afin de retrouver les qualités fécondes de l'ennui.
G. Manset. - J'ai la même propension à l'ennui, même si je ne m'en contente pas.
Ph. Starck. - Mon problème est de ne toujours pas être persuadé que j'existe vraiment. J’ai été pessimiste et même suicidaire. Je ne suis plus morbide depuis que j'ai réalisé que l'homme est avant tout un mutant : il l'a prouvé en passant d'une bactérie au vol en Concorde. On est aujourd'hui à mi-chemin de sa disparition, quand la Terre se vitrifiera. La bactérie n'avait aucune idée de ce que nous sommes, et nous n'avons aucune idée de ce que nous deviendrons, c'est fabuleux!
G. Manset. - Quelle gourmandise ésotérique! Tu es goulu, je suis dans la rétention ... Quatre lignes de Nerval suffisent à mon bonheur. Il ne faut pas se poser certaines questions. Il n'y a aucun mystère, on sera bouffé par les vers, voilà.
Ph. Starck. - Je peux me retirer dans une pièce de trois mètres carrés. Ma femme fait attention à ne pas me laisser dériver dans mes tentations monacales, carcérales. J’ai horreur de voyager, je ne supporte que le voyage intérieur, c'est pour cela que je multiplie les maisons identiques dans le monde. Que les draps soient pareils, que la nourriture dans les frigos soit la même, c'est un travail gigantesque. Je possède mon propre avion, décoré par moi, avec mes livres, ma musique. Je n'ai aucune curiosité extérieure. Je suis un rêveur solitaire. Le voyage est le contraire : il faut bouger, ça distrait.
G. Manset - Mes voyages commencent petit garçon, quand je me baladais dans la Marne, courant dans la nature. Du village, je suis passé au département, au pays, et puis partout ailleurs. J’aime le côté abscons du voyage, l'obligation de passer par l'apprentissage d'une langue. Ou alors la capacité de s'extraire du monde en marche, de l'actualité mécanique par le simple fait d'ignorer les idiomes rencontrés, donc de ne rien entendre et de se balader presque sourd.
Ph. Starck. - Je vis cette surdité avec mes proches qui ne parlent pas la même langue que moi. Ma femme est américaine, je vis professionnellement en anglais, mais je le parle mal, donc je suis complètement isolé.
G. Manset. - Je finis par oublier les langues que j'ai apprises. Je parlais le malais.
Ph, Starck. - Moi, je parle le malaise. La vie se passe entre marée basse et marée haute, c'est-à-dire dans la vase. On vit dans la lumière, on y tend, mais on sait bien que tout se crée dans les interstices, dans l'ombre. J'ai appelé mon exposition de Beaubourg « Ombre », pour que les gens reconnaissent l'ombre comme un terreau extraordinaire, où se déplacer librement. D'ailleurs, il y a toujours une malédiction de l'homme sans ombre. En Asie, le contour et le vide apprennent davantage sur la chose que la chose elle-même.
G. Manset. - Aujourd'hui, hélas, c'est incorrect de ne pas préférer la lumière. Que faire, sinon pleurer sur le passé, sur le langage oublié...
************************************************************************************************************************
Les bonheurs rares de Gérard Manset
Par François Delétraz (Le Figaro Magazine, 20 Mars 2004)
"Langage oublié", son dix-septième album, confirme et prolonge la singularité de cet auteur-compositeur-interprète inclassable. Par François Delétraz (Le Figaro Magazine, 20 Mars 2004)
D’emblée Manset pose son décor. Tranquillement assis dans un grand café désert du XVIème arrondissement, lunettes noires sur le nez qu’il enlèvera au cours de l’interview, le personnage est hors normes et ne se prive pas de cultiver sa différence. Bien qu'auteur-compositeur-interprète depuis plus de trente-cinq ans, à la tête d’un catalogue riche d'une petite vingtaine d'albums, il se dit étranger au monde du show-biz et ne veut pas entendre parler de télévision ou de radio, par dégoût de la transparence, « ce mal de notre société où l’on veut tout expliquer, et parce que « le non-dit a plus de valeur que le rabâchage et le décorticage ». Plus étonnant encore, il refuse de se produire sur scène, tout ce qui ressemble à une gloire médiatique lui paraissant hautement suspect. Non qu'il fuie ses semblables: au contraire, pourrait-on dire. Son semblable l'attire qu’ il est allé rencontrer lors de longs périples en Amérique latine ou en Asie. Mais c'est la complexité humaine qui l’intéresse, pas la caricature que l'on en fait sur les plateaux télé qui tiennent désormais lieu de tribunes. Et de fustiger « l’impudeur qu'il y a à résumer en une phrase et demie, avec un vocabulaire de trois cents mots, sous le prétexte que tout le monde doit comprendre, des thèmes philosophiques ou de sciences humaines auxquels des penseurs, des écrivains, des esthètes ont réfléchi leur vie entière ».
Son dix-septième album, « Langage oublié » est fidèle au personnage : des questions, peu de réponses, le spleen. Des chansons compliquées, car « les choses le sont » des textes en forme d’exutoire qui flattent le repentir. Mais aussi un vrai vécu qui réconforte. On ne s'étonnera pas, dès lors, qu'il occupe une case à part sur l’échiquier de la création, une case bien à lui, que personne ne lui dispute tant elle parait anachronique dans notre société du paraître et du divertissement.
Gérard Manset, qui aime tellement le travail en studio qu'il a longtemps eu le sien propre, est quasiment le seul, aujourd’hui, à s’occuper de tous les aspects de ses albums : paroles, musique, orchestration, mixage, pochette...
« J’ai le droit de vie et de mort sur chaque mot, sur chaque virgule, sur chaque instrument. »
Du coup, on entre dans ses albums comme on reprend langue avec quelqu'un, comme on rouvre un livre aimé trop longtemps délaissé. Une sensation que l'on peut aussi éprouver lorsqu'on voyage seul dans de très anciens lieux, dans de vieux paysages, quand on ne s'effraie pas de sentir passer sa vie. Et quand c’est Manset qui le dit, avec sa manière plutôt a contrario, il en donne une image si juste qu’elle trahit le peintre ou le photographe qui se réveille en lui quand il ne compose pas : comment peut-on sentir le poids des ans « quand pour certains il n'y a que des années semblables, formatées comme des poulets en cubes, comme les McDo mâchouillés par tout le monde, tout le monde à la même enseigne, tout le monde disant la même chose !»
Qu'est-ce qui fait courir Manset ? On ne sait pas. Cela n'a pas de nom.
«- Les créateurs dignes de ce nom ont toujours été une énigme, mais on est dans une époque où l'on nous abêtit avec des gens qui ne sont pas des énigmes. Des soi-disant auteurs, des soi-disant écrivains, des soi-disant compositeurs qui ne sont que des tâcherons derrière un davier. Moi-même, je ne suis qu’une pseudo-énigme à côté d'un Gauguin, d’un Nerval ou d'un Maupassant. Mais certains ont un acharnement à tout construire ; d'autres à tout détruire, et c’est un peu mon cas. »
Et pourtant, Manset jure qu'il a fait son deuil de sa période sombre. Qu'il a décidé en toute sérénité de publier quelques albums jalousement gardés dans les tiroirs.
« J’ai fait le gros dos. De la rétention pure et simple. Mais si j'aime l'analyse, la complexité, la rigueur, je ne refuse pas une certaine légèreté »
A croire que Manset va tenter de trouver un équilibre entre hermétisme et visibilité, entre envie de se donner et résistance à se livrer.
« Tout le monde n’est pas dans le divertissement. Il y a par exemple Trenet, dont tous les titres sont des bijoux et qui n'a jamais rien fait pour distraire ou divertir, mais qui créait pour se distraire lui-même.»
Son disque, alors, viendrait comme « un réconfort et une réponse, une sorte d’aspirine. »
Peu importe qu'il en vende 60 000 ou 100 000 exemplaires, à l'instar des précédents, car il se « fiche de savoir sur quoi les gens se ruent. Qu'ils se jettent sur des DVD à la Fnac, c'est leur problème. Si je me ruais sur quelque chose, ce serait sur Nerval pour trois pages une fois l'an, sur Chopin le temps de trois Nocturnes ».
Réactionnaire. Manset ? Méfions-nous de ces qualificatifs dont on use facilement pour se débarrasser de l'adversaire. Disons qu'il a quelque chose d'un résistant. Une sorte de romantisme à l’état pur, où se mêlent un sens aigu de la valeur du temps qui passe et un sens aigu de la valeur des mots. Un amour extrême de la langue, à laquelle il rend hommage pour « son efficacité, ses mille manières de dire les choses ».
Ne clame-t-il pas, dans son disque : « Qui parle encore cette langue oubliée par laquelle nous nous étions connus ? ».
*********************************************************************************************************************
Mémoires d'outre-tombe
Voyageur plus que jamais solitaire, Gérard Manset revient dans « nos » lumières avec un album « noir ».
Propos recueillis par Jean-Paul GERMONVILLE pour l’Est-Républicain (6/3/2004)
Propos recueillis par Jean-Paul GERMONVILLE pour l’Est-Républicain (6/3/2004)
- La dominante est des plus noires…
- Ce pauvre instituteur de 35 ans du premier septennat de Mitterrand qui était un vaillant sur le terrain du « Comme un Guerrier » de Manset, il est clodo aujourd'hui, sur une bouche de métro. Il hésite à aller bouffer à la soupe populaire ou aux restos du cœur et finalement il ne s'y rend pas. A-t-il dès lors le loisir d'écouter à la Fnac mon dernier album et plus encore de l'acheter. Sur quel lecteur de CD le passerait-il ? Voilà, on n'a plus que des technocrates, de « brillants » hommes politiques tout feu, tout flamme. Ces gens-là n'ont rien à foutre d'un univers comme le mien. Des gens se satisfaisaient de créations plus légères comme « Les Îles de la Sonde ». Là, on est plutôt dans « Les Mémoires d'Outre-Tombe ».
- Votre chanson «Le coureur arrêté » évoque ces fameux « instits ?
- Une gare la nuit. En fait, « cathédrale rieuse », parce que toutes ces gares qui correspondent au tableau de Sisley, ont de grandes coupoles. Je compatis et je suis infiniment plus proche de ces gens-là comme si je voyais à travers eux ce qui m'était destiné.
- On retrouve ce thème récurrent du bonheur perdu !
- Pour cette raison, l'album s'appelle « Le Langage Oublié ». J'ai apporté un soin particulier sur les neuf minutes du titre. Il faut également signaler, la raison peut-être d'une année ou deux de retard dans la réalisation, la nécessité de maîtriser les aspects techniques du numérique et tout ça, pas vraiment contrôlés chez la plupart des assistants et, donc, qui justifie qu'on s'y intéresse. Je n'ai plus 25 ans et pas une décennie à passer de plus dans un studio parce que tout a changé, je me voyais mal sortir un nouvel album sans un apport musical, une sorte de ligne médiane avec toute cette expression techno, hip-hop. Sur deux titres, « Demain il fera nuit » et « Le langage oublié », un musicien m'a donné quelques apports que j'ai immédiatement subtilisés et manipulés, J'ai attaché une importance particulière à « Langage oublié » parce que ce thème est non seulement perdu mais devenu inintelligible. Voilà quinze ans, quand je disais « mais où sont passées les lumières qui nous guidaient », il s'agissait déjà de l'enfance perdue, d'une sorte de paradis ou d'Eden que le monde le comprenait. Aujourd'hui, ce langage échappe à tous. Deux ou trois pages représentent chez certains auteurs, Nerval par exemple, ce propos... « Les Filles du Feu », «Sylvie », quelques pages du « Tour du Monde en 80 jours » de Jules Verne. Il y a des codes, des approches, mille manières de séduction. Et nous en sommes, encore une fois, à l'époque des McDo, des bagnoles césarisées, compressées.
- Vous parlez de langage galant, il est question d'amour dans plusieurs chansons.
- D'intelligibilité du langage. Les gens sont toujours amoureux mais deviennent de plus en plus atones, analphabètes, attardés, presque trisomiques. Ils ne peuvent plus s'exprimer, Ils se regardent. On en revient très doucement à l'Age de pierre...
- Et les « enfants clonés » !
- On y est presque. J'avais cette vision toute simple. Les parcs ne sont plus ce qu'ils étaient, les enfants non plus... ces sortes de petits bonshommes blanchouillards formatés, grotesques. Là où on trouvait une intelligence dans les cours d'école, c'était d'un diabolisme, d'une rapidité, d'une vivacité, d'une acuité curieuse sur tout, on n'a plus que de l'inertie. Ce seront d'ailleurs je pense les choses les pires dont auront un jour à répondre les dirigeants. Parce qu'il va bien falloir qu'il y ait des responsables d'une telle manipulation de la population.
- Par ailleurs, vous évoquez un autre monde. - « Demain il fera nuit, comme l'Etna, comme l'Etna ». Il s'agit du tiers-monde, encore l'exotisme, l'Asie, l'Amérique Latine. Ces gens ne bouffent pas, voient la vérité où elle est et qui vivent parmi les plantes, les animaux. Ceux-là ne sont pas encore clonés.
- Et le thème de la mort !
- Moyennement, pas plus qu'avant. « Quand on perd un ami » est, avec trente ans de plus, « L'Elégie Funèbre » revisitée de « La Mort d'Orion ». La disparition, telle que décrite, passe encore pas une sorte de dignité,.. Je crois qu'il n'y a rien de matériel dans ce monde matériel. On évolue dans une sorte de mécanique du pseudo. Heureusement, sinon les gens se flingueraient tous. Je pense à ceux qui font des dizaines d'heures de transport en commun tous les jours, ces femmes qui tapent sur des claviers d'ordinateurs à longueur de journée des trucs abscons. Heureusement que le cauchemar est la journée, que la vie réelle est la nuit dans le rêve. Je pense.
« Une croix à porter »
Gérard Manset n'hésite pas à assurer que son dernier disque est un des meilleurs qu'il a réalisés : « Je peux livrer mon sentiment, il n'engage que moi, Je suis content après avoir été dubitatif, J'ai beaucoup souffert techniquement, les aléas humains sur le matériel, sur les studios. Tout ça s'est décanté cet été. Avant, j'étais moins confiant dans la suprématie de cet album. On peut parler d'un travail d'épure ou de sobriété et en même temps, c'est dense. Il y a peut-être trop de choses et on peut me retourner le compliment. Ça peut même devenir un peu bourratif pour une époque où on n'est plus habitué qu'à avaler des McDo, que des trucs hyper lights. On est donc loin de l’album léger. Mais il s'agit, peut-être, d'une croix à porter après avoir interrompu tout ça durant quelques années, finalement une bonne dizaine puisque je n'ai réalisé que « Jadis et Naguère» durant ce temps, pour des raisons personnelles, de rétention, de changements du monde qui ne me convenaient pas... il fallait bien que je finisse par sortir un album puisque la matière s'accumule. A un moment la porte doit exploser, l'abcès crever. Difficile de donner avec de la légèreté, Surtout en ce qui me concerne avec les 10.000 couches successives, les 10.000 étapes, les 10.000 gommages, les 10.000 remises à niveau. En réalité maintenant, j'ai la conviction absolue qu'il s'agit vraiment d'un des trois ou quatre plus beaux albums que j’ai fait. Je vais peut-être perdre des clients en route. Je ne sais si je vais en trouver de nouveaux. Seront-ils encore vivants, peut-être grabataires pour des questions d'atteinte quotidienne à leur santé mentale, psychique, à cause du monde, encore une fois qui change ? »
************************************************************************************************************************
Chanteur et photographe : Manset sur d’autres rivages

Gérard Manset est de retour avec un nouvel album. Lui qui rechigne pour des interviews et ne donne jamais de concert a accepté d’évoquer l’univers de ses dernières chansons. En exclusivité pour « Le Monde 2 », il partage ses photos d’errance en Italie, de cette Venise qui « s’enfonce » et qui a servi de toile de fond à son dernier disque, « un des plus aboutis », selon lui.
Par Yann Plougastel (Le Monde 2 du 7/3/2004)
Ce jour-là, Gérard Manset a une oreille bouchée. Il porte les mêmes Ray-Ban noires que Bob Dylan. Et vitupère cette Terre qui ne tourne plus rond depuis un bail. Après six années de silence, il vient enfin de se résoudre à mettre un terme à la rétention de son dix-septième album, Le Langage Oublié, annoncé depuis un an, prévu pour octobre 2003 et peaufiné, découpé, torturé, trituré, haché menu jusqu’à la dernière minute.
Une cohorte de fidèles suit, depuis Animal on est mal en 1968, cet artiste-culte qui n’apparaît jamais à la télévision, ne veut jamais donner de concert et répond rarement aux interviews. A chaque fois, ils sont 100 000 à se ruer sur les mots du maître. Le grand public, lui, connaît Il voyage en solitaire, Camion bâché ou Y’a une route, qui furent des tubes. Manset, comme Christophe ou Jean-Louis Murat, appartient à cette race très étrange des ovnis de la chanson française. Sorte de Ferré rock et de Houellebecq végétarien, il est, dans la vie quotidienne, tout aussi atrabilaire et emporté qu’un Baudelaire éructant contre les Belges, les croque-morts, les critiques d’art, les cordonniers et les censeurs. Mais, dans ses chansons, se veut zen et pratique une sorte d’écriture automatique, où surnage la quête d’un paradis perdu, celui de l’enfance. Rousseau au pays des guitares électriques et des synthétiseurs…
Lorsqu’il n’est pas enfermé dans un studio quelconque à remettre en chantier un titre vieux de dix ans, Manset part. En Chine. A Cuba. Au Siam. En Afrique. A Venise. Et photographie sans affection les jours d’Angkor, les fins d’après-midi de La Havane et les nuits de Recife. Venise a sans doute servi de décor à l’élaboration du Langage Oublié, mais nous n’en saurons pas plus. Ce jour-là, après avoir commenté quelques-uns de ses nouveaux morceaux en se frottant l’oreille, Gérard Manset a choisi pour nous les photos qui, à son avis, illustrent le mieux cet album.
« Venise est une belle métaphore pour Le Langage oublié. Si dans un portrait chinois on me demandait le nom d’une ville, je citerais Venise. Parce qu’elle s’enfonce aussi… Contrairement à Naples, ce n’est pas l’endroit au monde qui m’a le plus fasciné car je n’aime guère l’ambiance des palais décatis et vides. Je n’éprouve pas de tentation de Venise. Je n’ai pas envie d’y vivre ou d’y écrire. En même temps, elle est stupéfiante. Il y a ces milliards de peintures, de corniches, de dorures, de balustres, qui s’écroulent et ne servent plus à rien. Ces balcons sous lesquels il n’y aura plus de romances ou d’histoires d’amour. Le Langage oublié, c’est aussi ce rapport perdu définitivement entre les hommes et les femmes. J’ai été très frappé lors de mes voyages de constater qu’on rencontrait le bonheur dans des sociétés, pauvres ou riches, matriarcales ou patriarcales, mais où le rôle de chacun était défini et séparé. Comme du temps du cinoche de mon enfance dans les films en noir et blanc de Gabin, avec ces fratries et ces familles rebelles…Les psychanalystes l’expliquent depuis belle lurette mais personne ne les écoute plus…
Pour en revenir à Venise, imaginons à partir de la grande lagune un immense travelling arrière, avec d’abord l’Adriatique, puis la Méditerranée et enfin la Grèce… Cette Grèce antique, voilà le langage oublié… On est dans un monde perdu… Bientôt tout cela n’aura plus la moindre résonance dans la cervelle de qui que ce soit… Apprendra-t-on encore le grec au lycée ? Je ne sais pas. Le passé est devenu un rêve inaccessible. Il ne s’agit nullement de nostalgie mais de fascination d’avoir connu ce monde-là. Il n’y a pas de vindicte, de critique, de doigt pointé sur ceux qui ne l’ont pas connu ou ne veulent pas le connaître. La recette est donnée : cette sorte d’amour universel existait. Il ne s’agit pas de psychanalyse mais du quotidien d’une certaine génération. Les jeunes ne se sentiront sans doute pas concernés et n’y verront qu’abstraction. Il leur en restera une sorte de poésie. Ce titre est la clé de voute de l’album. »
« Je suis un inconditionnel des expériences psychanalytiques. Pourtant je n’ai pas fait d’analyse. J’ai toujours trouvé cela relativement risqué avec la possibilité de se retrouver autrement qu’on était. Après tout je ne suis pas mal et je ne veux pas perdre mon aspect Jeanne d’Arc, ces voix qui surgissent et m’inspirent. On ne sait jamais, la psychanalyse peut me rendre amorphe, aveugle et sourd sur toutes ces choses. Mais j’aimerais qu’un psy se penche sur l’ensemble de mon travail pour m’en livrer les clés. Que ne fus-tu en est une. Je l’ai mis après Le Langage oublié parce que je voulais que, d’un seul coup, il y ait une sorte de calme plat après de très belles vagues. Je me suis d’abord demandé s’il n’était pas insupportable. Très étrangement, ce titre donne l’impression de dire exactement le contraire de ce qu’il veut dire. Il explique qu’il aurait mieux valu que la mère soit méprisable, haïssable ou critiquable afin de désigner un responsable à ce mal-être, à cet environnement épouvantable qu’est le monde aujourd’hui. Malheureusement, la mère étant sans reproche, contre qui se retourner ? Et comment faire son deuil ? En cette époque d’obscurantisme généralisé, on ne cherche qu’à trouver les causes des traumatismes sans s’interroger sur les non-causes. Qu’est-ce qui fait que je suis comme je suis ?
Je suis le bouddha compatissant. Je suis en connexion avec la douleur comme la sérénité. Je vois les deux avec équanimité, normalement. C’est toujours en équilibre total. On est dans un monde chimique, dans un processus strictement chimique, le vieillissement, l’équilibre, la santé, la vue, l’audition…. C’est comme dans le bouddhisme, où il n’y a pas de mort en soi. Donc, tout ce travail sur la musique, la beauté, la poésie, c’est de la chimie. Nous sommes dans le relatif, le relatif de la chimie. »
« Je suis très content de cet album qui est sans doute un de mes plus aboutis. Il est long, complexe, riche. Je n’ai rien laissé au hasard, ce qui n’a pas été le cas pendant la période Comme un guerrier… Demain il fera nuit se rattache à mes anciens morceaux, c’est une chanson plus dynamique dans la lignée du Train du soir ou de Vahiné ma sœur. Je viens d’une époque où tout était merveilleusement, non pas facile, mais artistique. Aujourd’hui, rien ne l’est plus. Il est très difficile de faire abstraction des années 1970-1980. Il y avait des Lamborghini, des voitures avec des couleurs extraordinaires, maintenant elles se ressemblent toutes. En studio, c’est pareil, tous les musiciens jouent de la même façon. Ceux qui ont une véritable personnalité sont très rares. Dans la musique, on en est déjà à l’heure du poulet en cube ! Je suis malheureusement obligé d’affirmer qu’un titre comme Y’a une route, aujourd’hui, je ne pourrais pas l’enregistrer. Pour les diplodocus comme moi qui s’ébrouent encore et ruent dans les brancards, c’est très difficile d’arriver à tenir le cap. Et en même temps d’avoir les avantages de l’époque. J’y suis arrivé avec Demain il fera nuit. C’est une adéquation réussie entre la musique numérique et mon inspiration matricielle… Cet album, il faut l’écouter seul, disponible, à un moment privilégié, dans une sorte de stratosphère, il est en dehors du temps. »

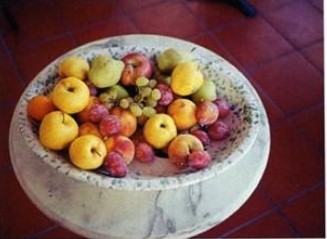




************************************************************************************************************************
Gérard Manset: Toujours en solitaire
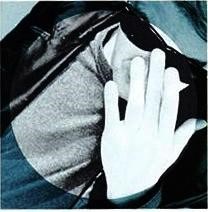
Gérard Manset: Toujours en solitaire
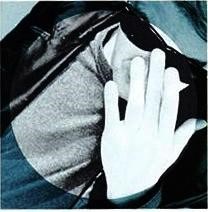
PAR J.P.PASQUALINI
(AVEC LA COLLABORATION DE P.-A. BESCOS - REMERCIEMENTS BRUNO JACQUOT)
Magazine PLATINE n°110 (Avril 2004)
PHOTOS X.D.R. / COLLECTION GERARD MANSET
Depuis son premier album « Animal, on est mal Gérard Manset n'a eu de cesse de cultiver la discrétion, la rareté, l'exigence, l'extrême qualité. A l'heure où il sort son 17ème album « Le langage oublié », il nous a fait le plaisir de revenir sur sa déjà longue et dense carrière. Après avoir, ces derniers temps, écrit pour les autres (Raphaël, Indochine, Birkin, Gréco...), le Manset polymorphe redevient un pour un album somptueux... D'aucuns l'imagine renfermé, un rien élitiste et léonin, il est tout ou contraire disponible, lucide et incroyablement précis. Il revient avec nous sur le processus de création et sur l'air du temps qui se gâte...
-Vous restez plus que jamais fidèle à votre credo dans le fond et la forme...
- Oui, par la force des choses puisque je suis auteur, compositeur, orchestrateur, preneur de son et qui m'occupe des éléments graphiques de A à Z. J'étais déjà un cas à part dans ce métier mais je deviens une sorte d'anachronisme, une particularité inaccessible. Je découvre que je suis un des derniers auteurs-compositeurs. Charles Aznavour n'a pas écrit « La Mamma » et j'apprends également que Claude Nougaro était essentiellement auteur. Or, j'étais persuadé que ces gens-là étaient des auteurs-compositeurs. Finalement il n'y en a quasiment pas... Cette génération à laquelle j'appartiens en a apporté pourtant de nombreux purs et durs, comme Nicolas Peyrac ou Bernard Lavilliers...J’en suis, quant à moi, au 17ème album. Ce qui fait un nombre de titres absolument irrattrapable compte tenu de la quantité de travail réalisé, identitaire, identifié et personnalisé.
-Vous êtes-vous autant intéressé aux innovations technologiques en matière d'enregistrement qu'en matière d'artwork ?
-Il y avait déjà eu une immense bouffée d'air quand les boîtes à rythmes sont arrivées, ce qui évitait des batteurs pas toujours en place. Tous les guitaristes se sont sentis pousser des ailes quand ils ont pu jouer sur des bases en mesure. De même en artwork, depuis l’avènement de Photoshop, on évite les soucis dûs aux photograveurs qui restituent des images fades et de qualité médiocre. Désormais, on fait ses propres créations avec un résultat bien meilleur. On accède à une qualité de précision et de définition extraordinaire.
-Il semble qu'un autre album ait été prévu à la place du « langage oublié » que vous présentez actuellement...
-Je devais en effet sortir un autre album l'année dernière avec un certain nombre de titres différents, enregistrés mais non finalisés. J'ai malheureusement perdu trois ans à chercher en vain des gens compétents et me suis résolu à endosser moi-même la panoplie du parfait preneur de son. Or, je n'avais que des résultats épouvantables dans tous les studios que j’ai fréquentés. J’ai donc repris tout le projet aux fondements. Le problème récurrent que j'avais eu avec les photograveurs en terme de visuel, je l’avais dans les studios avec le numérique en terme de son. Ces soucis ont duré jusqu'à ma rencontre avec Dominique Blanc-Francard, qui est de ma génération et qui a vécu le passage au numérique. Il a été le seul à m'orienter et me rassurer. Je n'ai pas continué mon album chez lui mais j'aurais pu. J'ai trouvé des conditions équivalentes auprès d'un assistant, Nicolas, au studio Damien, travaillant depuis cinq ans en dehors du côté « paillettes » du métier. Il a pu faire très précisément table rase avec moi et tout à coup, comme il est excessivement méticuleux et compétent tout a pris un sens. J'ai pu alors commencer à travailler sérieusement.
-Quel est le studio qui a été le plus mis à contribution pour ce nouvel album : La Grande Armée, Damien ou Twin ?
-L'album est né un peu partout J'ai fait des sessions rythmiques et des enregistrements essentiellement au Palais des Congrès, avec des gens que j'adore. Mais ces studios ont tendance à engager au fil des années des assistants qui ont trop de préoccupations annexes en tête quand ils arrivent pour travailler. Dès qu'on leur demande quelque chose, c'est un enfer pour l’obtenir... Le studio est simplement un outil de travail, il faut qu'il soit à 200 mètres de chez moi pour que je puisse y aller selon mes désirs. Cela fait longtemps par exemple que je veux travailler à ICP mais il m'est impossible de retenir un studio à l'avance car, en période d'enregistrement, je suis en perpétuelle création. Il m’arrive de ne pas travailler sur les titres que je voulais enregistrer la veille parce que j'en ai d'autres en chantier ou que j'en ai composé de nouveaux. En période d'enregistrement je peux composer jusqu'à trois ou quatre chansons dans la journée. Sur « Le langage oublié », « Le coureur arrêté » n'était pas prévu à l'origine et c'est sa présence qui m'a amené à remanier une partie de l’album cet été.
Il a réellement donné une géométrie différente à l’album. De plus je ne savais pas si j’allais pouvoir finaliser « Le langage oublié » dont j’ai quatre versions, et s’il allait être le pivot de l’album. Pour n’importe quel producteur, ce genre de problèmes est réglé en quelques secondes mais moi, il me faut du temps. Je ne considère pas ce travail comme des hésitations, mais comme un élargissement vers des perspectives nouvelles. Comme un sculpteur, c’est du modelage…
-Avez-vous encore un complice comme Malek, Jacques Erhart ou Bernard Estardy ?
-Je n’ai plus de complices dorénavant. Je suis retourné voir Bernard et j’ai fait une ou deux séances avec lui. Il a d’ailleurs sa place dans les crédits. C’est un personnage extraordinaire, éminemment talentueux et productif. Il fume un peu trop la pipe dans son studio mais à part ça, c’est un homme exceptionnel.
- Suivez-vous la carrière de vos anciens collaborateurs, comme Jacques Erhart qui, vient de réaliser les albums de Régine et d'Alain Chamfort ?
-Oui. Jacques fait ce qu'on lui demande de faire. Il était plus un ami qu'un collaborateur au studio, comme Malek d’ailleurs. Ce sont des vrais complices, des comparses auxquels on peut tout dire et qui ne vont pas hésiter à pointer la faute de goût. Malheureusement sur le plan strictement, technique, il ne m’apportait pas de réponses efficaces et rapides. Il sait par exemple convoquer des batteurs, qui valent cher et qui passent la journée à faire quatre mesures. Ils n’ont rien à voir avec les batteurs des années 1970 et 1980. J’ai eu un batteur qui avait une frappe d'enfer et qui ne s’arrêtait pas une fois le titre terminé. Il ne lisait pas toujours la grille mais au moins avait une frappe, un son, une énergie, une invention. Il n'y a plus aucune invention de la part des batteurs aujourd’hui.
-Avec le titre « Quand on perd un ami », on ressent un vécu personnel, une émotion particulière, qui transparait comme une faille dans l’armure que vous tâchez d'endosser quand vous chantez…
-C’est tout fait vrai. Avec parcimonie, j’émaille mes albums de tires plus concrets que d'autres. D’autres artistes pourraient la chanter mais personne d’autre que moi n'aurait pu la composer.
-C’est un titre qui se rapproche de ce que vous avez pu écrire pour Raphaël....
-Ma fille ainée Caroline travaille avec Raphaël et a commencé à entrer dans mon univers. Comme elle est aussi exigeante et compliquée que son père, elle a, à ma demande, commencé à donner son avis. J’ai toujours voulu des collaborateurs de cette trempe ! Ainsi Caroline aurait privilégié des chansons comme celles-ci, et c’est d’ailleurs elle qui a insisté pour que ce titre soit sur l’album. La maquette était tellement prenante et intime que j’avais toutes les réticences du monde à la reconstruire en studio. Non sans mal, je crois avoir réussi à ne pas perdre l’émotion originelle tout en ayant un produit fini. Jusqu’à présent, je ne mettais pas en avant ce type de chansons et je privilégiais les titres qui formaient une saga. Dorénavant, je continuerai à enregistrer très vite et je vais sortir les albums à la mitraillette. Après toutes ces années de rétention, j’ai beaucoup de matériel musical et, voyant que le monde ne changera plus, que c’est irrémédiable, je vais faire ce que j’ai à faire : composer et créer.
-En moyenne, il y a eu un disque tous les deux ans avec des périodes de parenthèse, d'autres de sorties plus intenses comme au début des années 1980 avec les sorties rapprochées de « L'Atelier du crabe » « Le Train du soir », « Comme un guerrier », qu’est-ce qui détermine ce rythme ?
-J’enregistre sans interruption. Il y a des périodes de hauts et de bas suivant la réception des albums. Après « Matrice » (Ndlr : plus de 100 000 exemplaires vendus), j’avais « Revivre » quasiment prêt. J’ai ensuite attendu quelques années. Puis « La vallée de la paix » en 1994, qui a moins bien marché que ce que je ne pensais.
- « La vallée de la paix » n’est pas un de vos albums les plus faciles…
-On est d’accord mais les autres albums sont-ils faciles ? Cet album est arrivé à un moment où le monde commençait à changer et mon public à se renouveler. Je touchais des jeunes qui ne connaissaient pas les années 1970, ni « La mort d’Orion », ni « Y’a une route » de 1975, ni même « Lumières » de 1984. Débarquer avec cet album en ne faisant pas de scène, c’était impossible… J’aurais eu une tournée derrière, je vendais peut-être 500 000 albums. Au final, je n’en ai vendu que 70 000.
-C'est déjà très bien...
-Non, quand on sait qu’il y a des produits parfaitement ineptes qui vendent entre 200 000 et 600 000 albums, comme cette si fade Carla Bruni que j’ai découverte aux Victoires de la Musique. Tout le monde m’en parlait depuis un an…Comme je n’écoute rien, j’étais le premier à trouver ça positif : une jolie fille qui chante des titres sans rythmique lourde, de jolis textes… mais ce n’est pas cela. Je n’ai pas compris la moitié de ce qu’elle a chanté et cela n’était pas très juste.
-Êtes-vous partie prenante dans la création des compilations qui sortent (ndlr : le triple 33 tours de 1982 « coffret Manset », réédité en 1984 sous le titre « Trio » ; le double CD de 1992 « Toutes choses » ; le coffret de 5 CD de 1985 « Entrez dans le rêve » ; les 4 doubles CD de 1999 (« Y’a une route », «Le train du soir », « Revivre », « La vallée de la paix ») ; le CD « Best of' » de 1999 (avec indication des 4 titres complémentaires du CD collector de 4 titres offert par la Fnac) ou acceptez-vous de déléguer (le long box « Capitaine courageux » de 2002) ?
-Pour le long box « Capitaine Courageux », c’est un ami, Christian Noailles, qui s'en est chargé. Il a trouvé le graphiste et j’ai choisi la couverture ainsi que la construction des pages intérieures. Ce coffret est un cas à part, car c’est une commande de Virgin. Christian était en charge du projet et avait des idées sur la composition de chacun des trois albums. Quand il peut y avoir un peu de sang neuf dans la « recréation », c’est toujours bien… Il a adapté le principe de la relecture chronologique. Et ce qu’il a fait est magnifiquement exécuté.
-Un album comme « Rien à raconter », qui a suivi le succès de « Y’ a une route », pourrait être réédité. Après avoir décidé de bannir les titres de jeunesse, pourrions-nous, avec ces coffrets compilations, voir resurgir ces chansons anciennes ?
- Des titres comme « Animal, on est mal », « La toile du maître », « Jeanne » … on me talonne tous les jours en espérant me convaincre de les ressortir. Je suis assiégé…
-Cette réticence à remettre ces titres en circulation est-elle due à un problème de cohérence d'écriture ou d’arrangements ?
Il y a différentes raisons pour lesquelles je ne les réédite pas. Pour les plus anciens, je n’ai plus les bandes et je ne dispose que des mixes. Je n’ai donc pas envie de « Animal on est mal » avec une voix qui ne me plait pas, jeune, fragile et fluette...
- Elle est ce qu’elle a été...
-Oui, parfaitement, mais il y a trop d’écart avec celle d’aujourd’hui.
-Dans quatorze ans, quand ces titres tomberont dans le domaine public, comment réagirez-vous ?
-Je ne sais pas mais cela ne me fait pas peur, c’est la règle du jeu…
-Quelles sont les autres raisons de ce refus de la réédition ?
-Pour certains titres, le problème vient des termes employés. J’avais écrit : « Tu as choisi de vivre à l’écart des connards ». Ce terme me dérange et cette phrase est gratuite, un lieu commun que je n’ai pas envie de voir figurer dans ma discographie. C’est le même souci en littérature. Il y a des récits magnifiques qui contiennent néanmoins deux pages vulgaires qu’on aimerait retirer. Quand j’ai refait « La Mort d’Orion », j’ai évacué un ou deux mots. Aujourd’hui, je tends à la concision du verbe, et dans ce que je sors depuis « Prisonnier de l’inutile », il n’y a plus le moindre détail à contester. Je ne peux donc pas me permettre de réactualiser des titres imparfaits. Ceci à l’inverse d’une décennie où j’ai joué le jeu du métier et où je me suis laissé gagner par la facilité. J’étais moins rigoureux après « Il voyage en solitaire » et l’album « Rien à raconter » : tout roulait, au studio de Milan, les musiciens jouaient bien. Il y a des titres comme « Tu t’en vas » par exemple avec trois pauvres phrases qui se battent en duel, un petit clavecin derrière, c’était du remplissage…
-Le saviez-vous au moment où vous le faisiez ?
-Je le savais mais j'avais besoin, comme un gosse, de connaître les limites. Je faisais ça pour qu’on me dise : « Gérard, tu te fous de la gueule du monde ! » Personne n’a osé. C'est d’ailleurs ce qu'a fait Gainsbourg toute sa vie : se foutre de la gueule du monde en permanence. Quelqu'un aurait dû lui dire qu’avec l’inspiration, il aurait pu donner autre chose de plus abouti. Il faisait travailler 25 personnes autour de lui et bricolait son truc bâclé sur un coin de table.
-Refuser de livrer les premiers pas, c'est une sorte de souci de réécrire l'histoire ?
-A partir de quand un créateur est-il suffisamment mature pour qu'on mette en circulation sa production ? Là est la vraie question. Or, j’ai débarqué dans le paysage musical comme un ovni avec une inspiration inimaginable. Quand je réécoute ce premier album « Animal » « Je suis Dieu » « la toile du maître » « On ne tue pas son prochain », je suis estomaqué par la novation et l’originalité dont je faisais preuve. En revanche, je supporte difficilement la production de celui qui chante avec cette voix de minet et je n'ai pas eu envie d’être Antoine bis. J'ai pu néanmoins ressortir « La Mort d’Orion » avec l’aide de Bernard Estardy dont le studio ni les conditions de travail n'ont changé. Il y a d'autres sujets pour lesquels c'est plus délicat. Par exemple. « L’album blanc » (Ndlr « Long long chemin ») que l’on me demande en permanence.
- Regrettez-vous autant certains termes employés dans vos chansons que certaines de vos paroles retranscrites par les journalistes, comme lorsque vous confiez à un confrère : « Reggiani est un cocker, un maître en pleurnicherie » ?
-Ce n'est pas péjoratif, je pourrais le dire pour Brel. C’est le problème de l’homme face à la scène, à la caricature de la scène : la pleureuse artistique… Ce n'est pas une attaque sur l’artiste lui-même. C’est plutôt un exemple de mon aversion pour l’univers de la scène: le paradis des jérémiades.
-La scène a toujours été exclue de votre vie, l'est-elle définitivement ?
-Pas du tout. La scène est très porteuse. Il y a des scènes partout, les musiciens y jouent très bien. Il n’y a d’ailleurs plus que là qu’ils jouent. Le public a changé également. Je l’ai vu lors des concerts de Nicolas Sirkis. Public extraordinaire. Monter sur scène, je ne sais pas si je le supporterais, mais chanter live. Oui. Le public, je n'aime pas. La scène, non plus. L’horaire, non plus. Le côté paillettes, je ne trouve cela ni honnète, ni sensé, ni humain. De même, je n’aime pas le vaudeville et les pantalonnades.
-Vous avez dû voir Raphaël aussi sur scène ?
-Oui, avec plaisir mais il débute et son public est disparate.
-Le titre sur scène serait-il le même que ceux auxquels on a droit sur disques, ou pourriez-vous récupérer des titres plus divers ?
-Bien évidemment dans l’absolu, c’est mon rêve. Un jour, je m'y mettrai mais il n'y a pas d’engouement. Actuellement, je suis comme un noyé qui arrive à remonter à la surface pour seulement quelques secondes. Un album de temps à autres pour que le catalogue reste en vie…_ Pour ceux qui l’aiment…
- Vous avez un public fidèle mais assez peu nombreux…
- Ce n'est pas le désert mais c'est te effectivement trop peu. Plus ça va, plus le dénominateur commun d’un public général est écarté de toute sensibilité.
-C'est le propos et le sens du titre de votre nouvel album « Le Langage oublié » ?
-Tout à fait. Les déclarations d’amour et les sentiments ne s’exprimaient pas en trois mots avec Nerval et Zola. Je suis peut-être une sors de diplodocus, témoin d’une demie époque révolue, mais je refuse que ces choses-là meurent…
- En 1981, au moment de « L'atelier du crabe », vous aviez fait une émission de télé…
- Oui, c’était pour « Les enfants du rock » et, à l’époque, j’en avais fait plusieurs. J’ai arrêté à cause d’une émission des Carpentier à laquelle Cabrel m’avait convié. C’était réalisé en dépit du bon sens et je me suis réveillé un matin en me disant que ça suffisait.
-Vous avez pourtant été « lancé » par Michel Lancelot, un homme de média et de radio...
-Oui. Rendons d'ailleurs hommage à quelques travailleurs de l’ombre qui font tout pour « sauver le soldat Manset ». Vous citer des noms serait déplacé mais je vous assure que j’ai un cercle de gens que j’estime énormément, les seuls qui me font m'interroger sur moi-même. S’ils n'étaient pas là, j’aurais probablement arrêté ce métier car il y a un moment où les lettres d'encouragement du public ne suffisent plus. Car au fond, le public achète tout. Les Inrocks font par exemple une couverture sur Miossec, Dominique A et Autour de Lucie et le public va se précipiter sur ces albums… Ils représentent la nouvelle génération mais je suis à des années lumières d'eux au niveau de la perfection et de la rigueur du travail. Ils sont auteurs, compositeurs parfois, musiciens, mais surtout ils font 300 dates par an. Le métier aujourd’hui ne tourne qu’à cause de la scène. Je ne suis donc pas dans ce marché et ne cherche pas à y entrer. J’ai toujours voulu cibler la clientèle que je voulais atteindre. Je ne veux pas vendre tout à tous et n'importe comment. Je veux simplement que le produit soit disponible, une sorte de baume.
-Manset sur ordonnance ?
-Je ne veux surtout pas être pris pour un censeur, un critique, un maître à penser. Je suis très loin de tout ça. Le Bouddha, se définit comme un médecin plus qu’un penseur… Je voudrais être un soigneur, apporter un peu de chaleur. Même si mes textes sont souvent sombres, ils sont aussi rassurants. La noirceur y est alors décrite très précisément et très honnêtement. Ainsi, elle fait contrepoids et peut emmener une certaine quiétude. Il y a encore une part de beauté dans le monde même si elle tend à s'écrouler. J’en suis l'un des seuls chantres.
-Les initiatives comme l'album hommage « Route Manset » en 1996 ont-elles contribué à élargir votre public ?
-C’est une histoire à laquelle je n'ai pas tellement cru. Ce projet a eu beaucoup de mal à voir le jour mais les artistes étaient eux tout à fait concernés. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux réussi Je ne me l’explique pas, mais, chaque fois qu’il se prépare une initiative autour de moi, il y a une sorte d’engeance répétitive qui fait que s’ensuit comme un croche-pied ou une difficulté. La plupart du temps, c'est de mon propre chef. On n’est jamais aussi bien desservi que par soi-même Mais là, ce n’était pas moi… Avec le recul, je mettrais une très bonne note à l'ensemble. Cabrel, seul à la guitare sèche avec « Prisonnier de l’inutile », Salif Keita, magistral dans « C’est un parc », Murat avec un « Entrez dans le rêve » planant. Un tout petit peu en dessous venait Bashung avec « Animal, on est mal », mais j’ai regretté de ne pas être là au mix… Il y a eu aussi des essais non transformés et très respectables comme « Une route » de Dick Annegarn. Ce qui a manqué à l’époque, c’était l’investissement d’une émission de télévision par exemple. Tout est resté en pseudo secret « Manset ».
-Quand « Matrice » a été disque d'or, vous aviez l’occasion de sortir de ce que vous nommez le « pseudo secret Manset » qui vous fait passer, aux yeux de tous, pour une énigme indéchiffrable ?
-A la relecture des trois décennies où j’ai œuvré et manœuvré dans ce métier, j’ai eu beaucoup d’occasions de vendre plus ou d’être plus présent. Je crois que je ne suis simplement pas fait pour cela. Je suis plus discret, en marge, probablement solitaire, je ne suis pas pour le monde faux du bruit et des lumières. Cet univers ne me fait pas peur mais me révulse tout simplement. Il y a des moments où l'on vous déroule le tapis rouge et où il faut aller à la rencontre du public, des médias, des acclamations. J'espère parfois changer mais je ne m'y résous pas.
-Vous prenez tout de même la parole pour défendre chaque nouvel album ?
-Oui, mais dans l’intimité
-Vous êtes un témoin privilégié du monde dans lequel vous vivez. Vous avez exposé vos peintures, publié quelques livres et il est prévu un album photo : « Journées ensoleillées ». Vous êtes reporter en quelque sorte ?
- Je suis passé dans de nombreux endroits d'où j’aurais pu balancer cinq pages le lendemain L'ennui est que je porte rarement un regard politiquement correct. Ce n'est pas ce que les gens veulent entendre, ce qu’ils veulent voir, ce qu’ils veulent qu’on leur dise. Je ne suis pas un téméraire, je suis un dubitatif et je m'interroge sur la légitimité de tout propos. A-t-on le droit de dire telle ou telle chose dans un tel monde absolument inique ?
-On vous imagine solitaire alors que, lorsqu'on se penche avec attention sur votre carrière, on se rend compte que vous avez collaboré avec de nombreux artistes de tous horizons (NDLR : de Jane Birkin pour deux titres d’« A la légère » en 1999 à Indochine pour « La nuit des fées » en 2002 en passant par Éric Charden en 1969 pour « les goélands », René Joly en 1969, Éric Gemsa en 1975). Avez-vous à toute époque accepté de travailler pour d'autres ?
- La seule fois où j'ai refusé catégoriquement, c'était pour Claude François. Son bras droit était venu au studio de Milan me demander de travailler avec lui. Ce fut une rencontre très courtoise mais j'ai décliné. Il faudrait d'ailleurs monter un jour une association de ceux qui ont été traumatisés par Claude François, il y en aurait beaucoup…Avec la sortie du film « Podium », ces derniers temps je m'interrogeais…si j’avais dit oui à cette proposition, qu'aurais-je donné ? « Juste avant l’exil »: il en aurait fait un titre remarquable. Finalement, je dois admettre que c'est un interprète hors pair car tous les titres que j'ai imaginés depuis, chantés par lui auraient été valorisés. C’est étrange cette critique permanente que je n'hésite pas à faire sur cette sorte de pitre à ressort et en même temps lui reconnaître un certain talent…
-Vous avez travaillé avec Demis Roussos pour « Mon île » en 1997…
-Une histoire da copinerie avec Mick Lanaro qui m’avait demandé un titre pour David Hallyday. Mick essayait de me mettre sur divers coups et il devait produire l'album de Demis Roussos. Il y avait un texte à faire, il me l'a demandé, et cela s’est fait instantanément, comme pour ma collaboration au dernier album de Juliette Gréco (NDLR : « Je jouais sous un banc » en 2003): un titre splendide en trois minutes.
- C'était de « l'alimentaire », comme pouvait le dire Gainsbourg ?
- Non, je n’ai jamais rien fait de cette sorte. C'est un terme qui me révulse.
- Même pour Chantal Kelly en 1967 ou pour Dalida avec « Je me repose » en 1968…
-J’étais apprenti et j’ai accepté de faire des productions, des arrangements, des textes ou des adaptations sur des projets sans aucun intérêt dont je n’étais absolument pas maître. Il ne faut pas mélanger les décennies, je n'avais pas commencé ma propre carrière… Pour Dalida, je n'avais aucun à priori et si elle était encore de ce monde, je lui aurais probablement donné aujourd’hui un de mes titres en choisissant l'arrangeur. Elle faisait partie des interprètes respectables.
- Assumez-vous autant vos chansons pour d'autres comme René Joly ou Herbert Léonard que vos propres créations d’interprète ?
-Ce que je fais en tant qu'auteur-compositeur-interprète est bien loin de ce que je fais comme auteur ou compositeur. En revanche, là où je signe parole et musique, il n'y a aucune différence avec mon propre matériel. Quand je signe « Rimbaud » pour Raphaël, c'est une chanson que j'aurais pu chanter moi-même.
-Continuerez-vous à publier vos écrits ?
-J'ai plusieurs choses achevées mais une publication est-elle bien nécessaire ? Est-ce raisonnable dans le panorama actuel ? Ou alors Post Mortem je n'en sais rien. Je suis très exalté quand il s’agit de la création proprement dite mais dès qu'il s'agit d'évacuer, je finis souvent par ensevelir le dit travail, le muscler ou l’oublier. Il n’y a plus beaucoup de place pour la littérature et nous avons déjà tant de monde: Nerval, Céline, Zola…
Toujours ce « langage oublié », on y revient fatalement… Car il n’y a plus de pirates de l'écriture. Les seuls textes émouvants et beaux d'aujourd’hui sont des témoignages… Il n'existe plus d'auteurs de récits majestueux tels que l'étaient Zola, Dumas... J'aimerais avoir cette dimension d'écriture romanesque de ceux qui vivent l’inspiration à l'état pur.
-Comment faire face alors devant une société qui érige le formatage en pilier d'existence ?
-Heureusement que la musique est un moyen d'expression qui peut encore échapper au formatage actuel. Je prends à dessein l'exemple de Nicolas Sirkis. Il y a là un artiste que j'estime beaucoup parce que je l'ai vu inconnu et totalement au creux de la vague. Il a tenu bon sur ses 0rchestrations, ses arrangements, ses musiciens. Je dis souvent que je ne sais pas ce que je veux mais plutôt ce que je ne veux pas. Lui, c'est pareil. Quoi qu'il arrive, il colore tout à sa manière. D'aucun parlerait d'un ego démesuré, mais on peut être très humble et avoir une exigence artistique démesurée. La principale raison de sa réussite, pourtant, n'est qu'une petite chanson sans prétention. Tant mieux. « J'ai demandé à la lune », trois phrases poétiques et évocatrices. C'est un texte populaire, de bon goût avec une magie de trois minutes, hasard d’une convergence entre la voix, le texte et l'arrangement. Ceci n'est pas encore touché par le formatage culturel parce que le produit est trop réduit, trop minime. A l'inverse, un récit de 300 pages ne pourrait plus sortir sans être formaté. Il y a des choses qu'on ne doit plus dire et des thèmes à proscrire. Céline ne pourrait plus écrire mais faire de la variété : « J'ai demandé à la nuit » ou « Voyage au bout de la lune ». On en est là. Et c'est vous, médias, qui l'acceptez. Et étudiants et universitaires qui ne ruez pas dans les brancards ! Les jeunes ne mesurent pas comment un Zola ne peut plus exister aujourd’hui. Les enseignants n'en parlent pas car eux-mêmes ne le savent pas. C'est le même problème pour le cinéma. Quelle production cinématographique aujourd’hui existerait dont le synopsis ferait plus de quatre lignes ? Le synopsis d’Armageddon par exemple, fait une ligne- On est loin des invraisemblables labyrinthes dialectiques de Choderlos de Laclos (Ndlr : Les liaisons dangereuses) … !
Propos recueillis le 9 mars 2004.
************************************************************************************************************************