Gérard Manset : Le Langage oublié
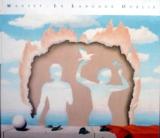
Par Louis-Julien Nicolaou/Arnaud Viviant "Les Inrockuptibles" Février 2004
Le Langage oublié, ce disque pas facile, est dédié par Manset à “Bernard (Estardy) pour sa disponibilité et son irréductible talent néandertal”. Ici, c’est le mot “néandertal” qui est important.
Ainsi qu’à “d’autres marcheurs arrêtés, croisés ici et là et incitant par leurs résolutions à ne pas vouloir savoir que le monde change, à persévérer, à ne pas s’effacer, dilués tandis que tout s’éteint ” Ici, tous les mots sont importants.
Emballé sous un triste Magritte de 1942, quand la Belgique vivait sous la botte nazie, autre chose que Dutroux, ce Langage oublié (qui s’appelait, dans une époque quasi néandertalienne, le français ; souvenez-vous, c’était une langue qui ressemblait un peu à de l’italien, en plus triste, avec laquelle certains, dont G. M., ont écrit de grandes chansons) est un disque comme un crachat gelé à la face du monde en mouvement.
Les gamins qui rêvent aux 70's, qui chinent à la recherche d’un pouf en Skaï ou d’un mange-disque en plastique mauve, les retrouveront ici, intacts : avec leur haine de la soumission (Mensonge aux foules, espèce de reggae !), leur haine de la déploration (A quoi sert ?) et de l’idiote tristesse (Quand on perd un ami/C’est peut-être qu’il dort?).
Cette sorte de dinosaure qu’est Manset enregistre fort heureusement ce chef-d’œuvre anachronique comme si le temps s’était arrêté en 1975, dans “un musée de cire“, sous des “lampes amies“. Alors que la technologie des studios change, nous revoici avec le son et le talent intacts de Animal on est mal et du Royaume de Siam.
Authenticité est un gros mot. Mais la fidélité est une valeur. Comme Manset le chante avec exactitude : “Quand rien n’est plus ce qu’il était avant/ Souvenez-vous de ces chansons anciennes.“
***********************************************************************************************************************
Rare, discret, il se montre peu, ne donne pas de concerts. Mais il a beaucoup bourlingué.
Pour L'Express, le chanteur évoque son nouvel album, ses voyages et ses périples intérieurs.
Suivre Gérard Manset depuis Animal on est mal (1968) ou le découvrir aujourd'hui avec Le Langage oublié (Capitol/EMI), son 15e album, c'est ouvrir des portes sur l'imaginaire, explorer des jeux de piste ésotériques, entrer dans l'univers des ailleurs. Manset, 58 ans, est un poète visionnaire qui - ni prophète ni maître - a décidé de s'effacer derrière les mots. Adepte de l'écriture automatique, il chante d'une voix tremblée des textes traversés par la lumière, la solitude, les oiseaux aux yeux malades, le froid des marbres, les enfants abandonnés... C'est un compositeur exigeant qui couve ses disques de A à Z mais n'a jamais donné de concerts. Un photographe reconnu qui a cadré des centaines de visages mais refuse de livrer le sien.
Pour certains, Manset l'invisible s'apparente à une énigme indéchiffrable. Il a ses fidèles, ses chapelles et un disque culte à son actif: La Mort d'Orion (1970), ou l'histoire d'un peuple maudit version opéra rock. Pour d'autres, Manset est juste un artiste en mouvement qui ne se laisse pas capturer. Pourtant, l'homme est disponible. Il écrit pour ses collègues chanteurs (Gréco, Raphaël, Indochine...). Une après-midi de février, le voilà donc en jean baskets, précis dans ses termes et grand amateur de Perrier. Manset parle sans s'économiser du Langage oublié, un disque pessimiste, plein de guitares orageuses, de cordes lyriques et même de reggae. Il est inquiet et ses lunettes noires font parfois écran. Mais, pour L'Express, Manset raconte ses voyages intérieurs et au long cours, accompagnant cet autoportrait sensible d'une série de photos inédites prises au gré de ses destinations.
«Tant qu'il est encore temps, j'incite esthètes, nomades, poètes irrationnels à passer ne serait-ce que quarante-huit heures à Calcutta ou à Bangkok»
Sa carte du monde
Manset a beaucoup bourlingué. «Il voyage en solitaire» - le titre d'une de ses chansons - sans guide touristique, sans traducteur. «Les voyages m'ont apporté un équilibre. C'était pour moi le seul moyen de me rapprocher de la vérité étymologique du monde: la faim, c'était la faim; la douleur, la douleur; l'amour, l'amour.» Flâneur insatiable, il fait confiance à ce qu'il appelle le «processus de découvertes», c'est-à-dire marcher à l'étoile et se laisser porter par les ambiances romanesques - les ruelles de Naples, les bâtiments cachés de Saint-Pétersbourg, les rives du Gange. «Ces traques permanentes me renvoient aux grandes vadrouilles de mon enfance, aux parties de chasse. Je me sens alors estomaqué, des pétales s'ouvrent... J'entre dans un diaporama grandiose et inimaginable.»
Le chanteur a accumulé des milliers de photos et les a récemment numérisées, classées, mises en page en vue de la publication d'un livre, Journées ensoleillées, collection d'images prises sur les cinq continents depuis vingt-cinq ans. «A cette occasion, j'ai effectué un retour en arrière: ça fait chaud au cœur, froid dans le dos, car j'ai mesuré très précisément le mensonge généralisé de l'époque.» Il pointait déjà en 1991, dans la chanson Tristes Tropiques, «ces atlantides qui s'engloutissent». «Tant qu'il est encore temps, j'incite esthètes, nomades, poètes irrationnels à passer ne serait-ce que quarante-huit heures à Calcutta ou à Bangkok. Car le monde change à toute vitesse, il a presque définitivement changé. Avant, lorsqu'on débarquait en Inde, on regardait, les yeux exorbités, des chiens, des cafards, des gosses. La pureté des choses et des êtres était d'autant plus spectaculaire qu'elle n'était pas protégée. Maintenant, la planète arrive dans votre télé. Le choc est atténué.» Et les voyages se font en comités d'entreprise. Aujourd'hui, Manset appuie sur pause: «L'âge, la fatigue. Le coureur Manset est ''fixé'', et autour de lui tout tourbillonne, est flou.»
Vers les chemins oubliés
Pour lui, le monde ment, et ces mensonges reviennent à nier un langage oublié, ancestral, qui donne le titre à son nouvel album. «Lorsqu'on se réveille sous les tropiques, éclairé par une lumière flamboyante, on mesure que seuls comptent le silence, la lumière, la propreté des sentiments. C'est emmerdant d'être passéiste, mais il suffirait de dire aux gens que rien n'est perdu, que l'on peut encore se marier normalement et être heureux. C'est Héloïse et Abélard, Roméo et Juliette, L'Assommoir. J'ai les pages exactes de Zola, quand Coupeau, l'ouvrier zingueur, entre en relation avec Gervaise, la lingère, devant un café de Paris. C'est une rencontre remplie de pudeur et de délicatesse. Ces petites lavandières de Zola, on les croise encore, loin, en Asie peut-être...» Manset croit «en la probabilité réelle des destinées, en la philosophie du bouddhisme, à la pratique religieuse, aux rites». Il est d'ailleurs très marqué par l'Amérique latine: «Je m'y sens chez moi.»
Ses pensées nomades
«L'écriture monte en moi le matin. Je sais dans quelle condition je dois me tenir pour que ça pète, pareil à un joueur de poker qui boit de l'eau et dort bien pour être dans les meilleures dispositions.» Ses textes sont nés dans des chambres d'Asie, au royaume de Siam, à Sumatra ou à La Havane... «Cette histoire de création est fragile. Il ne faut pas laisser passer les voix à la Jeanne d'Arc.» Selon Manset, l'inspiration est «à 30% héréditaire»: «C'est dans les gènes ou non. Quelques-uns l'ont: Trenet l'avait; Brel, non, c'était un tâcheron, mais il arrivait à atteindre le merveilleux. Gainsbourg l'a dévoyée. Avec le recul, je me rends compte que j'ai eu aussi cette inspiration brute au moment d'Animal on est mal... Ensuite, 30% vient du tempérament. Le reste relève de la clairvoyance et du travail bien fait - pareil à l'ébénisterie.»
Manset écrit d'un coup, avant que les mots ne s'échappent: «J'attrape ces chansons de la même manière qu'un gosse attrape les truites. Le plus troublant est que cette inspiration ne se tarit pas et qu'elle jaillit, toujours différente. Quand je note: «A un jet de pierre/ le bonheur est passé'', je sais que le reste va suivre. Quelque chose me disait: «Laisse venir, fais confiance.''» Manset se définit comme quelqu'un de très à part: «Je ne suis pas sur la même ligne de départ que les autres, mais je ne me plains pas. J'ai un passé, un public. Je suis auteur, compositeur, interprète, orchestrateur, voyageur, photographe, jésuite... et peut-être aussi vieux diplodocus pérennisant l'acte poétique.»
Les périples intérieurs
Parmi ses quelques livres de chevet figurent La Femme et le pantin, de Pierre Louÿs, et Les Filles du feu, de Nerval. Dix pages de Sylvie suffisent à le transporter: «Nerval, c'est la délicatesse, l'harmonie, la correction, le langage oublié. C'est le petit Gérard se rendant à Loisy pour revoir celle qu'il a connue jeune dentellière. Je cherche dans la littérature des frères de sang comme lui. Lorsque je lis ses livres, je suis gonflé à bloc et je deviens moi-même un «frère de sang''.»
Ses voyages vers l'enfance
L'enfant est au cœur de ses chansons, passées ou présentes. Il court de par son monde, il habite ses photos, il hante ses textes: gamins des banlieues nord de Paris, filles des jardins d'antan, mômes clonés du XXIe siècle. «Ma quête personnelle reste un voyage permanent au pays du petit Manset que j'étais. Je l'ai recherché dans des endroits similaires à ceux où j'avais vécu à 5, 8 ou 12 ans. J'ai grandi à Saint-Cloud, qui a été ratiboisé depuis, mais des petits Saint-Cloud, il y en avait partout, à Calcutta ou au Brésil, le long de n'importe quelle route de Thaïlande. Tous ces gosses dont je parle, que je photographie, sont des petits Gérard aux cheveux à rebrousse, malicieux, déconneurs, potes avec tout le monde. Moi, je l'aime bien, ce petit Gérard. Pendant longtemps, je ne me suis posé aucune question sur lui. Puis j'ai réalisé que je ne m'en souvenais plus trop. Mes parents m'en parlaient bien, on l'évoquait à la troisième personne...»
****************************************************************************************************************************************
Après six ans d’absence, Gérard Manset sort en toute discrétion un nouvel album : Le langage oublié
Alors, spontanément on l’achète, comme ça, sans réfléchir, un peu comme un paquet de clopes ou le journal. Forcément, puisque depuis une trentaine d’années, on achète dès leur sortie, tous les disques de Gérard Manset. Qu’importe si on n’avait pas été très enthousiasmé par les derniers travaux de l’artiste, Revivre (1991), La vallée de la paix (1994), Jadis et naguère (1998) car on aime Manset comme une insomnie, quand on est sûr d’être le dernier à veiller à cette heure-là, seul lucide. De ne partager avec personne d’autre, le velours noir et glacé d’une oeuvre construite autour d’un monde où les mots et les notes sont autant de portes vers l’innocence perdue. Je m’attendais donc à un bon disque puisque dans la production de l’artiste, la médiocrité est à tout jamais bannie mais de là à retrouver la force des albums mythiques de la qualité de Royaume de Siam, L’atelier du crabe, Lumières ou Matrice, fichtre non ! C’est qu’il a retrouvé le désespoir enthousiaste, l’animal !
Bon d’accord, ceux qui ne sont pas sensibles à l’univers maudit et désolé de Manset, à cette oeuvre minérale, sédimentaire qui nous conte, album après album, l’inexorable effacement des lois de la nature et de la chose humaine, ne seront pas plus séduits par ce 17 ème opus que par les précédents. Mais les autres, « marcheurs arrêtés » croisés ici ou là, incitant par leur résolution à ne pas vouloir savoir que le monde change, à persévérer, à ne pas s’effacer, dilué tandis que tout s’éteint, ceux là même jetant leur âme à la mer sur lit de sable glacé, y trouveront leur bonheur, fut-il au prix du renoncement à l’illusoire et au cynisme de la médiocrité ambiante.
Un bien beau CD que ce Langage oublié, présenté sous une pochette cartonnée, illustrée par un tableau de René Magritte, Mesdemoiselles de L’Isle-Adam (1942), histoire sans doute d’apporter en trompe l’oeil, un peu de douceur au propos sombre et sans concession qu’il met en sons, comme à son habitude, seul maître à bord de son vaisseau fantôme (paroles, musiques, orchestrations). Fidèle à sa pensée comme à son écriture, dès les premières notes de l’intro, l’univers manséen est en place : un accord de guitare saturé, une basse, des choeurs à peine audibles sur lesquels vient se poser la voix, très légèrement réverbérée, presque blanche. Le ton est acéré et le propos explicite :
Demain il fera nuit…
… Et les enfants iront
De porte en porte, de ville en ville
Et les rats s’enfuiront
« Demain il fera nuit »
Les dix titres de l’album défilent ainsi, développant toujours la même thématique, celle d’un monde dérisoire, fini, auquel l’artiste oppose la nostalgie d’un passé révolu tel ce « coureur arrêté » déambulant dans on ne sait quelle salle des pas perdus, désertée, hostile, dans on ne sait quelle gare, Cathédrale rieuse / Comme une fleur exquise / sur sa tige dressée / Dans l’urine des chiens alors qu’« À un jet de pierre » (chanson miraculeuse), le bonheur est passé se tenant les paupières comme un grand blessé.
Seuls les rythmes apportent un peu de respiration à cet album d’une rare intensité dont la clef de voûte semble bien être Le langage oublié, oratorio majestueux et funèbre de la veine de La mort d’Orion (1970). La musique symphonique aux résonances cosmiques nous embarque pour les tréfonds de cette langue oubliée dont l’encre même à l’air d’avoir fondu. Magistral. En contraste, le titre suivant, « Que ne fus-tu » en forme de litanie folk désossée, est dépouillé de tout artifice, juste quelques notes d’une guitare au son écorché accompagnant une voix éraillée saisissante de douleur.
Autre très belle réussite, un peu à part dans l’album, « Quand on perd un ami », chanson au tempo lent qui pourrait apparaître conventionnelle s’il n’y avait pas les fulgurances d’un texte dérivant vers un autre univers, vers d’autres sherpas faits de gel, de bois mort et de fakir embaumé. Il est bien difficile de ne pas s’émouvoir de cette voix devenue fragile, à la limite de la plainte.
Par rapport aux albums précédents, il y a néanmoins un grand changement, puisque notre solitaire parle d’amour : Aimons-nous ma mie s’il est temps / Tandis que du bord de l’étang / On voit la fin des derniers temps (« La fin du dernier monde connu ») ou encore « Dans les jardins du XXIe siècle », Où les enfants clonés jouent sous les arbres / là où le chagrin la gaieté, ont la couleur du marbre / Souviens-toi que je t’aime. L’amour rédempteur, chose nouvelle chez notre solitaire, apporte tout de même quelques lueurs désespoir à cette fin du dernier monde connu, fin du dernier monde humain où l’honnête homme devient la cible tandis que le bandit s’en va satisfait.
Que l’on partage ou non l’idée de perdition véhiculée par l’artiste, on ne peut qu’être séduit par la qualité des textes, des musiques, arrangements et orchestrations réalisées par Manset. Et puis de toute façon, ce disque n’est pas un disque, pas plus un disque de rock, que de chansons françaises, c’est juste l’expression d’un art à part entière portée à son incandescence, fut-il fait de cendres. D’ailleurs, l’artiste n’a pas de message à délivrer, juste une expression, un langage à revendiquer, un langage fait de poésie, de sensibilité et, paradoxalement, de lumière.
Alors même si Gérard Manset parle un langage oublié, essayez quand même de l’écouter, des fois que ce langage rendrait heureux le genre humain. Certes, l’exercice n’est pas facile, sans doute plusieurs écoutes seront nécessaires mais lorsque le choc se produit, tout s’éclaire :
Aujourd’hui c’est hier, hier c’était demain
L’homme et la femme allaient par le même chemin
Où serons-nous nous-même
Un jour
De nouveau.
NB : CAPITOL / EMI FRANCE nous informe au verso de la pochette que « ce disque contient un dispositif technique limitant les possibilités de copie » de sorte que « sur certains lecteurs vous pouvez rencontrer des problèmes de lecture ». Résultat : si l’album passe correctement sur la platine de salon, je ne peux écouter que les 3 premiers titres sur le lecteur DVD/CD de mon PC, pourtant récent (2001) ! Sans doute, le risque était réel de voir des millions de copies du Langage oublié inonder les marchés français, américain et asiatique ! Dérisoire.
De lui, ils ont pris le goût du travail solitaire, du voyage intérieur et de la rigueur revendiquée. Le rejet de la facilité chansonnière chez Dominique A ; la fabrication intime d'une poésie ancrée dans des terroirs, des constats, les fêlures de la voix, pour Murat (La Fin des derniers temps en est un exemple dans le cas présent) ; les sombres étendues de la mélancolie traduites en rock pour Bashung, un contemporain de Gérard Manset, dont le succès n'éclatera cependant que dix ans après Animal on est mal, publié en 1968.
On ne suivra donc pas Gérard Manset sur le terrain mouvant et banal du petit reggae de circonstance (Mensonge aux foules), de l'accordéon rapporté (Le Coureur arrêté), ou de la rythmique balloche (A un jet de pierre). Des scories qui prêtent un flanc presque
masochiste à la critique - aisée quand on n'a pas saisi pourquoi Manset demeurait un chanteur culte, de cette catégorie d'artistes qui, éternellement absents des images médiatiques, surgissent au palmarès des meilleures ventes au lendemain de la mise en rayon d'un album. Et puis repartent au royaume des inclassables.
Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissez : ceci est une chanson qui appartient désormais à Juliette Gréco, parce que Manset la lui a donnée et qu'elle en a fait une somptueuse perle noire - et le titre de son disque paru cet hiver. Le musicien n'est pas content de l'habillage qui en a été fait, pourtant dans la droite ligne de l'immense vague à l'âme dépeint par ce traqueur d'enfance (innocente) et de royaumes (immaculés) en état de perdition.
Ce qui ajoute encore à la noirceur de la vision du Gérard Manset des Langages oubliés, c'est l'inexorable effacement des lois de la nature et de la chose humaine :
"Dans les jardins du XXIe siècle/ Où les enfants clonés jouent sous les arbres... En ce jardin maudit du XXI e siècle/ Où les enfants mauvais jouent sous les branches/ A quelques faux moineaux jetant de fausses miettes", écrit-il dans Les Jardins du XXIe siècle, prémonition de la folie qui guette. Ce titre ferme Le Langage oublié, recueil de dix thèmes ouverts aux forceps par Demain il fera nuit : "Et les enfants iront/ De porte en porte, de ville en ville/ Et les rats s'enfuiront."
Gérard Manset a pour habitude de tout faire lui-même, du texte aux couches multiples des voix et instruments. Fidèle à une pensée, fidèle à une écriture, il est reconnaissable à la première mesure - un accord de guitare saturé, une basse, des envolées, des chœurs,
de la pierre et du cosmique. Une voix sur la corde, un ton acéré, une opération de commando.
Jusqu'alors, ces exercices de droiture situés entre humanisme et misanthropie s'appuyaient sur une sainte horreur de l'excès. Le Langage oublié rompt avec ces habitudes.
Gérard Manset en serait presque impudique, libéré de l'obligation de traiter de la ligne de partage entre le vice et la vertu, haussant le ton jusqu'au cri (Quand on perd un ami, sur un voile de guitare instable, de piano céleste), psalmodiant dans un désordre effarant :
"Que ne fus-tu une autre mère, que ne fus-tu un songe/ Dans ce passé amer... Que ne fus-tu une autre, que ne fus-tu une autre/ Car tout commence/ En ce temps sans défense".
Douche froide, brûlot, prétexte à la détestation du passé, au bannissement du futur, Le Langage oublié exècre les mécréants. Il est en ce sens ultraconservateur, y compris dans ses influences musicales - du beau Manset des années d'avant. Mais il est aussi d'une trop rare intensité.
Le Langage oublié, Gérard Manset. 1 CD Capitol/EMI.
***********************************************************************************************************************
Que dire d’un nouvel album de Gérard Manset ? Le personnage est si atypique, si exigeant que tout commentaire se révèle vite superflu. Ne reste qu’à écouter ce sublime « Langage oublié » et apprécier le travail sonore dense et léonin réalisé ici. Un album de chair et de sang, de lumière et d’horizons. A travers le regard de Manset, nous partageons ses mystères. Écouter cet album et, inévitablement, se replonger dans ses créations antérieures, c’est voguer vers l’inconnu. Après, rien n’est comme avant. Vous pensiez être terriblement ancré dans le réel ? Vous faites erreur car le réel n’est que la fusion des rêves enfouis et de la noire réalité du monde actuel. En témoigne le Magritte choisi pour illustrer la pochette ; le peintre belge a été le promoteur d’un surréalisme jouant sur la réalité et l’imaginaire sans que l’on sache réellement où situer la fêlure. Retiré depuis six années de la scène musicale médiatique qu’il ne fréquente guère, il a cependant continué à lancer des mots et des musiques par l’intermédiaire de passeurs aussi divers que talentueux : Gréco, Birkin, Indochine, Raphaël… On retiendra de cet album conçu entre 2001 et 2003 dans trois studios différents, les superbes périodes « Le coureur arrêté » et « Le langage oublié », piliers d’un édifice émaillé de références subtiles et à l’architecture complexe et précise. L’album offert ne nous entraîne certes pas hors des sentiers battus, la route Manset n’est pas des plus directes mais elle commence à être connue. On ne change donc pas les clés… et pourtant, les serrures se sont transformées. Les paroles demeurent sombres, mais le son est plus distancié, les guitares troublantes mais les claviers plus apaisants et apaisés. Moins énigmatique que ses œuvres précédentes, le nouvel opus est plus digeste, peut-être car certaines perles se révèlent musicalement moins hermétiques et verbalement plus accessibles tels l’émouvant « Quand on perd un ami » ou le titre conclusif « Dans les jardins du XXIème siècle ». On oscille entre reggae instable (« Mensonge aux foules »), traits de cordes plaintifs sur « Que ne fus-tu », réalisé en une prise, parenthèse idéalisée de l’enfance libre et libérée, sessions toujours très rock, notamment sur le titre d’ouverture « Demain il fera nuit ». Manset chante, Manset parle… des paradis perdus, du « langage oublié », celui du délicat, du raffiné, du concis, contre le vulgaire et la soumission. Un opus comme un « jet de pierre », titre superbement conclu par huit notes, trois mesures de cordes… Juste ce qu’il faut. Histoire de « prolonger un peu plus ce besoin de vivre »…
Par JPP - Platine n° 110 - Avril 2004
**********************************************************************************************************************
Ce n’est pas tous les jours que le créateur de La Mort d’Orion, (chef d'œuvre intemporel) se rappelle à notre bon souvenir. Quelques signes avant-coureurs de son retour imminent avaient résonné à nos oreilles, ces derniers mois, l’homme avait paré de quelques traces sonores, les albums de Juliette Greco et…d'Indochine. Avec Le Langage Oublié. Gérard Manset renoue avec les atmosphères avec lesquelles il nous a conquis, celles de Y'a Une Route ou de l’album blanc.
Ce Langage Oublié, porte la patte Manset : des textes intimistes et précis {aucun mot n'est là par hasard), des orchestrations hyper travaillées (Parfois grandiloquentes - Reconnaissons le - mais n'est-ce pas ce que l’on aime chez lui ? -) et la voix au grain unique, habitent cet album, le-dix-septième du nom. Largement mésestimé dans notre petit Hexagone, qui craque aux entournures, même s'il dispose d'une aura et d'un capital sympathie indéniable, Gérard Manset a su - et ce dès son premier enregistrement qui date de 1968- décomplexer les Français face au savoir-faire anglo-saxon en matière d'arrangements et d'orchestrations. Artiste aux multiples facettes, Gérard Manset partage son temps entre la peinture, la photographie et la musique, cette dernière semblant prendre le dessus ces derniers temps, réjouissons-nous. Le Langage Oublié, contient quelques perles tel le titre "Quand on perd un ami", poignant et magnifique, ou "Le langage oublié", sublime. Car Gérard Manset n'a jamais dévié de la route qu'il s'est tracée, il y a près d'un demi-siècle, si bien que certains titres comme "A un jet de pierre" auraient pu se trouver dans l'un de ses plus anciens albums, Il faut dire qu’il fut toujours - et demeure - terriblement en avance sur son temps. Gérard Manset, c'est un peu notre Beatle(s) à nous, et de cela, nous sommes très fiers.
Nadia & Dom Sarraï-Desseigne pour Crossroads n°19 (Mars 2004)
**********************************************************************************************************************
En éternel poète maudit, Gérard Manset chante sur les décombres du monde
Pour « Le Temps » (01/2016)
D'animal on est mal », son premier titre en 1968, au « Langage oublié », son nouvel album, il a marqué son œuvre d'une noirceur sublime.
Depuis l'apparition du disque laser, il réédite, remasterise, compile en l'expurgeant son propre répertoire, essentiellement paru en vinyle. La démarche pouvait faire penser que ce savant artisan avait sa carrière derrière lui. Pourtant, ça et là, quelques inédits venaient en dire plus ou moins long sur l'état de son inspiration : sombre et désolée avec de parcimonieuses éclaircies. Ainsi des « Artificiers du décadent », chanson en forme d'état des lieux qui stigmatisait une société ayant pris « le mépris comme fer de lance », Gérard Manset, figure hors norme et sciemment en marge de la chanson française, refuse toujours les prestations scéniques.
Le chanteur d’« Animal on est mal », son titre inaugural datant de mai 1968, juge indécent et impudique de se retrouver exposé telle une bête de foire. Rien de méprisant là-dedans, juste l'envie absolue de se consacrer à son œuvre enregistrée, en rat de studio qu'est ce Parisien distant mais pas hautain. Après six ans d’errance, un roman et son pendant photographique, l'inusable Manset a aussi appris par cœur le manuel d'utilisation de Pro Tools, logiciel incontournable de la création numérisée. Un acquis qui permet à l'auteur, compositeur, interprète et ingénieur du son de livrer avec Le Langage oublié l'un de ses albums les plus luxuriants.
Guitares acérées et cordes mystiques
Six ans après Jadis et naguère, dernier album original, Manset empile les couches sonores dans une cathédrale où règnent tour à tour les atmosphères mystérieuses et romantiques, plombées et aériennes. Entre guitares acérées effrayantes et synthétiseurs apaisants, cordes mystiques et rythmiques élégiaques, Manset perpétue cet univers grave qu'il a bâti au fil des décennies et des sillons. De son opéra métaphysique La mort d'Orion au nomade et polyglotte Royaume de Siam via l'existentialiste et sublime Y'a une route et son hymne collant « II voyage en solitaire ». Autant de jalons discographiques qui ont fait de Manset une sorte de poète maudit admiré par ses pairs (Murat, Bashung, Cabrel, Christophe ou Françoise Hardy, certains figurant sur l'album hommage Route Manset) mais mésestimé par le grand public.
Doublé de ce chant de ruine qui burine ses chansons au fer noir, Le Langage oublié empile les thèmes tragiques. Point de salut pour les âmes de notre civilisation, celles d'une « époque à vomir » toujours, qui errent au cœur des chansons : « Demain il fera nuit », « Mensonge aux foules » ou « La Fin du dernier monde connu ».
Véritable brûlot par endroit, Le Langage oublié peut aussi s'écouter comme un S.O.S. échappé des décombres. L'appel désespéré d'un Manset en quête perpétuelle d'un paradis perdu. Et qui continue, à près de 60 ans, de questionner en chansons, pour ne pas perdre la raison.
***************************************************************************************************************************************
Dans les notes de pochette de son nouvel album, Gérard Manset remercie ceux qui « par leur résolution à ne pas vouloir savoir que le monde a changé - à persévérer, à ne pas s'effacer... » Cette affirmation, doublée par un titre faussement cryptique - Le langage oublié - pose, les bases de l'engagement renouvelé du hérault des routards seventies qui persiste dans sa ligne de prophète de l’apocalypse sociétale. En dix chansons sans âge — cet album qui paraît maintenant a été enregistré entre 2001 et 2002, il aurait pu l'être, il y a dix ans... - Manset se drape dans les oripeaux expiatoires du Croisée. Lourds et sérieusement contrits, ses textes ne connaissent que le premier degré d'un lyrisme exacerbé.
Parfois, le combattant pose les armes- et il n'en est que plus touchant — dans "À quoi sert"? « A quoi sert de pleurer » ? Sur ce qui n'est plus ». À la guitare acoustique, de sa seule voix en lamento implorant, Gérard Manset a ce ton de prédicateur qui s'insinue. Le dépouillement musical sied davantage au créateur de « La mort d'Orion » (1970) - et « Y'a une route » (1975) que les arrangements dont il gratifie son « Langage oublié » de la même couleur musicale que son précédent « Jadis et naguère » (1998) : datés et un peu confits dans les guitares réverbérisées.
Comme un document, il est néanmoins plaisant de recroiser la route d'un artiste hors mode, en marge de tous les courants.
Valeur sûre : Manset fait du Manset. Il y a quelque chose de rassurant dans cette immuable persévérance.
*************************************************************************************************************************************
Le Langage oublié, ce disque pas facile, est dédié par Manset à “Bernard (Estardy) pour sa disponibilité et son irréductible talent néandertal”. Ici, c’est le mot “néandertal” qui est important.
Ainsi qu’à “d’autres marcheurs arrêtés, croisés ici et là et incitant par leurs résolutions à ne pas vouloir savoir que le monde change, à persévérer, à ne pas s’effacer, dilués tandis que tout s’éteint ” Ici, tous les mots sont importants.
Emballé sous un triste Magritte de 1942, quand la Belgique vivait sous la botte nazie, autre chose que Dutroux, ce Langage oublié (qui s’appelait, dans une époque quasi néandertalienne, le français ; souvenez-vous, c’était une langue qui ressemblait un peu à de l’italien, en plus triste, avec laquelle certains, dont G. M., ont écrit de grandes chansons) est un disque comme un crachat gelé à la face du monde en mouvement.
Les gamins qui rêvent aux 70's, qui chinent à la recherche d’un pouf en Skaï ou d’un mange-disque en plastique mauve, les retrouveront ici, intacts : avec leur haine de la soumission (Mensonge aux foules, espèce de reggae !), leur haine de la déploration (A quoi sert ?) et de l’idiote tristesse (Quand on perd un ami/C’est peut-être qu’il dort?).
Cette sorte de dinosaure qu’est Manset enregistre fort heureusement ce chef-d’œuvre anachronique comme si le temps s’était arrêté en 1975, dans “un musée de cire“, sous des “lampes amies“. Alors que la technologie des studios change, nous revoici avec le son et le talent intacts de Animal on est mal et du Royaume de Siam.
Authenticité est un gros mot. Mais la fidélité est une valeur. Comme Manset le chante avec exactitude : “Quand rien n’est plus ce qu’il était avant/ Souvenez-vous de ces chansons anciennes.“
***********************************************************************************************************************
Gérard Manset : Sur la route
par Gilles Médioni pour
L’Express (8/3/2004)
Rare, discret, il se montre peu, ne donne pas de concerts. Mais il a beaucoup bourlingué.
Pour L'Express, le chanteur évoque son nouvel album, ses voyages et ses périples intérieurs.
Suivre Gérard Manset depuis Animal on est mal (1968) ou le découvrir aujourd'hui avec Le Langage oublié (Capitol/EMI), son 15e album, c'est ouvrir des portes sur l'imaginaire, explorer des jeux de piste ésotériques, entrer dans l'univers des ailleurs. Manset, 58 ans, est un poète visionnaire qui - ni prophète ni maître - a décidé de s'effacer derrière les mots. Adepte de l'écriture automatique, il chante d'une voix tremblée des textes traversés par la lumière, la solitude, les oiseaux aux yeux malades, le froid des marbres, les enfants abandonnés... C'est un compositeur exigeant qui couve ses disques de A à Z mais n'a jamais donné de concerts. Un photographe reconnu qui a cadré des centaines de visages mais refuse de livrer le sien.
Pour certains, Manset l'invisible s'apparente à une énigme indéchiffrable. Il a ses fidèles, ses chapelles et un disque culte à son actif: La Mort d'Orion (1970), ou l'histoire d'un peuple maudit version opéra rock. Pour d'autres, Manset est juste un artiste en mouvement qui ne se laisse pas capturer. Pourtant, l'homme est disponible. Il écrit pour ses collègues chanteurs (Gréco, Raphaël, Indochine...). Une après-midi de février, le voilà donc en jean baskets, précis dans ses termes et grand amateur de Perrier. Manset parle sans s'économiser du Langage oublié, un disque pessimiste, plein de guitares orageuses, de cordes lyriques et même de reggae. Il est inquiet et ses lunettes noires font parfois écran. Mais, pour L'Express, Manset raconte ses voyages intérieurs et au long cours, accompagnant cet autoportrait sensible d'une série de photos inédites prises au gré de ses destinations.
«Tant qu'il est encore temps, j'incite esthètes, nomades, poètes irrationnels à passer ne serait-ce que quarante-huit heures à Calcutta ou à Bangkok»
Sa carte du monde
Manset a beaucoup bourlingué. «Il voyage en solitaire» - le titre d'une de ses chansons - sans guide touristique, sans traducteur. «Les voyages m'ont apporté un équilibre. C'était pour moi le seul moyen de me rapprocher de la vérité étymologique du monde: la faim, c'était la faim; la douleur, la douleur; l'amour, l'amour.» Flâneur insatiable, il fait confiance à ce qu'il appelle le «processus de découvertes», c'est-à-dire marcher à l'étoile et se laisser porter par les ambiances romanesques - les ruelles de Naples, les bâtiments cachés de Saint-Pétersbourg, les rives du Gange. «Ces traques permanentes me renvoient aux grandes vadrouilles de mon enfance, aux parties de chasse. Je me sens alors estomaqué, des pétales s'ouvrent... J'entre dans un diaporama grandiose et inimaginable.»
Le chanteur a accumulé des milliers de photos et les a récemment numérisées, classées, mises en page en vue de la publication d'un livre, Journées ensoleillées, collection d'images prises sur les cinq continents depuis vingt-cinq ans. «A cette occasion, j'ai effectué un retour en arrière: ça fait chaud au cœur, froid dans le dos, car j'ai mesuré très précisément le mensonge généralisé de l'époque.» Il pointait déjà en 1991, dans la chanson Tristes Tropiques, «ces atlantides qui s'engloutissent». «Tant qu'il est encore temps, j'incite esthètes, nomades, poètes irrationnels à passer ne serait-ce que quarante-huit heures à Calcutta ou à Bangkok. Car le monde change à toute vitesse, il a presque définitivement changé. Avant, lorsqu'on débarquait en Inde, on regardait, les yeux exorbités, des chiens, des cafards, des gosses. La pureté des choses et des êtres était d'autant plus spectaculaire qu'elle n'était pas protégée. Maintenant, la planète arrive dans votre télé. Le choc est atténué.» Et les voyages se font en comités d'entreprise. Aujourd'hui, Manset appuie sur pause: «L'âge, la fatigue. Le coureur Manset est ''fixé'', et autour de lui tout tourbillonne, est flou.»
Vers les chemins oubliés
Pour lui, le monde ment, et ces mensonges reviennent à nier un langage oublié, ancestral, qui donne le titre à son nouvel album. «Lorsqu'on se réveille sous les tropiques, éclairé par une lumière flamboyante, on mesure que seuls comptent le silence, la lumière, la propreté des sentiments. C'est emmerdant d'être passéiste, mais il suffirait de dire aux gens que rien n'est perdu, que l'on peut encore se marier normalement et être heureux. C'est Héloïse et Abélard, Roméo et Juliette, L'Assommoir. J'ai les pages exactes de Zola, quand Coupeau, l'ouvrier zingueur, entre en relation avec Gervaise, la lingère, devant un café de Paris. C'est une rencontre remplie de pudeur et de délicatesse. Ces petites lavandières de Zola, on les croise encore, loin, en Asie peut-être...» Manset croit «en la probabilité réelle des destinées, en la philosophie du bouddhisme, à la pratique religieuse, aux rites». Il est d'ailleurs très marqué par l'Amérique latine: «Je m'y sens chez moi.»
Ses pensées nomades
«L'écriture monte en moi le matin. Je sais dans quelle condition je dois me tenir pour que ça pète, pareil à un joueur de poker qui boit de l'eau et dort bien pour être dans les meilleures dispositions.» Ses textes sont nés dans des chambres d'Asie, au royaume de Siam, à Sumatra ou à La Havane... «Cette histoire de création est fragile. Il ne faut pas laisser passer les voix à la Jeanne d'Arc.» Selon Manset, l'inspiration est «à 30% héréditaire»: «C'est dans les gènes ou non. Quelques-uns l'ont: Trenet l'avait; Brel, non, c'était un tâcheron, mais il arrivait à atteindre le merveilleux. Gainsbourg l'a dévoyée. Avec le recul, je me rends compte que j'ai eu aussi cette inspiration brute au moment d'Animal on est mal... Ensuite, 30% vient du tempérament. Le reste relève de la clairvoyance et du travail bien fait - pareil à l'ébénisterie.»
Manset écrit d'un coup, avant que les mots ne s'échappent: «J'attrape ces chansons de la même manière qu'un gosse attrape les truites. Le plus troublant est que cette inspiration ne se tarit pas et qu'elle jaillit, toujours différente. Quand je note: «A un jet de pierre/ le bonheur est passé'', je sais que le reste va suivre. Quelque chose me disait: «Laisse venir, fais confiance.''» Manset se définit comme quelqu'un de très à part: «Je ne suis pas sur la même ligne de départ que les autres, mais je ne me plains pas. J'ai un passé, un public. Je suis auteur, compositeur, interprète, orchestrateur, voyageur, photographe, jésuite... et peut-être aussi vieux diplodocus pérennisant l'acte poétique.»
Les périples intérieurs
Parmi ses quelques livres de chevet figurent La Femme et le pantin, de Pierre Louÿs, et Les Filles du feu, de Nerval. Dix pages de Sylvie suffisent à le transporter: «Nerval, c'est la délicatesse, l'harmonie, la correction, le langage oublié. C'est le petit Gérard se rendant à Loisy pour revoir celle qu'il a connue jeune dentellière. Je cherche dans la littérature des frères de sang comme lui. Lorsque je lis ses livres, je suis gonflé à bloc et je deviens moi-même un «frère de sang''.»
Ses voyages vers l'enfance
L'enfant est au cœur de ses chansons, passées ou présentes. Il court de par son monde, il habite ses photos, il hante ses textes: gamins des banlieues nord de Paris, filles des jardins d'antan, mômes clonés du XXIe siècle. «Ma quête personnelle reste un voyage permanent au pays du petit Manset que j'étais. Je l'ai recherché dans des endroits similaires à ceux où j'avais vécu à 5, 8 ou 12 ans. J'ai grandi à Saint-Cloud, qui a été ratiboisé depuis, mais des petits Saint-Cloud, il y en avait partout, à Calcutta ou au Brésil, le long de n'importe quelle route de Thaïlande. Tous ces gosses dont je parle, que je photographie, sont des petits Gérard aux cheveux à rebrousse, malicieux, déconneurs, potes avec tout le monde. Moi, je l'aime bien, ce petit Gérard. Pendant longtemps, je ne me suis posé aucune question sur lui. Puis j'ai réalisé que je ne m'en souvenais plus trop. Mes parents m'en parlaient bien, on l'évoquait à la troisième personne...»
****************************************************************************************************************************************
MANSET 2004 : LE LANGAGE OUBLIÉ
Après six ans d’absence, Gérard Manset sort en toute discrétion un nouvel album : Le langage oublié
Alors, spontanément on l’achète, comme ça, sans réfléchir, un peu comme un paquet de clopes ou le journal. Forcément, puisque depuis une trentaine d’années, on achète dès leur sortie, tous les disques de Gérard Manset. Qu’importe si on n’avait pas été très enthousiasmé par les derniers travaux de l’artiste, Revivre (1991), La vallée de la paix (1994), Jadis et naguère (1998) car on aime Manset comme une insomnie, quand on est sûr d’être le dernier à veiller à cette heure-là, seul lucide. De ne partager avec personne d’autre, le velours noir et glacé d’une oeuvre construite autour d’un monde où les mots et les notes sont autant de portes vers l’innocence perdue. Je m’attendais donc à un bon disque puisque dans la production de l’artiste, la médiocrité est à tout jamais bannie mais de là à retrouver la force des albums mythiques de la qualité de Royaume de Siam, L’atelier du crabe, Lumières ou Matrice, fichtre non ! C’est qu’il a retrouvé le désespoir enthousiaste, l’animal !
Bon d’accord, ceux qui ne sont pas sensibles à l’univers maudit et désolé de Manset, à cette oeuvre minérale, sédimentaire qui nous conte, album après album, l’inexorable effacement des lois de la nature et de la chose humaine, ne seront pas plus séduits par ce 17 ème opus que par les précédents. Mais les autres, « marcheurs arrêtés » croisés ici ou là, incitant par leur résolution à ne pas vouloir savoir que le monde change, à persévérer, à ne pas s’effacer, dilué tandis que tout s’éteint, ceux là même jetant leur âme à la mer sur lit de sable glacé, y trouveront leur bonheur, fut-il au prix du renoncement à l’illusoire et au cynisme de la médiocrité ambiante.
Un bien beau CD que ce Langage oublié, présenté sous une pochette cartonnée, illustrée par un tableau de René Magritte, Mesdemoiselles de L’Isle-Adam (1942), histoire sans doute d’apporter en trompe l’oeil, un peu de douceur au propos sombre et sans concession qu’il met en sons, comme à son habitude, seul maître à bord de son vaisseau fantôme (paroles, musiques, orchestrations). Fidèle à sa pensée comme à son écriture, dès les premières notes de l’intro, l’univers manséen est en place : un accord de guitare saturé, une basse, des choeurs à peine audibles sur lesquels vient se poser la voix, très légèrement réverbérée, presque blanche. Le ton est acéré et le propos explicite :
Demain il fera nuit…
… Et les enfants iront
De porte en porte, de ville en ville
Et les rats s’enfuiront
« Demain il fera nuit »
Les dix titres de l’album défilent ainsi, développant toujours la même thématique, celle d’un monde dérisoire, fini, auquel l’artiste oppose la nostalgie d’un passé révolu tel ce « coureur arrêté » déambulant dans on ne sait quelle salle des pas perdus, désertée, hostile, dans on ne sait quelle gare, Cathédrale rieuse / Comme une fleur exquise / sur sa tige dressée / Dans l’urine des chiens alors qu’« À un jet de pierre » (chanson miraculeuse), le bonheur est passé se tenant les paupières comme un grand blessé.
Seuls les rythmes apportent un peu de respiration à cet album d’une rare intensité dont la clef de voûte semble bien être Le langage oublié, oratorio majestueux et funèbre de la veine de La mort d’Orion (1970). La musique symphonique aux résonances cosmiques nous embarque pour les tréfonds de cette langue oubliée dont l’encre même à l’air d’avoir fondu. Magistral. En contraste, le titre suivant, « Que ne fus-tu » en forme de litanie folk désossée, est dépouillé de tout artifice, juste quelques notes d’une guitare au son écorché accompagnant une voix éraillée saisissante de douleur.
Autre très belle réussite, un peu à part dans l’album, « Quand on perd un ami », chanson au tempo lent qui pourrait apparaître conventionnelle s’il n’y avait pas les fulgurances d’un texte dérivant vers un autre univers, vers d’autres sherpas faits de gel, de bois mort et de fakir embaumé. Il est bien difficile de ne pas s’émouvoir de cette voix devenue fragile, à la limite de la plainte.
Par rapport aux albums précédents, il y a néanmoins un grand changement, puisque notre solitaire parle d’amour : Aimons-nous ma mie s’il est temps / Tandis que du bord de l’étang / On voit la fin des derniers temps (« La fin du dernier monde connu ») ou encore « Dans les jardins du XXIe siècle », Où les enfants clonés jouent sous les arbres / là où le chagrin la gaieté, ont la couleur du marbre / Souviens-toi que je t’aime. L’amour rédempteur, chose nouvelle chez notre solitaire, apporte tout de même quelques lueurs désespoir à cette fin du dernier monde connu, fin du dernier monde humain où l’honnête homme devient la cible tandis que le bandit s’en va satisfait.
Que l’on partage ou non l’idée de perdition véhiculée par l’artiste, on ne peut qu’être séduit par la qualité des textes, des musiques, arrangements et orchestrations réalisées par Manset. Et puis de toute façon, ce disque n’est pas un disque, pas plus un disque de rock, que de chansons françaises, c’est juste l’expression d’un art à part entière portée à son incandescence, fut-il fait de cendres. D’ailleurs, l’artiste n’a pas de message à délivrer, juste une expression, un langage à revendiquer, un langage fait de poésie, de sensibilité et, paradoxalement, de lumière.
Alors même si Gérard Manset parle un langage oublié, essayez quand même de l’écouter, des fois que ce langage rendrait heureux le genre humain. Certes, l’exercice n’est pas facile, sans doute plusieurs écoutes seront nécessaires mais lorsque le choc se produit, tout s’éclaire :
Aujourd’hui c’est hier, hier c’était demain
L’homme et la femme allaient par le même chemin
Où serons-nous nous-même
Un jour
De nouveau.
NB : CAPITOL / EMI FRANCE nous informe au verso de la pochette que « ce disque contient un dispositif technique limitant les possibilités de copie » de sorte que « sur certains lecteurs vous pouvez rencontrer des problèmes de lecture ». Résultat : si l’album passe correctement sur la platine de salon, je ne peux écouter que les 3 premiers titres sur le lecteur DVD/CD de mon PC, pourtant récent (2001) ! Sans doute, le risque était réel de voir des millions de copies du Langage oublié inonder les marchés français, américain et asiatique ! Dérisoire.
********************************************************************************************************************** GÉRARD MANSET, LE RETOUR
D'UN SOLITAIRE
par Véronique Mortaigne / LE MONDE | 22.03.2004
Quelle
incertitude ! Que les temps sont maudits ! C'est à en trembler, suggère
Gérard Manset, qui publie Le Langage oublié, six ans
après Jadis et naguère, dix ans après La Vallée de la paix - des titres
en forme d'itinéraire de retour. L'influence de Manset a été
considérable sur les deux générations de chanteurs-poètes
exigeants qui ont suivi : Alain Bashung, Jean-Louis Murat, Dominique A.par Véronique Mortaigne / LE MONDE | 22.03.2004
De lui, ils ont pris le goût du travail solitaire, du voyage intérieur et de la rigueur revendiquée. Le rejet de la facilité chansonnière chez Dominique A ; la fabrication intime d'une poésie ancrée dans des terroirs, des constats, les fêlures de la voix, pour Murat (La Fin des derniers temps en est un exemple dans le cas présent) ; les sombres étendues de la mélancolie traduites en rock pour Bashung, un contemporain de Gérard Manset, dont le succès n'éclatera cependant que dix ans après Animal on est mal, publié en 1968.
On ne suivra donc pas Gérard Manset sur le terrain mouvant et banal du petit reggae de circonstance (Mensonge aux foules), de l'accordéon rapporté (Le Coureur arrêté), ou de la rythmique balloche (A un jet de pierre). Des scories qui prêtent un flanc presque
masochiste à la critique - aisée quand on n'a pas saisi pourquoi Manset demeurait un chanteur culte, de cette catégorie d'artistes qui, éternellement absents des images médiatiques, surgissent au palmarès des meilleures ventes au lendemain de la mise en rayon d'un album. Et puis repartent au royaume des inclassables.
Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissez : ceci est une chanson qui appartient désormais à Juliette Gréco, parce que Manset la lui a donnée et qu'elle en a fait une somptueuse perle noire - et le titre de son disque paru cet hiver. Le musicien n'est pas content de l'habillage qui en a été fait, pourtant dans la droite ligne de l'immense vague à l'âme dépeint par ce traqueur d'enfance (innocente) et de royaumes (immaculés) en état de perdition.
Ce qui ajoute encore à la noirceur de la vision du Gérard Manset des Langages oubliés, c'est l'inexorable effacement des lois de la nature et de la chose humaine :
"Dans les jardins du XXIe siècle/ Où les enfants clonés jouent sous les arbres... En ce jardin maudit du XXI e siècle/ Où les enfants mauvais jouent sous les branches/ A quelques faux moineaux jetant de fausses miettes", écrit-il dans Les Jardins du XXIe siècle, prémonition de la folie qui guette. Ce titre ferme Le Langage oublié, recueil de dix thèmes ouverts aux forceps par Demain il fera nuit : "Et les enfants iront/ De porte en porte, de ville en ville/ Et les rats s'enfuiront."
Gérard Manset a pour habitude de tout faire lui-même, du texte aux couches multiples des voix et instruments. Fidèle à une pensée, fidèle à une écriture, il est reconnaissable à la première mesure - un accord de guitare saturé, une basse, des envolées, des chœurs,
de la pierre et du cosmique. Une voix sur la corde, un ton acéré, une opération de commando.
Jusqu'alors, ces exercices de droiture situés entre humanisme et misanthropie s'appuyaient sur une sainte horreur de l'excès. Le Langage oublié rompt avec ces habitudes.
Gérard Manset en serait presque impudique, libéré de l'obligation de traiter de la ligne de partage entre le vice et la vertu, haussant le ton jusqu'au cri (Quand on perd un ami, sur un voile de guitare instable, de piano céleste), psalmodiant dans un désordre effarant :
"Que ne fus-tu une autre mère, que ne fus-tu un songe/ Dans ce passé amer... Que ne fus-tu une autre, que ne fus-tu une autre/ Car tout commence/ En ce temps sans défense".
Douche froide, brûlot, prétexte à la détestation du passé, au bannissement du futur, Le Langage oublié exècre les mécréants. Il est en ce sens ultraconservateur, y compris dans ses influences musicales - du beau Manset des années d'avant. Mais il est aussi d'une trop rare intensité.
Le Langage oublié, Gérard Manset. 1 CD Capitol/EMI.
***********************************************************************************************************************
Que dire d’un nouvel album de Gérard Manset ? Le personnage est si atypique, si exigeant que tout commentaire se révèle vite superflu. Ne reste qu’à écouter ce sublime « Langage oublié » et apprécier le travail sonore dense et léonin réalisé ici. Un album de chair et de sang, de lumière et d’horizons. A travers le regard de Manset, nous partageons ses mystères. Écouter cet album et, inévitablement, se replonger dans ses créations antérieures, c’est voguer vers l’inconnu. Après, rien n’est comme avant. Vous pensiez être terriblement ancré dans le réel ? Vous faites erreur car le réel n’est que la fusion des rêves enfouis et de la noire réalité du monde actuel. En témoigne le Magritte choisi pour illustrer la pochette ; le peintre belge a été le promoteur d’un surréalisme jouant sur la réalité et l’imaginaire sans que l’on sache réellement où situer la fêlure. Retiré depuis six années de la scène musicale médiatique qu’il ne fréquente guère, il a cependant continué à lancer des mots et des musiques par l’intermédiaire de passeurs aussi divers que talentueux : Gréco, Birkin, Indochine, Raphaël… On retiendra de cet album conçu entre 2001 et 2003 dans trois studios différents, les superbes périodes « Le coureur arrêté » et « Le langage oublié », piliers d’un édifice émaillé de références subtiles et à l’architecture complexe et précise. L’album offert ne nous entraîne certes pas hors des sentiers battus, la route Manset n’est pas des plus directes mais elle commence à être connue. On ne change donc pas les clés… et pourtant, les serrures se sont transformées. Les paroles demeurent sombres, mais le son est plus distancié, les guitares troublantes mais les claviers plus apaisants et apaisés. Moins énigmatique que ses œuvres précédentes, le nouvel opus est plus digeste, peut-être car certaines perles se révèlent musicalement moins hermétiques et verbalement plus accessibles tels l’émouvant « Quand on perd un ami » ou le titre conclusif « Dans les jardins du XXIème siècle ». On oscille entre reggae instable (« Mensonge aux foules »), traits de cordes plaintifs sur « Que ne fus-tu », réalisé en une prise, parenthèse idéalisée de l’enfance libre et libérée, sessions toujours très rock, notamment sur le titre d’ouverture « Demain il fera nuit ». Manset chante, Manset parle… des paradis perdus, du « langage oublié », celui du délicat, du raffiné, du concis, contre le vulgaire et la soumission. Un opus comme un « jet de pierre », titre superbement conclu par huit notes, trois mesures de cordes… Juste ce qu’il faut. Histoire de « prolonger un peu plus ce besoin de vivre »…
Par JPP - Platine n° 110 - Avril 2004
**********************************************************************************************************************
Ce n’est pas tous les jours que le créateur de La Mort d’Orion, (chef d'œuvre intemporel) se rappelle à notre bon souvenir. Quelques signes avant-coureurs de son retour imminent avaient résonné à nos oreilles, ces derniers mois, l’homme avait paré de quelques traces sonores, les albums de Juliette Greco et…d'Indochine. Avec Le Langage Oublié. Gérard Manset renoue avec les atmosphères avec lesquelles il nous a conquis, celles de Y'a Une Route ou de l’album blanc.
Ce Langage Oublié, porte la patte Manset : des textes intimistes et précis {aucun mot n'est là par hasard), des orchestrations hyper travaillées (Parfois grandiloquentes - Reconnaissons le - mais n'est-ce pas ce que l’on aime chez lui ? -) et la voix au grain unique, habitent cet album, le-dix-septième du nom. Largement mésestimé dans notre petit Hexagone, qui craque aux entournures, même s'il dispose d'une aura et d'un capital sympathie indéniable, Gérard Manset a su - et ce dès son premier enregistrement qui date de 1968- décomplexer les Français face au savoir-faire anglo-saxon en matière d'arrangements et d'orchestrations. Artiste aux multiples facettes, Gérard Manset partage son temps entre la peinture, la photographie et la musique, cette dernière semblant prendre le dessus ces derniers temps, réjouissons-nous. Le Langage Oublié, contient quelques perles tel le titre "Quand on perd un ami", poignant et magnifique, ou "Le langage oublié", sublime. Car Gérard Manset n'a jamais dévié de la route qu'il s'est tracée, il y a près d'un demi-siècle, si bien que certains titres comme "A un jet de pierre" auraient pu se trouver dans l'un de ses plus anciens albums, Il faut dire qu’il fut toujours - et demeure - terriblement en avance sur son temps. Gérard Manset, c'est un peu notre Beatle(s) à nous, et de cela, nous sommes très fiers.
Nadia & Dom Sarraï-Desseigne pour Crossroads n°19 (Mars 2004)
**********************************************************************************************************************
En éternel poète maudit, Gérard Manset chante sur les décombres du monde
Pour « Le Temps » (01/2016)
D'animal on est mal », son premier titre en 1968, au « Langage oublié », son nouvel album, il a marqué son œuvre d'une noirceur sublime.
Depuis l'apparition du disque laser, il réédite, remasterise, compile en l'expurgeant son propre répertoire, essentiellement paru en vinyle. La démarche pouvait faire penser que ce savant artisan avait sa carrière derrière lui. Pourtant, ça et là, quelques inédits venaient en dire plus ou moins long sur l'état de son inspiration : sombre et désolée avec de parcimonieuses éclaircies. Ainsi des « Artificiers du décadent », chanson en forme d'état des lieux qui stigmatisait une société ayant pris « le mépris comme fer de lance », Gérard Manset, figure hors norme et sciemment en marge de la chanson française, refuse toujours les prestations scéniques.
Le chanteur d’« Animal on est mal », son titre inaugural datant de mai 1968, juge indécent et impudique de se retrouver exposé telle une bête de foire. Rien de méprisant là-dedans, juste l'envie absolue de se consacrer à son œuvre enregistrée, en rat de studio qu'est ce Parisien distant mais pas hautain. Après six ans d’errance, un roman et son pendant photographique, l'inusable Manset a aussi appris par cœur le manuel d'utilisation de Pro Tools, logiciel incontournable de la création numérisée. Un acquis qui permet à l'auteur, compositeur, interprète et ingénieur du son de livrer avec Le Langage oublié l'un de ses albums les plus luxuriants.
Guitares acérées et cordes mystiques
Six ans après Jadis et naguère, dernier album original, Manset empile les couches sonores dans une cathédrale où règnent tour à tour les atmosphères mystérieuses et romantiques, plombées et aériennes. Entre guitares acérées effrayantes et synthétiseurs apaisants, cordes mystiques et rythmiques élégiaques, Manset perpétue cet univers grave qu'il a bâti au fil des décennies et des sillons. De son opéra métaphysique La mort d'Orion au nomade et polyglotte Royaume de Siam via l'existentialiste et sublime Y'a une route et son hymne collant « II voyage en solitaire ». Autant de jalons discographiques qui ont fait de Manset une sorte de poète maudit admiré par ses pairs (Murat, Bashung, Cabrel, Christophe ou Françoise Hardy, certains figurant sur l'album hommage Route Manset) mais mésestimé par le grand public.
Doublé de ce chant de ruine qui burine ses chansons au fer noir, Le Langage oublié empile les thèmes tragiques. Point de salut pour les âmes de notre civilisation, celles d'une « époque à vomir » toujours, qui errent au cœur des chansons : « Demain il fera nuit », « Mensonge aux foules » ou « La Fin du dernier monde connu ».
Véritable brûlot par endroit, Le Langage oublié peut aussi s'écouter comme un S.O.S. échappé des décombres. L'appel désespéré d'un Manset en quête perpétuelle d'un paradis perdu. Et qui continue, à près de 60 ans, de questionner en chansons, pour ne pas perdre la raison.
***************************************************************************************************************************************
Manset fait du Manset
par Xavier Alonso pour le quotidien 24 Heures (11/3/2004)
Dans les notes de pochette de son nouvel album, Gérard Manset remercie ceux qui « par leur résolution à ne pas vouloir savoir que le monde a changé - à persévérer, à ne pas s'effacer... » Cette affirmation, doublée par un titre faussement cryptique - Le langage oublié - pose, les bases de l'engagement renouvelé du hérault des routards seventies qui persiste dans sa ligne de prophète de l’apocalypse sociétale. En dix chansons sans âge — cet album qui paraît maintenant a été enregistré entre 2001 et 2002, il aurait pu l'être, il y a dix ans... - Manset se drape dans les oripeaux expiatoires du Croisée. Lourds et sérieusement contrits, ses textes ne connaissent que le premier degré d'un lyrisme exacerbé.
Parfois, le combattant pose les armes- et il n'en est que plus touchant — dans "À quoi sert"? « A quoi sert de pleurer » ? Sur ce qui n'est plus ». À la guitare acoustique, de sa seule voix en lamento implorant, Gérard Manset a ce ton de prédicateur qui s'insinue. Le dépouillement musical sied davantage au créateur de « La mort d'Orion » (1970) - et « Y'a une route » (1975) que les arrangements dont il gratifie son « Langage oublié » de la même couleur musicale que son précédent « Jadis et naguère » (1998) : datés et un peu confits dans les guitares réverbérisées.
Comme un document, il est néanmoins plaisant de recroiser la route d'un artiste hors mode, en marge de tous les courants.
Valeur sûre : Manset fait du Manset. Il y a quelque chose de rassurant dans cette immuable persévérance.
*************************************************************************************************************************************