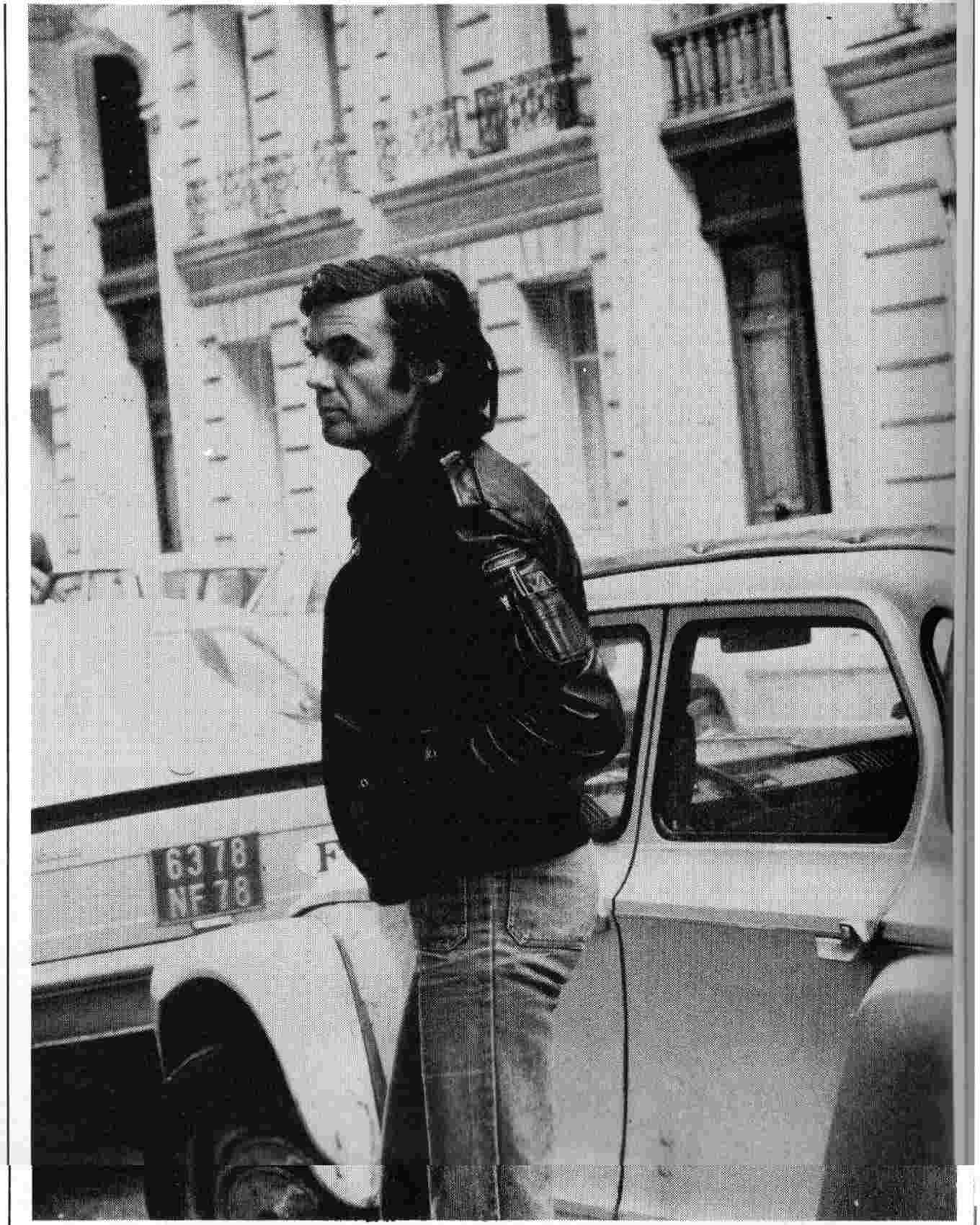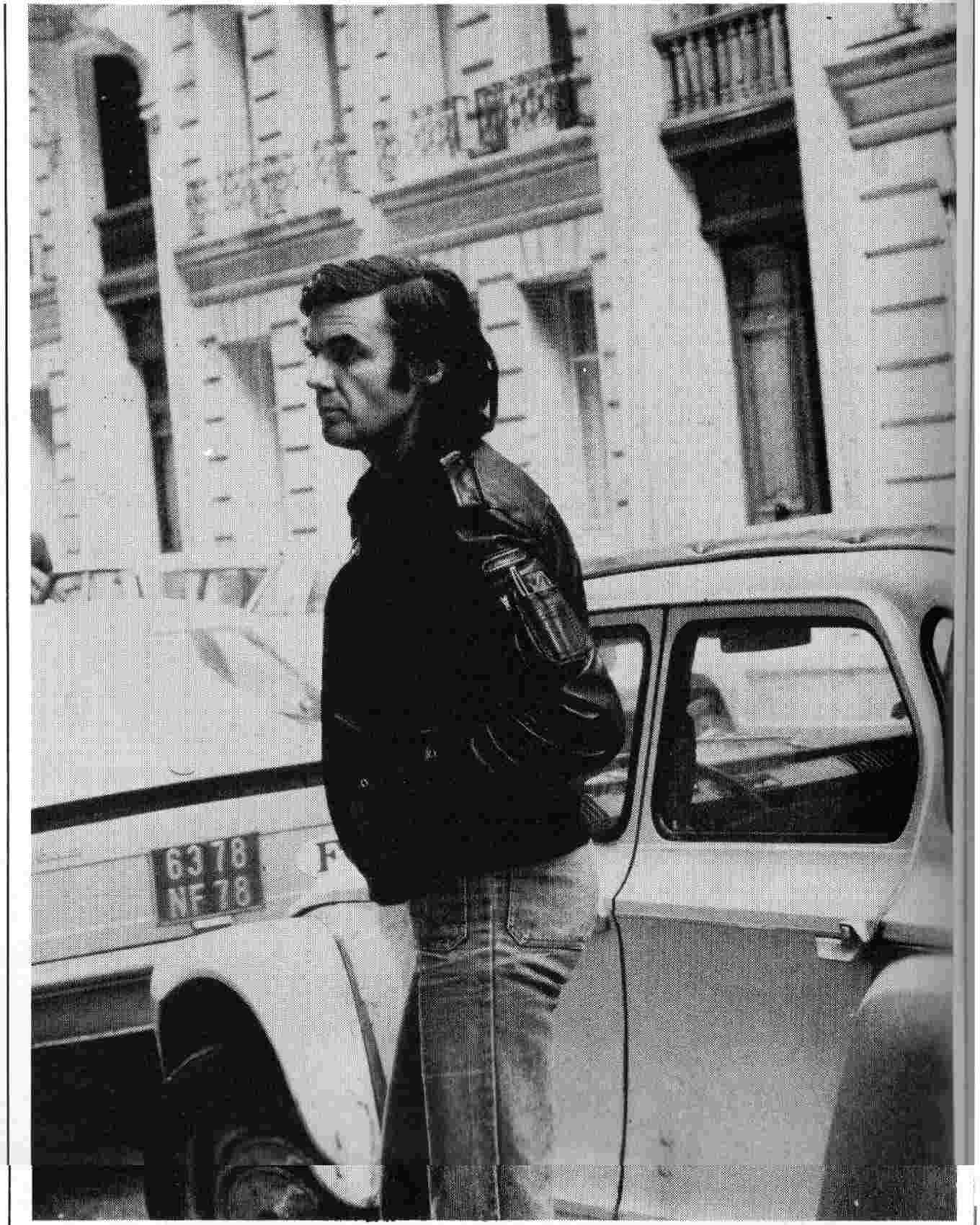GÉRARD
MANSET : OGRE DOUX
Gérard
Manset fait escale à Paris et ouvre son cœur secret rempli d'ombres et
d'ors enfouis.
Et
puis il reprend son voyage [en solitaire] au bout de l'ennui.
Rock’n’Folk
par Bruno T.(Printemps 1981)
«
Je n'ai rien à raconter, je vis un éternel été, sans édredon sans
oreiller, je dors toujours du même côté. »
«
Je ne parle plus beaucoup. Répondre, ça me plaît bien de temps en
temps, avec quelqu'un de précis... mais, me définir…. »...
Je
suis passé par des étapes successives. Différentes. Des « mues ». Il
faudrait donc me demander plutôt de définir quelles étapes. Celle
d'aujourd'hui n’est peut-être pas vraie. Celle d'hier non plus... Je
n'en sais rien. Une seule chose est certaine: bien qu'étant toujours le
même à l'intérieur, peut-être, je n'apparais pas comme étant le même à
travers ces différentes étapes. Il y a cinq ans, je donnais - qui sait
? - l'impression d'être plus naturel. Ou moins naturel. L'image que je
donne aujourd'hui de moi est sans doute plus conforme à ce que les gens
attendaient ou à ce qu'ils pensent que je suis à l'intérieur. Je me
suis rasé la barbe ; c'est la seule chose concrète et précise
qui
peut sembler différente. Mais à part ça... difficile à dire. Je vais
essayer d'être clair, simple et bref. Il faut ça. J'ai tellement
l'impression de dire n'importe quoi... La seule différence, le fait
capital –capital !- qui, pour moi, à titre privé, intime est
dramatique, c'est que je suis passé du stade de la montée à celui de la
descente.
«
JE SUIS CAPABLE DE REPRENDRE LE DIALOGUE AVEC MOI-MÊME ET MON REGARD
N'EST PLUS FIXÉ SUR LE VIDE TOTAL. »
R
& F — Tu peux préciser ?
Gérard
Manset - Pendant des années, j'ai eu une activité cérébrale, physique,
de plus en plus élaborée, constructive; pendant des années, je n'ai
vécu que dans les faits. Il y a deux choses différentes et très, très
importantes que tout le monde, dans le domaine artistique, se doit de
vivre au moins une fois dans sa vie. Je pense que beaucoup d'artistes
crèvent sans avoir pu les connaître. Moi, je les ai déjà vécues et je
n'ai malheureusement que trente-cinq ans. Et je me demande ce que je
vais pouvoir vivre après... Les deux moments, ce sont les suivants : le
premier consiste à se dire chaque matin pendant des années, quand on
touche à toutes les techniques artistiques, qu'on écrit, qu'on peint, a
se redire tous les matins, tous les soirs, au moment où l'on note sur
un bout de papier une phrase, une idée, un mot, quelque chose qui n'est
pas forcément original, à se répéter qu'il faut « mettre de côté’ ».
Parce qu'on a peur, que le temps passe vite, et qu'on sait que quand on
crée, c'est à vingt ans, vingt-deux, vingt-cinq ans. Pas à
soixante-dix. Et on empile, on empile tout ça, et on se dit: « Le jour
où j'aurai le temps... » Et puis un jour arrive – quand on a mon
caractère ou dans certaines circonstances - où on a enfin la
possibilité de se dire : « Bon, ras-le-bol. J'arrête tout. Je ne vais
pas jouer au con avec tous les oiseaux qui m'entourent jusqu'à la fin
de mes jours. Là, c'est fini. J'en ai assez vu. »
Ce
jour-là, tous les bouts de papier qu'on a mis de côté - c'est une image
- on les développe. Ce jour-là, on peint, on écrit, on fait ce qu'on
devait faire, ce qu’on se retenait de faire depuis toujours. Du jour au
lendemain, je me suis ainsi retrouvé - parce que j'ai un caractère
constructif - à m'asseoir dans cette situation et à construire quelque
chose qui soit plausible. Je m'installe - ici - de manière à n'avoir
plus à faire que créer, inventer, composer, écrire, peindre...
R
& F — Quand ?
G.M.
— Il y a trois ans, à peu près. Donc, du jour au lendemain je suis
libre. Sans problème financier - puisque pendant dix ans, auparavant,
j'ai trimé comme dix en cumulant les fonctions (compositeur, auteur,
interprète, éditeur, photographe, chez Pathé; et fermons vite cette
parenthèse de production d'ii y a dix ans : j'étais très jeune (rires
!) — je me retrouve ici et je fais des choses qui m'intéressent. Je
continue d'ailleurs sur la lancée le trente centimètres que j'étais en
train de faire : « 2870 » — je crois que je mixais. Et je me suis rendu
compte, alors, tout de suite, de deux choses. D'abord, quand tu as
peint deux, trois heures, que tu as écrit une heure ou deux, et que tu
te lèves tôt comme moi, eh bien il te reste une journée à remplir!
C'est très dur. Ensuite, si tu retires tous ces contacts complètement
superficiels liés à l'énergie que tu dépenses quand tu as encore des
rapports avec les gens, si tu retires ça, eh bien ta journée devient
vide. C'est le problème de l'effort physique par rapport à l'effort
mental. Si tu n'as plus que l'effort mental, tu ne peux pas...
Je
me suis donc retrouvé avec les deux tiers de mes journées disponibles.
J'arrivais à peu près à « m'occuper ». Pendant un
an, ça a
été. A peu près. J'ai peint, j'ai écrit; et le disque, ce genre de
choses, ça continuait tout seul.
LES
CONVERSATIONS M’ENNUIENT, FAIRE DES VISITES M’ENNUIE, LES JOIES ET LES
PEINES DES GENS DE
MA
FAMILLE M'ENNUIENT JUSQU'AU FOND DE L’ÂME.
Mais
quoi faire après, avec tout ça ? Je suis allé rôder dans deux ou trois
galeries de peinture - je n'y connaissais rien - et j'ai réalisé que je
n'avais pas les contacts. C'est un monde mort. Il n'y a rien. A partir
du moment où tu comprends bien que si tu peins c'est sans espoir de
débouchés, tu te rends compte d'une certaine stérilité de la chose.
Ah! Là, tu t'es fait avoir ! (Manset sourit.)
R
& F - Quoi? Le flash a déconné ?
G.M.
- Là, tu t'es fait avoir ! (Gérard se marre.) Ça n'a pas marché.
R & F — Oh, tant pis.
Tout à l'heure, tu avais senti le flash ? Pour les oreilles
(je voulais dire «les yeux », c'est un lapsus singulier), ce n'était pas douloureux ?
(Manset éclate de rire ! Un moment. s'écoule, qui tisse - à l'écoute de
l'interview - une sorte de rapport un peu « paternel » entre le
journaliste à la gomme empêtré dans ses incohérences et la
vedette interviewée qui manifeste beaucoup « d'indulgence » à l'égard
de l’histrion hirsute du micro désordre et du flash fou.)
G.M.
— Ça y est ! « Gérard Manset est mort parce qu'on l'a pris en photo. Le
flash l'a tué ! On l'a sorti de la rue des ….par les pieds l... »
(Rires prolongés.)
R
& F — Bon. Donc, tu peins et tu écris pendant un an...
G.M.
— Oui, je peux m'installer. En me disant que je vais enfin pouvoir
enfoncer le clou, faire quelque chose complètement, savoir si je suis
un créateur ou pas, si je peux tenir la distance ou pas. Et finalement,
je ne peux pas. Je n'ai rien à dire. Par contre, j'ai trouvé le style
que je voulais dans l'écriture.
R
& F — En marge des chansons ? C'est de quel ordre ? Fiction ?
Réflexion ?
G.M.
- C'est inspiré par certains voyages que j'ai faits. Je me suis rendu
compte que, n'ayant pas vécu, je ne pouvais rien écrire. Une stérilité
totale ! C'est facile, en deux minutes, sur une chanson. Mais cent
pages, deux cents, trois cents pages. Moi, tout me fait chier. Tout ce
que je lis. Il n'y a que le vécu qui existe. Donc, le vécu, pour
pouvoir l'écrire il faut le vivre. J'ai décidé d'aller vivre. Et voilà.
C'est pour ça que depuis trois ans je me suis tiré tout seul, plusieurs
fois par an, en Asie.
R
& F — Tu t’ennuies, quoi? Tu vis trois heures par jour. Et
après,
tu te traînes ? Et c'est le matin, apparemment, ces trois heures ?
G.M.
- Oui. Ça sort très vite. C'est vraiment l’inspiration à l'état pur. Je
sais dans quel état je dois être, quel état d'esprit, quelles
circonstances, et ça sort. Quand ça sort, j'arrive à endiguer quelque
chose, à tenir le cheval, et ça dure un certain temps. Mais ça retombe.
Et quand c'est retombé, je me mets à tourner en rond. Et puis je
redeviens petit à petit moi-même. Et là, je n'ai plus aucune raison
d'être, dans cette pièce ou dans... C'est « déplacé ». Je ne sais pas
ce que je fais ici. Je sors et je deviens quelqu'un comme tout le
monde. Malheureusement, j'ai cette particularité, par rapport aux
autres, que je m'ennuie. J'ai envie de jouer aux échecs, mais ça me
fait chier de jouer aux échecs.
J'ai
envie d'aller au ciné, mais le ciné m'emmerde. J'ai envie de lire, mais
je ne peux pas lire plus d'un quart de page... et tout est comme ça. Je
ne regarde pas la télé, je n'écoute pas la radio, je ne vais pas aux
spectacles, tout me fait chier. Tout. Je ne sais pas à quoi ça tient.
C'est devenu une lassitude systématique. Peut-être parce que je sais,
au fond de moi, que ça ne m'apprendra rien. Aujourd'hui il n'y a que le
« vécu » qui m'intéresse, et c'est uniquement ma propre expérience qui
peut m'apporter quelque chose. On va encore me jeter les tomates de
l'égocentrisme, mais je n'y peux rien. C'est comme ça.
DEUX
ENFANTS, SEULS DANS L'APPARTEMENT, MONTÈRENT DANS UNE GRANDE MALLE, LE
COUVERCLE RETOMBA,
ILS NE PURENT PAS L'OUVRIR ET MOURURENT ÉTOUFFÉS.
Un
cheveu très noir et propre. Brillant. Des mains qu’il serre parfois, en
poings rudes, pour s'appuyer sur la moquette de la pièce où nous nous
trouvons. Une sorte de no man's land recueilli. Studio simple et vide.
Gérard Manset est assis contre le mur, sous la fenêtre, lumière à ras
de tête. La plupart du temps par terre. En entrant, on trouve un
placard à gauche et une petite salle d'eau à droite. Puis une grande
salle. Lit noir à droite, et piano - noir aussi - à côté, dans une
alcôve tapissée de tissu noir et blanc. Des photos d'ailleurs au mur.
Paysages d'enfant. Routes. Fleuves endormis. Clongs, filles fleurs de
la Sonde d'azur et baraques sur l'eau. Un bureau à dessus de verre
garni d'étagères en dessous. Blanc. De temps en temps, dans la journée,
il se lèvera, tantôt sur ma demande, tantôt de son propre chef, pour
entrer dans la petite pièce cuisine - emplie à ras-bord de palettes
tachées, chiffons, tasses vides à laver, ustensiles divers - pour nous
préparer du thé. Dans ce réduit-débarras, coincée entre le mur et le
dessous de l'évier, une statue aux cheveux de cuivre et aux yeux dorés,
figée dans une attitude contemplative, semble sourire à la lune. Comme
parfois Gérard Manset lui-même lorsque, méticuleux, au milieu d'une
phrase articulée il suspend ses mots et se tient un bras sur le front.
Sous sa lune intérieure, qui est peut-être le soleil noir de la
mélancolie, l'homme de paille au luth constellé, revenu de loin et
exilé de toujours, ferme son poing de cuir et entrouvre ses dents de
loup. « Les Loups », c'est le titre d'une chanson à venir. Un nouveau
monstre nègre dans le bestiaire magique. Ce parc où vont les bêtes. Sur
lequel, impérial, mi- homme mi- bête, mi- griffe mi- velours, mi-
cuirassé mi- nu, mi- marin mi- terrien, mi- sable mi- roc, pince
entrouverte prête à prendre et main tendue, règne le crabe. Il marche
de travers car sa parole est droite. Yeux nuit et tête noire. Gérard
Manset délivre une nouvelle image : c'est le doux ogre des grands fonds
transparents.
R
& F - Ton enfance ?
G.M.
- J'ai passé mon enfance - pfff - ici, dans le Seizième. Pas loin.
J'allais au lycée je ne sais plus... (Très peu coopératif.)
R
& F — A ce point-là ? Tu ne te souviens plus du nom du lycée ?
G.M.
— Si. Claude Bernard. Et Jean-Baptiste Saye. A un moment, j'ai été
pensionnaire. A Rambouillet. Déjà, j'ai voulu casser quelque chose:
c'est moi qui ai demandé à être pensionnaire.
R
& F — C'était une façon de t'éloigner de tes parents ?
G.M.
— Je me suis toujours très bien entendu avec mes parents. Non, c'était
plutôt - comment dire... - ce besoin, peut-être... déjà,
d'incarcération. (Il sourit.) Non. Je voulais voir les cours, les
ambiances. Je devais avoir treize ou quatorze ans et je voulais voir
si, effectivement, tout ce qu'on racontait était vrai. Tout ce qu'on
raconte dans les bouquins.
R
& F — « Les Disparus de Saint Agil ?...
G.M.
— Voilà. Pas ça, mais tout ce genre de trafics... Et je suis tombé,
vraiment, dans un pensionnat pourri.
R
& F — Tu étais satisfait ?
G.M.
— Oui, oui, oui.
R
& F — C'était dur ?
G.M.
- Non. Pas du tout. Je n'ai pas trouvé ça dur du tout. Mais quand je
repense aux faits précis, c'est ce qu'on dénonce comme trucs un peu
durs. On se levait à six heures. Il n’y avait pas d'eau chaude. On
était quarante ou cinquante par dortoir. Il n'y avait pas de matelas.
C'était des espèces de paillasses. Avec des boules comme ça et des
endroits vides. Une couverture. Tu rentrais chez toi quand tu n'étais
pas collé (et tu avais souvent des raisons d'être collé). Et surtout,
il y avait les plus forts qui faisaient la loi à l'intérieur. Avec
rançons... non, pas rançons...
R
& F - Racket ?
G.M.
- Racket. Sur tous les plans. Des surveillants qui étaient plus ou
moins soudoyés, achetés par certains et pas par d'autres. Enfin,
tout... Service d'ordre à l'intérieur. J'avais treize ans. Il y en
avait de douze ans, onze ans. Ou quinze, seize ans. Rapports de force.
R
& F — Toi, là-dedans, tu te sentais bien ?
G.M.
— Hmmm... J'ai commencé à négocier. C'était vraiment un monde clos.
Avec des rapports de force déjà installés.
LA
PETITE FILLE SALE VETUE D‘UNE CAMISOLE. ELLE COURT PIEDS NUS, LES
CHEVEUX DANS LE VENT.
R
& F — Le thème des enfants dans tes disques ?
G.M.
— Si tu me parles « enfants », je pense «père »... Je suis désolé.
C'est « Le Jour où tu Voudras Partir » : « Il n'y aura plus
de
trains dans les gares... La tête dans les mains pour pleurer... »
R
& F - Ça, c'est le père ?
G.M.
— Ah oui ! Ça ne peut pas être autre chose. Si tu me parles enfants,
c'est le côté tragique de la disparition du père... qui me vient à
l'esprit. Encore une fois, on revient à la «littérature» ; c'est le
côté noir des choses qui l'emporte. Ce n'est pas que le cas de l'enfant
qui est en parfaite harmonie avec ses parents, tout ça, soit
inintéressant — j'en parle aussi, dans « Quand tu Portes
Contre
Ton Cœur » (« Sur tes épaules » ?). Ça existe aussi. Mais
c'est
tellement plus difficile à manier, c'est tellement moins facile à
résumer en quelques mots... Le bonheur, finalement, est beaucoup plus
unique, plus personnel que le malheur. Le malheur, il est universel. On
peut le résumer en trois mots qui sont les mêmes pour tout le monde.
Quelqu'un qui a perdu son père, on le comprend. Un enfant qui est battu
par son père, c'est un état de fait universel que tout le monde
interprète de la même manière. Mais un enfant heureux, ça veut dire
quoi ? C’est la raison pour laquelle on est tenté, lorsqu'on écrit,
d'aller vers le drame, le côté noir - parce que ça inspire plus. Par
ailleurs, il est évident que c'est beaucoup plus facilement négociable,
déterminable, que le bonheur, en règle générale, qui tombe tout de
suite dans la fleur bleue.
R
& F — D'une manière ou d'une autre, quand je parle d'enfants,
ça évoque immédiatement pour toi : le drame ?
G.M.
— Le drame. De toute façon, le drame. Parce que le rapport des
générations se pose d'emblée. Manque de communication. Manque de
dialogue. Quelle que soit l'estime réciproque, bonheur ou pas, de toute
façon il y a incompréhension totale... Surtout, le silence. Quand je
pense à enfants », je pense: « Silence ». Je vois l'enfant entouré de
murs de silence. Pas seulement le silence des adultes. Le silence des
enfants entre eux. Je crois que les enfants, contrairement à ce qu'on
dit, ont infiniment de mal à communiquer entre eux, si ce n’est par des
coups de pieds et des coups de poings - ce qui n'est pas la meilleure
communication possible. Avec le reste du monde, c'est encore plus
difficile. Avec qui est-ce que je vois les enfants communiquer sans
problème ? Avec les animaux. C'est tout. Voilà quelque chose qui me
semble parfait, comme rapport de force : l'enfant et l'animal. Sorti de
là, c'est la merde.
UN
PEU DE CHANT AU-DESSOUS DE MOI. QUELQUES PORTES QUI CLAQUENT DANS LE
CORRIDOR, ET TOUT
EST
PERDU.
Et
la musique, alors? Paradoxalement, Gérard Manset, qui en est et qui en
vit, ne la connaît pour ainsi dire pas. Quand on lui en parle, il donne
des noms, comme ça, pour faire plaisir: « Tiens, Night, par exemple
c'est pas mal, » (Le groupe de Nicky Hopkins a plus de deux ans
d'âge...) Il dit aussi bien aimer Dire Straits, tout en précisant:
« C'est exceptionnel. Normalement, je ne supporte pas les
Anglais. Leonard Cohen, c'est insupportable. »
D'accord.
Mais quel âge a donc Leonard Cohen?! D'ailleurs, lorsqu'on le pousse un
peu sur la question, il avoue qu'il s'en contre-fiche complètement. Ça
ne tient aucune place dans sa vie, et tant mieux.
«
Si j'avais vraiment une vie musicale de ce genre, je me tire une
balle!» Ainsi peut-on comprendre l'univers sonore de l'homme en habit
noir: c'est un étranger. Quand on lui dit: « Nina Hagen », il dit: «
Qui ça ? » Et on a beau lui décrire la bécasse en question, il ne voit
pas. Idem pour Costello. « Qui ? » — Elvis Costello !
Mais
si, tu dois connaître. Un coléreux avec des lunettes, névropathe et
méchant. — « Non. Connais pas »
Il
ne bluffe pas. Et les disques qu'il fait aujourd'hui, du strict point
de vue des références culturelles, pourraient aussi bien être de 1990
que de 1970. Il voit en Brassens l'apothéose de la nullité musicale:
«
En France, la grande majorité des choses est très médiocre. Et je pense
que la totalité de la médiocrité française se trouve concentrée dans la
musique. Si tu n'as pas la réaction d'être horrifié, tu es perdu.
Je
te raconterai tout à l'heure à propos des médailles au Salon des
Artistes. L'académisme. Brassens, par exemple, c'est pour moi le sommet
de la médiocrité en ce qui concerne le côté culturel ou littéraire. Le
ronron. Il n'y avait que des Brassens à cette distribution de médailles
de ma jeunesse. » Manset est très énergique dans ses rejets. Ainsi, à
propos du cinéma français, qu'il déteste cordialement – comme beaucoup
de gens sensés — cite-t-il le nom de Bresson pour affirmer: « Il est à
enfermer. » Ainsi, les seules choses qu'il avoue aimer sont
américaines. Et totalement ahurissantes: «
Récemment, le
seul truc qui m'ait plu, c'est Bob Seger. C'est Mike (Lester, une
production Manset du temps) qui me l'a fait découvrir. Quel
compositeur! Quel talent! Extraordinaire. Ce n'est pas du vieux rock.
C'est autre chose... Bob Seger fait les mêmes chansons que moi. Les
mêmes ! Il dit les mêmes choses, mais il est américain. Moi, quand je
le dis, ça fait étriqué, tandis que lui, ça fait extra.» Déroutant
système de références. Dont la seule ligne de force semble être une
haine féroce de lu médiocrité française par opposition à l'ampleur
américaine: « Le résumé de tout ça, c'est qu'on est dans un petit pays,
qu'on n'a pas de vocation internationale, qu'on a une langue qui n'est
plus reconnue, et qu'on ne sait parler que d'une manière livresque
tragico-théâtrale. Ça répond à cette question que tu me posais:
«Pourquoi toujours le noir, le vide, le silence dans mes textes? » Tu
connais quelqu'un qui sait s'exprimer autrement ? En dehors de Pierre
Dac et Francis Blanche ? Sorti d'eux, tu es obligé de tomber là-dedans.
Il n'y a rien d'autre. C'est « La Mort d'Orion.»
Il faut des envolées de manche, des n'importe quoi ! Ou alors, c'est
Yves Duteil. C'est la guimauve ou le grand guignol. Il n'y a pas le
choix. Et ni l’un ni l'autre ne correspondent à ce dont les jeunes ont
besoin. »
Restent,
au bout, les références intemporelles ou presque : les Beatles.
R
& F — Autrefois, tu te référais fortement à Paul McCartney. En
fait, est-ce que ton personnage ne se rapprocherait pas plus de celui,
ascétique, de John Lennon ? Avec le temps. McCartney s'est arrondi.
Lennon s'était émacié. Toi aussi, non ?
G.M.
— Lennon avait plus l'image d'un « artiste » que Cartney. Cartney a
l'image d'un affairiste, d'un mec qui s'organise comme il veut, qui
sait maîtriser son destin alors que Lennon... Le public a toujours
tendance à se laisser aller vers les gens qu'il sent fragiles plutôt
que vers des gens qui arrivent à maîtriser les situations, à tenir leur
destin. Parce que, sur le plan artistique, le public a l'impression que
ceux qui arrivent à maîtriser ces choses-là ne peuvent pas avoir de
valeur; ce sont des choses irrationnelles, et on n'a pas à les
maîtriser.
R
& F — C'est plutôt vrai, non ?
G.M.
- C'est faux! Mais il est vrai que les gens qui ne sont pas des
créateurs ne peuvent pas admettre que tout soit construit «
sciemment ». Les gens m'apparentent plus peut-être à Lennon parce que
les produits que je fais sont censés être des produits planants. Sur le
plan artistique, effectivement, Lennon a essayé d'aller plus loin. Plus
planant. Tout ce qu'a fait Cartney, à la limite, c'est parfait, alors
que dans ce qu'a fait Lennon il y a vraiment beaucoup de choses à jeter.
R
& F — Quand tu dis « parfait », c'est jusqu'à une certaine
époque...
G.M.
— Tout ce qu'a fait Cartney ! C'est parfait, techniquement parlant.
C'est carré, solide, lustré. Ce qu'a fait Lennon, il y en a la moitié
qui est sans intérêt. Mais à côté de ça le résultat, au bout de dix
ans, sur la longueur - le problème du lièvre et de la tortue ! - c'est
que Cartney, on s'en lasse. On n'a plus rien a en apprendre, plus de
surprise. On sait que ce sera bien mais « chanson n, petite chanson. Et
puis une fois qu'on connaît une voix comme la sienne, bon... Alors que
Lennon, on pouvait s'attendre à tout. A des ruptures. On savait que le
prochain disque pouvait être différent...
A
DEUX, IL SE SENT PLUS ABANDONNÉ QUE SEUL, PERSONNE NE PARVIENT JUSQU’A
LUI.
R
& F —- Tu me disais que, contrairement à ce qu'on raconte, tu
passes peu de temps en studio ?
G.M.
— Les gens ne me croient pas quand je leur explique. Il suffit
d'interroger les musiciens qui ont travaillé avec moi récemment. Ils
deviennent fous !
R
& F – « L’Atelier du Crabe », par exemple, tu l'as
fait en plusieurs mois ?
G.M.
— Je l'ai fait en deux après-midi ! Les musiciens deviennent fous. Je
les fais entrer dans le studio, ils lisent quatre fois le titre, et la
cinquième il faut que ça soit la bonne! Pour eux, il faudrait toujours
recommencer. Ça peut être mieux, ça peut être ci, ça peut être ça. Moi
je sais, par expérience, que plus ils recommencent plus c'est la tasse.
Je prends des musiciens qui sont remarquables - j'avais un problème de
batteur, mais maintenant je n'en ai plus - des gens remarquables; mais
ils ont cette particularité - enfin, en ce qui me regarde - que moins
ils en connaissent, mieux ils jouent. A chaque fois que j'ai tenté
l'expérience pour leur faire plaisir - parce qu’il y a quand même des
rapports humains et que les gens doivent être ménagés sur certains
plans — à chaque fois, ça s'est vérifié. Donc, à bout de nerfs, de
temps en temps, je leur concède un titre. Sur lequel je les laisse
passer plus de temps. Ils veulent un machin ici ou ici, rajouter ou
enlever, apporter leur affaire à eux personnellement, bon.
R
& F — Tu as un exemple ?
G.M.
— Oui. Précis. J'ai d'ailleurs la bande. C'est le titre qui suit
«L’Atelier du Crabe », avec les flûtes : « Se Dire Adieu ». Ce
titre-là, je suis arrivé avec l'idée de le faire, avec déjà la grille.
Je l'avais composé le matin même.
R
& F — Musique et paroles ?!
G.M.
— Oui. Enfin, la veille au soir; et j'ai décidé de l'enregistrer le
matin. J'ai fait la grille pour aller au studio. Ce qui prouve à quel
point ce morceau est simple, combien j'en avais une idée simple, si je
suis arrivé comme ça ! Autrement, tel que je me connais, même si
j'écris vite - parce que j'écris toutes les partitions — j'aime bien
avoir du temps. Ne serait-ce qu'une semaine. Même sans y toucher. Mais
là, c'était tellement net avec la guitare sèche ! Net et carré. C'est
un 4/4. Je suis arrivé et j’ai dit : « Je veux basse,
batterie,
deux guitares sèches. Et on fait ça en 4/4. » C'était tout ! C'est
exactement comme « Qu'il Est Loin le Temps Devant
Nous ». C'est pareil. Ça ne peut pas être plus simple ! C'est le même
feeling. Je voulais que le batteur joue comme ça – des petits « roulés
», des petits « frisés » sur la caisse - et on joue en 4/4.
Alors, non. Ça les emmerdait de prendre la guitare sèche pour ça : « Ah
ouais, avec des guitares électriques, ça va être super !» Bon... ils
ont commencé à me saouler. Comme on avait fait « L'Atelier du Crabe »
avant, que c'était bien et qu'on l'avait fait assez vite - pour
chauffer un peu - je les ai laissés. Ils avaient les guitares
électriques. Ils voulaient me montrer, tout ça... On a passé quatre
heures. J'ai fait deux prises. Ça ralentissait. Ils m'ont quand même
trouvé un ou deux plans. Qui n'avaient rien à voir avec la chanson ! On
a fini par avoir une prise entière qui était à peu près bonne. Et j'ai
essayé de chanter dessus. C'était autre chose. C'était trop lent, ce
n'était plus les mêmes harmonies. Comme j'ai vu que ça « sonnait »,
bon, on a fait d'autres titres et on a laissé tomber ça. Et à la fin de
l'après-midi, vers sept, huit heures, on avait fait un titre avec les
guitares sèches -« Marin ‘Bar », avec une douze cordes. Dix minutes
avant qu'ils ne partent, j'ai dit: « On se refait le titre de tout à
l'heure: « Adieu ». Une prise, c'est bon. » Ils voulaient se
tirer. « Une prise ! Vous m'avez saboté le travail tout à l'heure. »
Ils ont fait une prise. 4/4. En pensant qu'ils allaient se tirer dans
les deux minutes. Quand ils ont réécoute, ils m'ont dit: «
Oui,
c'est une maquette... » Et c'était exactement ce que je voulais !
C'était parfait. J’ai juste été obligé de le ralentir parce qu'ils
l'avaient fait un peu vite. Conclusion : j'ai exactement ce que je
voulais en une prise. J'ai paumé quatre heures.
RUELLE
ÉTROITE ET ABRUPTE QU'UN HOMME EN BLOUSE DÉVALE PESAMMENT. ESCALIER.
R
& F — Donc, moins tes exécutants sont impliqués dans tout ça,
mieux c'est ?
G.M.
— Oui. Il n'y en a qu'un à distinguer: le piano. Quand il y a un piano,
j'aime bien qu'il soit impliqué. Je suis obligé de tout lui montrer
avant. Il y a des choses très précises que je veux. Quand je les fais
moi, j'ai exactement ce que je veux. Mais je suis trop «
speed »
en séance. J'ai tendance à faire cavaler un peu tout le monde. Et je ne
sais pas pourquoi; même quand je ne cavale pas, même quand
j'ai
le piano que je veux et que j'ai dans la tête, quand je le réécoute il
ne me plaît pas. Au lieu de rendre la chanson normale, il me semble la
« contracter » encore davantage. Peut-être parce que c'est moi et que
ça fait encore plus personnel... Je veux quelque chose qui détende. Qui
garde ce que je veux au niveau pianistique, mais qui donne l'impression
que c'est plus anonyme. Parfois, dans des choses très, très précises,
comme un certain morceau de « 2870 », ça ne va pas. J'ai beau faire
défiler tous les pianistes possibles, je n'ai pas ce que je veux. Alors
je le fais moi-même, et c'est ça. «Jésus», j'ai le
piano
que je veux. Sur «Y'a Une Route» aussi dans la coda – je joue du piano.
Dans «C'est un Parc», «Attends Que le Temps Te Vide», toute la coda.
R
& F - Dans «le Masque Sur le Mur», c'est toi qui
joues de la guitare sèche. (Manset
fredonne la partie guitare sèche qu'il joue dans le film « Le Masque
Sur le Mur ».)
G.M.
— Oui, là, je le fais moi-même. Parce que si je l'explique, on y passe
quatre heures. Si j’écris et que je prends des musiciens qui savent
parfaitement lire, ils vont me faire un truc un peu mollasson. Tu peux
écrire, tu peux même indiquer un doigté et puis avoir quelque chose de
complètement différent. Sans ça, il n'y aurait plus de musique.
Pourquoi Pink Floyd a-t-il un pianiste super, pourquoi Elton John
a-t-il ce toucher particulier, pourquoi les Beatles, au début, alors
qu'ils jouent comme des pieds, ont-ils ce son ? Ils jouent comme des
pieds, les Beatles, au début; mais quand ils touchent leurs notes de
guitares, ils savent ce qu'ils veulent et c'est «vrai ». Dans « Le Pont
», j'ai une superbe guitare. C'est David qui me l'a faite.
Mais
je suis obligé de l’égorger pour qu'il me fasse ces guitares-là ! Il
faut des pièges. Si je ne le prends pas tout de suite, après il passe
trois heures à me refaire d'autres guitares; elles sont toutes plus
belles les unes que les autres, mais en fait elles sont cons comme la
lune. Ce n'est pas ça. Les musiciens ne se rendent pas compte qu'ils
ont une sensibilité encore un peu préservée à la première audition des
choses. Après... c'est la technique. Alors ils ont toujours
l'impression que je les presse, que je sabote, que je bâcle...
SISYPHE
ÉTAIT CÉLIBATAIRE
R
& F — La Femme, dans ta vie ?
G.M.
— Pendant vingt ans, elle n'a eu aucune place.
R
& F — C'est ta mère ?
G.M.
— Ah non ! Pas ma mère !
R
& F — Alors ?
G.M.
— Eh bien, j'ai toujours cru...qu'une femme devait être là pour être
belle. Pas pour être décorative, attention ! Je pense a tout un rapport
de forces qui existe en Asie, pas ici, et qui est difficile à
déterminer, qui fait qu'en Asie les gens sont heureux et du côté des
femmes et du côté des hommes, même si, posé sur le papier, ici, leur
rapport peut sembler assez sordide.
R
& F — Un rapport de puissance ?
G.M.
— Pas de puissance. Ce sont des gens différents. Qui vivent
différemment. Qui s'utilisent les uns les autres. Pour des raisons
précises et connues. De commun accord. Disons que j'aurais été très
près de ces idées-là, intuitivement; et je n’ai jamais pu vivre comme
ça parce que je vis en Europe, en France, avec une éducation
différente, et que ça m'aurait semblé anormal de vivre comme ça. J'ai
donc suivi des relations avec les femmes tout à fait conventionnelles,
en ayant toujours un côté frustré au fond de moi-même parce que,
finalement, j’ai toujours été obligé de jouer le rôle... qu'on
m’expliquait être celui de l’homme, et que les femmes veulent être
celui de l'homme, alors que je n'acceptais pais. Je n’accepte
pas
d’être un outil, un ustensile, un robot, de remplir ma « fonction »
d’homme ! Ça ne m'intéresse pas.
R
& F - Y compris sexuellement ?
G.M.
- Y compris sexuellement. Mais, en dehors du rôle d'outil qu'on veut
nous faire admettre, il y a autre chose. Je ne sais pas ce que les
femmes ont dans la tronche en ce qui concerne les hommes. Mais moi, je
sais que les femmes - la femme – ne m'ont jamais intéressé. Même leurs
discours ne m’intéressaient pas. Quelquefois, elles peuvent avoir des
expériences, des vécus qui sont intéressants pour d'autres. Pour moi,
c'est sans intérêt. Et ce qu'elles racontent me laisse complètement
indifférent. Les hommes, remarque, c'est pareil. Quant aux filles plus
jeunes, de la même manière, ce qu'elles racontent ne m'intéresse pas...
Il y a vraiment un problème de vulgarité presque permanent chez la
plupart. C'est ça qui m'a toujours gêné. Un manque de distinction. De
grâce.
L'HOMME
AU REGARD SOMBRE ET SÉVERE QUI PORTAIT SUR L’EPAULE UN TAS DE VIEUX
MANTEAUX.
Manset
qui parle ou Manset qui rit. Qui se tait, qui se lève, regarde les Iles
de la Sonde en minuscule sur le mur, décroche le téléphone rouge pour
parler longuement, pertinemment, d'art thaï. Je songe aux « Trafiquants
d'Armes » d’Éric Ambler, avec ce personnage qui vend des armes dans les
dédales de bambous. En secret. C'est pareil. Manset pivote sur un
fauteuil design mi- blanc, mi- cuir à bourrelets, devant un large
bureau blanc. Sur lequel pose, un peu fastueux, enveloppé d'une sorte
d'auto sacrée, le coffret noir de «Caesar ». Dedans, c'est comme un
testament couché : « Animal » + « Jeanne » + « Orion » + « Il
Voyage en Solitaire » + « Y’ a Une Route ». Plus « Caesar ».
Le
seul disque de « rock » de l'histoire du binaire tout en latin. Un
disque confidentiel, prodigieux, recalé comme un vague crime,
architectural et grandiloquent comme un « Andrei Roublev » sur cire, un
enregistrement perdu et retrouvé, univoque - puisque le disque n'a
qu'une face - une obsession : la grandeur. Caesar, c'est l'empereur -
les empereurs - mais c'est aussi le plus court chemin de l'homme à Dieu.
R
& F — La référence au latin, à la religion ?
G.M.
— Non. Il n'y en a pas. Quand tu n'as personne en face de toi, tu peux
dire que c'est à Dieu ». Il n'y a pas de référence à la religion. Dieu,
je m'en fous. Complètement. Je crache sur l'église, à l'heure actuelle.
Non...finalement, je ne crache pas dessus. C'est peut-être mieux que
rien du tout. Il y a quand même une sorte d'approche du « beau ».
R
& F —- Le côté mythologique ?
G.M.
- Oui. Même si on discute les principes, les histoires sont belles. Les
mots choisis sont beaux.
R
& F — Les gens qui ne t'aiment pas t'appellent « le curé ».
G.M.
— Ah bon ?
R
& F — On dit aussi : « la chèvre »...
G.M.
— Ah bon ?! Ah, c'est pas croyable ! (Il se marre et je fais un signe
de croix.). C’est parce que je « bêle », ou quoi ? (Il rit de plus
belle (sic).)
R
& F — Est-ce qu'il y a une influence consciente du chant
grégorien sur toi?
G.M.
— Oui. C'est vieux. Il y a dix ans.
C'est « Caesar ». aussi. J'ai fait « Caesar » après « Orion ». L'année
d'après. C'était une question tactique. Après « Orion », quoi sortir
comme trente centimètres ? J'ai fait un trou et j'ai sorti ce
quarante-cinq tours. Que je n'ai pas mis en radio. Il y avait un seul
titre, et il était en latin.
Comme
ça, on avait le temps d'oublier « Orion ». On pouvait repartir sur de
nouvelles bases.
R
& F — C'est une espèce de « mythe », maintenant. «
Caesar ».
G.M.
— C'est pour ça que je ne l'ai pas sorti...
R
& F — A la radio, dans les petites annonces, tu as des allumés
qui
proposent : « Échangerais vingt Rolling Stones contre un petit « Caesar
»... »
G.M.
- Enfin ! Ça fonctionne ! (Rires)
R
& F — Dans le film, il était question du « mystère » Manset; tu
disais qu'on te prête des intentions que tu n'as pas et qu'on enveloppe
d'une énigme qui n'est pas tout à fait ce que tu as voulu susciter...
G.M.
- Qui est exactement ce que je voulais susciter ! Mais qui n'est pas ce
que je suis. Pas en totalité ce que j’ai voulu créer, mais qui est le
résultat quand même d'une démarche que j’ai adoptée : qui est de mettre
du mystère autour des choses. D’abord, je n'ai pas les épaules assez
solides. Ça m’emmerde de répondre à tout le monde. Je n'ai pas à parler
ni à aller faire le clown sur les plateaux ni à sourire ni à boire du
champagne si je n'en ai pas envie. Sachant ça, le seul moyen de
valoriser quelque chose et de rendre le temps, de faire que le temps
devienne un élément positif pour moi, c'est de mettre du mystère
(« Maître du mystère ?») Sur certaines choses. Et puis, il n'y a pas
trente-six solutions. J'en reviens toujours à cette idée de tout à
l'heure: il faut dévorer ce qu'on a créé pour ne pas être mal
interprété.
R
& F — Tu veux parler d’ «Orion » ?
G.M.
— Oui. La phrase de la fin a été interprétée par des tas de gens
savants comme étant, parait-il, une réminiscence de je ne sais plus
quelle théorie de base d'une philosophie grecque importante. « Que la
légende d'Orion/Soit morte », c'est le mythe du père qui mange son
enfant. Tout ce que je sais, moi, c'est que le personnage d’Orion me
fascine. Tout ce qui s'y passe. Le processus.
IL
ME FAUT BEAUCOUP DE SOLITUDE. CE QUE J'AI ACCOMPLI N'EST QU'UN SUCCÈS
DE LA SOLITUDE.
«
Orion », ce n'est pas « qui ? », mais plutôt « comment ? ». Comment ces
déplacements et ces tensions et ces rapports de force entre des choses,
entre des ordres différents ? Ce processus, qui est quand même assez
abstrait, c'est en gros: «Le père qui mange son enfant». Moi, je n'ai
pas dit ça, mais le fait de détruire ce qu'on a créé- ce qui, pour moi,
était capital à cette époque-là - cette idée m'a fasciné.
C'est le
seul moyen, finalement, de faire que ce qu'on a créé ne soit pas mal
utilisé, mal interprété : détruire. Une fois le plaisir atteint et la
réalisation de ce que j’ai voulu faire, c'est à moi de le détruire!
C'est ça, « Orion ».
R
& F - Oui.
G.M.
- Donc, je ne me montre pas.
R
& F — C'est un peu paradoxal, quand même...
G.M.
- Mais non. Le mystère, c'est la conséquence de ça. Il y a du mystère
quand « la chose » n'est pas là. Il y a mystère par sa
non-présence. Juste parce que ce n'est pas l'habitude. Le processus est
le suivant: ne voulant pas me montrer pour que ça ne joue pas contre
moi — ou contre le produit - sachant que je ne vais pas être à la
hauteur de la situation, que je ne suis pas là pour ça, je n'apparais
pas. D’où : mystère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une attitude «
normale », que les gens ne soient pas là pour défendre leur produit. Ce
n'est pas un mystère que j'ai créé, le mystère n'existe pas, il n'y a
pas de mystère, j'ai une attitude tout à fait normale... mais les gens
interprètent forcément ça comme une forme de mystère. Il y a un disque
et il n'y a «personne»...mystère ! Pourquoi? Il y a des questions sans
réponse puisque je n'ai pas donné de réponse. Pas de biographie, pas de
photos.
R
& F — Donc, c'est mi- concerté, mi...
G.M.
- C'est une démarche totalement volontaire de ma part, dès le début.
R
& F — Les gestes «volontaires » ont toujours un sens « latent
». Tu
expliques les choses avec de la logique. Mais tu ne peux pas empêcher
que le résultat soit aussi un comportement qui t’identifie profondément
: un comportement de « repli »...
G.M.
- Tu as raison. C'est sûr que dans beaucoup de choses de ma vie privée,
je mets aussi du mystère. Partout. Je m'y suis habitué. J'ai commencé à
faire ça très jeune. Je me souviens de choses que j'ai dites à ce
moment-là. Pourtant, j'oublie très vite. C'est une autre vie que j'ai
vécue, quand j'étais jeune. J'ai l'impression de parler comme un vieux
ringard, mais vraiment, aujourd'hui, j'ai trente-cinq ans. Quand
j'avais vingt ans, c'était une autre vie, c'était quelqu’un d'autre...
Il y a quinze ans... A dix-sept, dix-neuf ans, je me souviens...
pendant deux années j’ai parlé beaucoup. C'est à dire que j'ai parlé
comme je parle aujourd'hui.
JE
M'ISOLERAI DE TOUS JUSQU’A EN PERDRE LA CONSCIENCE. JE NE PARLERAI A
PERSONNE.
Et
j’ai parlé à tort et à travers, pour rien, avec des gens qui
n'écoutaient pas, qui ne comprenaient pas, qui ne répondaient pas, j’ai
parlé devant des murs. Pendant deux ans, J'ai parlé sans interruption !
Et dans le vide. Je suis entré aux Arts Déco, et c'est à peu près à ce
moment-là - à cheval - que c'est arrivé. Au début, j'ai dû continuer à
parler. Et puis il s'est passé deux, trois événements, sur le plan
artistique, et j’ai commencé à me taire. Des détails, mais qui m'ont
très précisément marqué, en me donnant la folie d'arrêter, la folie du
renoncement total et de la solitude absolue. J’ai arrêté de parler.
R
& F - Et ces déclics, c'était quoi ?
G.M.
- C'était... est-ce que je m'en souviens ? Peut-être deux. Comprendra
qui pourra. Le premier déclic. En dessin, j'étais très doué, ce qu'on
appelle « doué ». Et j'ai toujours cru que je dessinais très bien. Je
suis entré aux Arts Déco sans passer le concours, je suis entré direct,
je faisais de la gravure, j'avais eu des médailles, j'avais eu le
concours général et différentes — comment dit-on ? — distinctions. Bon.
Et puis je suis allé voir un peintre - je tairai son nom; c'est un
peintre français connu, qui laissera des traces - je me prenais pour un
roi du dessin et j'ai pu le rencontrer. Je lui ai montré ce que je
faisais. Il m'a dit: « Il faut dessiner de la main gauche. »
R
& F — Ça pourrait expliquer une certaine tentation de la
difficulté... ?
G.M.
— Ah oui. Oui. C'est la phrase-clef. J’ai écrit la musique, je ne
savais pas l'écrire. J'ai fait le studio, je ne connaissais rien à
l'électronique... Quant à l'autre déclic, c'était... la première fois
où j'exposais des gravures. J'étais très jeune. Dix-sept ans. Et
dix-sept ans il y a quinze ans, ce n'est pas dix-sept ans aujourd'hui.
Il n'y avait pas eu Mai 68 ni trente-six sortes de conneries qui se
sont produites depuis. La majorité était à vingt-et-un ans, il y avait
un million de choses... J'étais dans le Seizième, je passais mon temps
sur les Champs-Elysées. J'expose donc des gravures — au Salon des
Artistes Français, je crois. J’ai eu une médaille d'argent. Ça complète
ce que je disais avant, parce que ce que je faisais en gravure était
très académique. Ce n'était pas uniquement de l'habileté, mais c'était
très classique. J ‘entre dans la salle pour recevoir mon truc, et je
vois tous les mecs qui étaient là pour recevoir leur bout de papelard.
Il n'y en avait pas un de moins de soixante-quinze ans ! Pas un !
C'était l'horreur. Faire le même travail que tous ces vieux ringards.
Autant se tuer tout de suite ! Il y avait un sac quelque part. Et ce
qui était exposé !... Ce n'est pas que c'était humiliant, pas
seulement. Mais c'était le chemin, vraiment, à ne pas suivre.
L'horreur. L'horreur, surtout, de penser qu'à ma place n'importe qui
d'autre aurait été très content. C'est ça qui m'a fait peur. Tout le
monde serait sorti avec ce bout de papier heureux. Moi, je suis sorti
effondré. Et je me suis dit: « Voilà. Les problèmes commencent là. »
R
& F — Et tu t'es retrouvé avec un crayon dans la main gauche...
G.M.
-..... en train de brûler mon truc de l'autre.
LA
VUE DES ENFANTS, D'UNE JEUNE FILLE SURTOUT, PUIS D'UNE AUTRE, LA
MUSIQUE ENTRAINANTE, LE PAS
CADENCÉ.
«A
force de penser aux autres /On a le front serré... » Il est fatigué de
se dire. De me raconter. Il se passe les doigts dans les cheveux. Il
commence, par bribes, à se taire. Les vitres roses sont passées au noir
déjà. Le jour va tomber. « Rouge-Gorge est fatigué ». « Allez, salut »,
m'a-t-il encore dit comme il aurait dit : « Allez, ouste ! »
Gentiment, mais impatiemment. En ouvrant grand la porte Numéro Treize.
A force de parler, on finit par ne plus s'entendre. On est las d'être
ici. De ne pas pouvoir s'en sortir. Il n'y a rien à dire, et rien à
redire à tout cela. Manset est fatigué. De lui, de moi, du bruit de ma
tête prêt à couvrir le sien. Le problème n'est pas là. Pas là du tout.
Maintenant, on le sait. Le sens reste au secret. Le reste est masque.
Sur la fin, on sentait les phrases s'enliser, les questions se prendre
aux sables mouvants, les signes de reconnaissance partir en lambeaux.
Il y avait eu ce qui n'était pas prévu. Trois ou quatre heures de
parenthèse et de silence magnétique. Au cours desquelles l'homme sans
barbe avait parlé, enfin, de lui. Pour lui et pour moi. Strictement.
Entre nous. « Enfin ». C'était fatal. Intense, simple, ample et
essentiel. Avec des échappées insaisissables de splendeurs. Les ruelles
sans murs de l'Inde perdue. Les routes de terre battue. Les maisons de
Thaïlande jaune où il faut entrer en secret. Les mots de là-bas. A
redécouvrir. On marche « en jouant», on parle «en jouant». Les enfants
jouent. Les misères, qui sont une invention de la mauvaise conscience
d'ici, les bals populaires et les twists exotiques. Les mots de la
nuit. Les quêtes et les fièvres et les saluts radieux. Le prix du corps
sorti des limbes de l'ennui. La mer recommencée, l'océan, et les femmes
fleurs en sari. En «tags». Les codes secrets de la survie. Les Thaï.
Les rêves emplis de pétales et de rires comme au premier matin du
monde. Les images d’Eden puéril et sordide. Une maison au bord de l'eau
brune avec des grappes de vies d'anges qui éclabousseraient les murs en
torchis d'éclats de rire blancs. Un monde lisse. L'exil intérieur. Un
univers aux façons polies. Comme rasé jusqu'à la plus infime trace de
duvet. Une cité en ordre parfait. Pleine de propreté. Les petites
chambres du mystère. « Je ne veux pas en parler. Si les gens veulent
savoir, ils n'ont qu’à y aller eux-mêmes. A quoi bon leur parler des
mots de là-bas ? De toute façon, ça ne va pas leur faire apprendre la
langue. Ils écoutent - Ah bon ? - et voilà. Non. Ça, je n'en parle pas.
» Rien à voir avec un trip baba. La vie neuve de Gérard Manset est une
vie à couleurs de crépuscules et de dangers grisants, de forces vives
et de raisons de vivre, d'étrangeté renouvelée, de redécouverte et de «
sourires de Jocondes ». Une vie serrée. Sans pli. Sans ride. Sans
violence. Sous le signe de la déesse mère qui tord, en une longue et
lourde tresse noire, ses cheveux de jais pour en extraire le lait des
renaissances. Un Botticelli de Bangkok. Trois ou quatre heures d'énigme
retirée. La vague se retire. Gérard Manset se reprend, se maîtrise. Ses
mots sont ses pas. Comptés. Dans trois ans, cinq ans, dix ans
peut-être, il parlera. Pour l'instant, il faudra encore que ses
retraits et ses ombres, que ses vides et ses brumes, que ses suspens
parlent pour lui.
Et
si nous avions parlé « pour rien » ? Le crabe ne rouvre jamais sa
pince. Il ne livre pas son secret. Il vit en Asie, il rôde à Paris, il
trafique en Italie. Il est de nulle part. Rien ne le concerne vraiment,
sauf... Il parle d'or, à sa façon. C'est un fou qui sait vivre. Il rit
et il regarde bien les signes. C'est autre chose qu'un ascète, c'est
autre chose qu'un muet. C'est le sourd de La Muette.
«
Je n'ai rien à raconter, et quand mon heure aura sonné, je viderai ma
corbeille à papier, je partirai sur la pointe des pieds. »
*******************************************************************************************************
MAÎTRE DES
MACHINES ÉLECTRONIQUES, MAGICIEN DE STUDIO, UN ASCÈTE, UN SOLITAIRE, UN
MODESTE.
MANSET
Par Philippe BARBOT,
Marie-Ange GUILLAUME, Jean-Pierre LENTIN
(Le Monde de la
Musique N°37, Septembre 1981)
Manset, lui, fait
partie de cette famille de symphonistes du rock nés de l'évolution des
techniques d'enregistrement. Maître du studio d’enregistrement, Manset forme un
groupe à lui tout seul. Peu importe qu’il tienne lui-même les instruments ou
qu'il donne des directives précises à un musicien de studio, c'est sa
musique : il la sculpte à loisir en jouant avec les pistes et les machines
électroniques. C’est sa vision.
Voilà donc
réconciliés la solitude du chanteur et la plénitude d'une orchestration rock
qui fait corps avec la voix. Mais cet homme qui tient tous les fils entre ses
mains est aussi le plus mal assis des créateurs. Tout commence sur ce
malentendu classique : Manset joue dans un groupe de rock à dix-huit ans,
commence à écrite des chansons et ne peut les enregistrer qu'en tant que chanteur,
à une époque où la notion de groupe de rock est totalement étrangère aux habitudes
de l'industrie du disque en France. Manset se retrouve « chanteur » malgré
et se ferme les portes du seul public qui lui importe vraiment, celui du rock.
« Je peux toucher
sans trop de peine cette frange de jeunes cadres à la page pour qui le rock est
un signe de statut social. Mais le vrai public rock, celui des lycéens ou des
« hors caste » reste intouchable, il ne lit rien, il n’écoute pas la
radio, il se forge un goût complètement monolithique. S’il a l’occasion de m'entendre,
il me trouvera rasoir. Un chanteur, c'est-à-dire un vieux. Dommage… »
Lui-même écoute fort
peu ses collègues et fabrique sa musique hors des références, en toute naïveté-
Il n'a jamais chanté sur scène et s'est très rarement prêté au jeu des
interviews ou des passages à la télévision. Sur les anciennes photos, à force
de le voir sombre et imposant derrière sa barbe de Raspoutine, on imagine un
colosse. Mais il est mince, presque fluet, et il n’a plus de barbe.
L'appartement est curieusement dénudé, comme inhabité.
Dans quelques
heures, Manset s’envole pour la Thaïlande. Toute une histoire, cette barbe et
ces voyages.
« J’ai
longtemps gardé un côté monacal, rigoureux, une religion de l’efficacité, un
cartésianisme parfois pesant. J’avais monté un studio et une société de
production avec un associé, tout était très organisé; et mon temps était accaparé
par mille choses sérieuses. Je me voyais comme une sorte de manipulateur. Je ne
voulais surtout pas qu'on me reconnaisse dans la rue. Je me cachais derrière ma
barbe. Un jour, j’ai vendu mes parts et j’ai coupé ma barbe. D'un seul coup j’étais
libre et je pouvais penser au plaisir avant l’efficacité. » Tiens, il
sourit. « L’Atelier du Crabe », le dernier disque de Manset, s'ouvre
sur un rock détendu,
avec des cuivres presque insouciants. Un peu plus loin, on tombe sur un calypso
sautillant une chanson pour saluer « La plus belle fille de la plage ».
Sur cette lancée, il songeait même pour la première fois à entreprendre une
tournée, mais la désorganisation endémique du « métier » en France
l'a découragé et l'occasion ne se représentera probablement plus. Son disque
est expansif, amical, mais lui est plus absent que jamais. « J’ai commencé
à voyager. J’ai vu des endroits où les gens étaient beaucoup plus heureux
qu’ici, et soi-disant moins « civilisés ». J’ai appris la langue
Thaï. Tout mon univers a basculé. ».
« J’ai
découvert que les civilisations les plus harmonieuses, se passaient de journaux,
de radio ou de télévision. On parle beaucoup trop ici et ça ne sert à rien, on ne
se fait jamais comprendre. L'artiste a beaucoup trop d’importance. A mon sens,
il n’exprime que son univers personnel et solitaire. Je ne prétends à rien d'autre
dans mes chansons. Et dans le babil perpétuel des media, j’essaie d’apprendre à
me taire ».
Étrange bonhomme.
..Nous l'avions contacté pour lui envoyer un photographe. Les rares photos de
presse de Manset sont grisâtres et floues, elles montrent un visage neutre,
absent, sans âme... Il a posé des exigences. « Les négatifs devront rester
la propriété du journal, pas du photographe. Je ne veux qu'ils puissent
ressortir des années plus tard dans un bouquin de portraits, par exemple. Une
photo de journal, au moins, ça circule pendant un mois et puis ça disparaît, on
l’oublie ». Nous avons laissé tomber. Une fois de plus, il s’est débrouillé
pour qu’on ne lui vole pas un bout de soin âme.
Et pourtant Manset
chante ! Il reconnait la contradiction avec un sourire triste. Est-ce
qu'il sait, lui, pourquoi ? « Un jour, j'ai annoncé que j’allais arrêter
de chanter pendant quelques années et trouver un autre job, un boulot normal
avec un salaire et des horaires de bureau. Tout le monde m’a cru complètement
fou. Ça me semblait pourtant raisonnable et sensé. Et je n’ai pas renoncé.
En attendant, il
continue à jouer à cache-cache avec lui-même. Et il est rusé. « Mes
chansons viennent malgré moi. Ce sont des bribes de textes ou de mélodies qui s’imposent
sans crier gare; surtout pendant les voyages, je ne cherche même pas à savoir
ce qu’elles veulent dire. Et pour mieux brouiller les pistes je laisse passer
deux ans avant d’enregistrer une chanson que je viens d’écrire ».
C'est là sans
doute, où Manset appartient le plus au rock. Le rock est un tout, une espèce de force impersonnelle, il fait passer
la voix collective d'une génération avant celle du poète qui ne sait dire que je... Mais rien n'est jamais joué avec
lui. Cette année, sur les refrains presque sages de L'Atelier du crabe, Manset
a fait un pas vers la chanson. Il en est le premier étonné. « Toucher cent
mille personnes avec un petit refrain de trois minutes, je ne savais pas que
j'en étais capable. Mes délires symphonico-électroniques, eux, , me viennent à longueur
de journée, sans me forcer. Je pourrais en remplir douze albums par an. Tandis qu’une
chanson populaire qui pourrait toucher mon père, c’est beaucoup plus
difficile ».
Entendons-nous
bien ; il existe aussi, désormais, une forme de « rock chanson »
qui vit des recettes éprouvées Véronique Sanson, Capdevielle, Balavoine... Ces
professionnels sans surprises prennent le relais de la vieille variété. Mais
seuls nos quatre mutants ont le don rare de rendre la vie un peu moins fade.
MANSET:
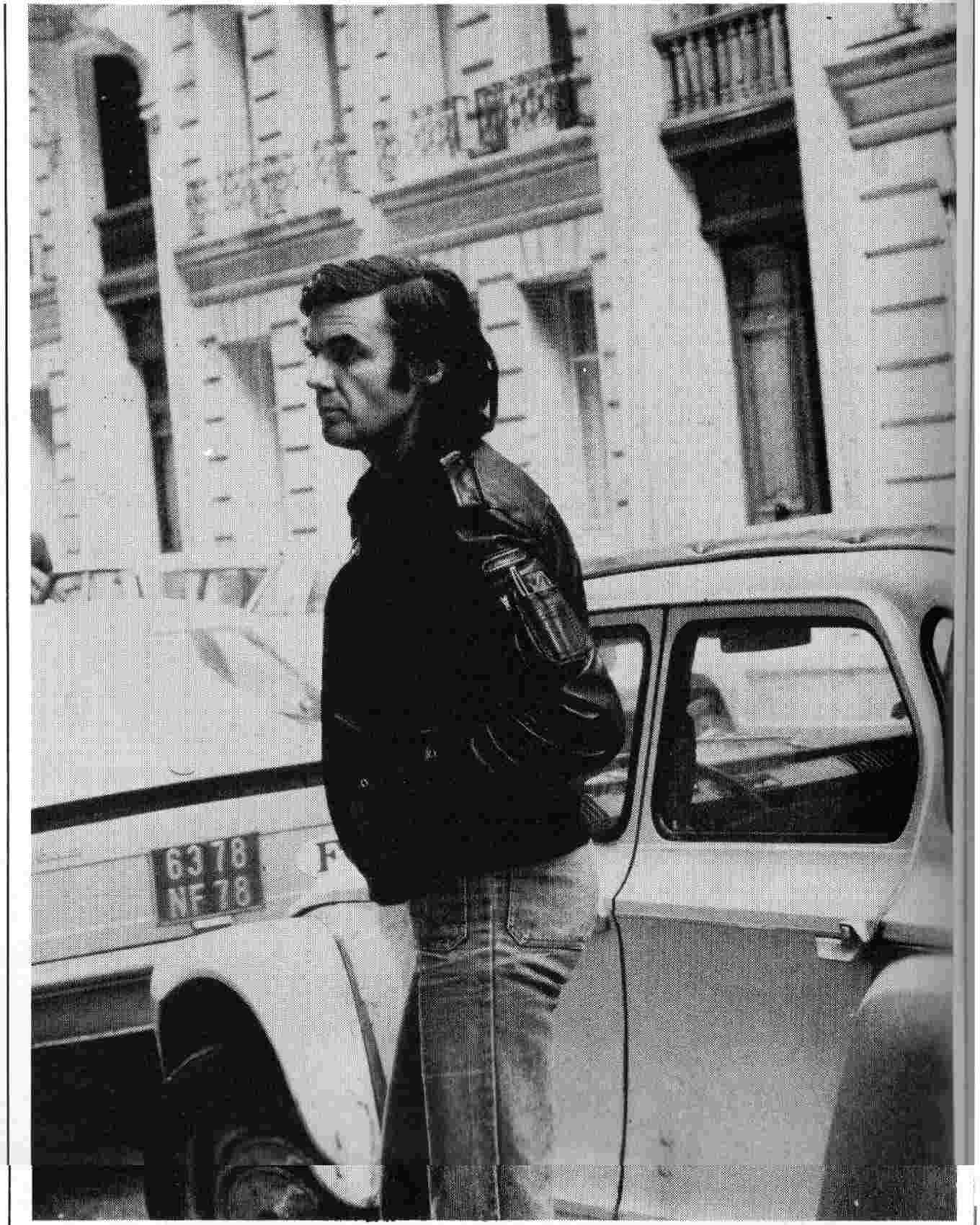
“Refuser de capituler”
Le rideau se lève ce mois-ci sur un personnage toujours
aussi fascinant, après pourtant treize ans de carrière : Gérard Manset. Il est revenu
au tout premier plan, grace à un fantastique album "L'atelier du crabe/Le masque sur le 'mur",
ainsi qu'un film que seule une poignée d'initiés a eu la chance de voir. Un personnage
attachant, que l'on est tenté de laisser parler des heures, en raison de la précision
de ses prises de position et du discernement implacable vis-à-vis des deux mondes
qui l'entourent : le vrai, le vaste, celui qu'il sillonne dès qu'il en a la possibilité,
et le mini-monde, la mini-société du "show-business" dans lequel il ne
trempe qu'un seul pied.
Rares sont les interviews qu'il accorde, mais par
contre, les vibrations qui s'en dégagent incitent l'interviewer à les faire partager
avec ses lecteurs. Une première rencontre il y a deux ans et demi,
le trac et une petite C60
s'étaient transformés en trois heures de discussion au cours desquelles Gérard
s'était raconté, de ses débuts à la création de l'album "2870". Aujourd'hui,
nouvelle rencontre; cette fois, plus besoin de flash-back. Nous parlons uniquement
du présent, en essayant de présenter l'œuvre au travers de l'homme.
Postérité
-Penses-tu à la postérité ?
-Depuis deux ans, non ... J'ai commencé à descendre.
-C'est-à-dire?
-A mes débuts, mon écart par rapport aux autres, aux lieux communs, aux
conventions, aux usages était actif; aujourd'hui, il est passif et est devenu état
de fait. Avant, je pensais que ce choc, ces contradictions pouvaient m'aider à rencontrer
des gens intéressants au niveau artistique. Or, l'élimination s'est faite, mais
je ne connais pas de musiciens, d'écrivains, de poètes ou de peintres qui me fascinent.
Art mineur
-Gérard,
tu dis souvent pratiquer un "art mineur".Pourtant, la musique moderne,
le cinéma et même la bande dessinée peuvent déclencher
des émotions, des sensations d'admiration chez des gens qui, par
exemple, ne ressentiraient
rien devant une toile ou à l'écoute de musique classique.
Ne crois-tu donc pas que, plutôt qu'art mineur, il
faudrait utiliser le terme d’ « art nouveau »; et que, tout comme pour
la musique classique, le temps sera juge et choisira les meilleurs ?
-Effectivement, certaines personnes ont la faculté de faire ressentir des
émotions au travers du cinéma ou de la pop-music ... mais pas avec du super 8 ! Or, ce que je fais, avec quatre ou cinq musiciens,
ce n'est même pas, pour moi, vis-à-vis des superproductions américaines, ce que
représente le roman par rapport au livre
de philosophie! En effet, dans le public,
tout
est colporté, mélangé, mixé avec toutes
les images des baladins
modernes, troubadours lamentables qui sont rive gauche depuis des années.
En tant que chanteur français, je fais de
la "variété française", art grotesque et
dérisoire. Cela n'a rien à voir avec la dimension des Américains ou de gens comme
les Bee Gees, McCartney dont les shows
sont de pointure internationale. Et même si mon public
est touché émotionnellement, je persiste à penser "art mineur", car, si
je me réfère aux chiffres de vente, je ne vends pas trois millions d'albums, loin
de là. Donc, dans cette mesure, Jean- Christian
Michel est infiniment plus important que moi. Cette analyse
est froide, bien sûr, mais honnête. Les Américains, par contre, consacrent leur
vie entière à la musique, ils travaillent, vivent ensemble, chez eux, en studio,
en concert, sur la route.
On ne peut pas non plus dire "art nouveau".
Lorsque j'avais 18 ans, la pop-music était nouvelle ... aujourd'hui, non seulement
il n'y a pas moyen d'innover au niveau technique, mais de
plus je ne parviens
pas à retrouver les novations de mes débuts ! La vidéo, par exemple, est, au niveau
technique, un pas en arrière; le son, quant à lui, s'est enrichi de "gadgets",
mais il se détériore. Il y a quinze ans, avec un 2 ou un 4 pistes, on avait une
qualité de définition du son qu'on n'a plus aujourd'hui, et que l'on compense par
des artifices. On n'arrive pas à conserver l'acquis !
Violence de mots
-C'est apparemment la première fois que tu dégages
une telle violence des mots : "Manteau rouge" et
"Musique dans la tête", alors que la violence
était restée jusqu'à présent instrumentale…
-Lorsque j'ai écrit "Manteau rouge", j'ai
vu la façon d'agir de certains journalistes dans les premiers
camps cambodgiens. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le correspondant de presse
qui doit pondre trois lignes lamentables.
On ne peut pas parler de ces choses sans être violent.
-Pourtant, tu aurais pu déjà glisser de telles choses
dans "Royaume de Siam"?
-Non, car à l'époque,
il y a trois ans, il n'y avait pas les problèmes que l'on sait. De plus, je n'avais
passé que quinze jours en Thaïlande, et quelles que soient les horreurs que j'ai
pu voir depuis, il n'y a pas un mot à changer dans cet album. Le nouveau complète
le précédent; le problème est d'avoir une violence humaine, chaleureuse et cohérente,
sans aligner des mots gratuits. J'ai attendu de vieillir un peu avant d'exprimer
ce genre de choses; je viens de plus en plus vers des textes
simples mais précis.
-L'album "Royaume de Siam" semble empreint
d'une sorte de fatigue, de lassitude.
Est-ce exact ?
-"Y'a une route" est mon dernier album en haut de la pente. Tous
les autres sont effectivement un peu "fatigués" ... ce qui ne veut pas
dire qu'ils manquent d'imagination, mais parce que, pour moi, ils ne sont plus réellement
neufs. "Royaume de Siam" est peut-être plus serein, et dans
l'ensemble cet album a été apprécié et a même ouvert une brèche chez des gens qui ne
me connaissaient pas ou qui me trouvaient trop marginal ou agressif. C'est aussi
à partir de "Siam" que j'ai commencé à écrire des chansons que d'autres auraient pu faire ....à trois ou quatre
phrases près. Avant, je savais faire "La mort d'Orion" mais je ne savais
pas écrire de chansons comme "Le jour
où tu voudras partir".
-Passons rapidement sur un détail, concernant une
question que l'on t'a souvent posée : en
effet, tu te réfères à McCartney, alors que pourtant tu ne t'es jamais permis ses
faiblesses, et que, de plus, "Il voyage en solitaire" est totalement proche
de "Imagine", c'est-à-dire de Lennon ?
-On ne peut pas se permettre de juger McCartney,
car il est vraiment très haut. On ne peut pas juger Dieu, car l'on n'est pas Dieu
! On n'a ni les tenants, ni les aboutissements
nécessaires
pour savoir s'il aurait dû sortir tel disque ou tel autre.
-Apparemment, le voyage atteint aujourd'hui une grande
place dans ta vie.
Tu y passes les trois quarts de ton temps?
-Non, pas du tout! Je ne pars jamais longtemps, car
la vie, telle que je la vis, est... invivable, de l'autre côté du Pacifique.
Confronté à la réalité
-A quel niveau définis-tu l'enrichissement ainsi acquis?
-J'ai enfin été confronté à des problèmes vitaux. Il n'y a que dans ces pays
que l'on est confronté à la réalité quotidienne; ces gens vivent dans le risque et chez eux, la
haine c'est la haine, l'amour c'est l'amour, la faim c'est la faim, la misère c'est la misère. Ici. on ne connaît rien
que de la vraie pauvreté, de la vraie faim, de la vraie joie ...
-Crois-tu avoir trouvé dans le Siam un endroit privilégié
?
-Je suis allé principalement en Asie, et jusqu'à présent,
parmi tous les pays visités, c'est la Thaïlande qui m'a semblé
le pays le plus
fascinant pour un artiste.
-Quelle est la principale raison qui te pousse à te
désintéresser du disque : le manque de foi en ce que tu fais, voire manque d'inspiration,
ou déception vis-à-vis d'un public encore trop restreint?
-Ni l'un, ni l'autre! Au contraire, j'ai de plus en
plus d'inspiration, car j'ai chaque jour des idées et des ébauches de chanson ...
De plus, le disque est peut-être la seule chose que j'aime, et mon plus grand pied est de rentrer
en studio et d'enregistrer, chanter et jouer
avec de bons musiciens. Le principal problème est que cela coûte de plus en plus
cher de pouvoir enregistrer. De plus, les
gens avec qui je travaille
sont déjà bien engagés, ils ne sont pas libres en permanence. J'aimerais pouvoir
travailler dans les mêmes conditions qu'il y a dix ans, mais c’est beaucoup
plus difficile de trouver d’excellents musiciens disponibles.... En Asie, les gens ne font rien, sont assis toute la journée; cela donne envie de peindre,
de faire de la musique. Dès que l'on revient à Paris, il faut discuter, négocier,
parler contrats; cela m'oblige à réveiller une part de moi-même qui n'a rien à voir
avec l'artiste, que je préfère laisser dormir.
-Reconnaissons-le, aucun album de Manset ne s'est
démodé; pourtant, chacun est un témoin du moment précis où il sort.
Comment fais-tu pour "coller" à l'époque
strictement contemporaine, puisqu'à tes dires, tu n'écoutes pratiquement pas ce
que font les autres musiciens?
-Peut-être cela vient il principalement des textes, car, finalement, depuis
dix ans, c'est toujours les mêmes guitares, les mêmes batteries et les mêmes pianos.
-Oui, mais leurs "couleurs" en sont différentes
sur chaque LP ...
-Disons que je soigne l'emballage; je sais trop à
quel point on tombe vite dans la répétition, et j'essaie d'avoir un matériel différent,
principalement au niveau de
l'angle sous lequel on le voit. La pochette
et la présentation sont aussi capitales.
Confort
-Vis-tu confortablement ?
-Je pourrais bien sûr vivre beaucoup plus confortablement,
mais, pendant dix ans, j'ai
travaillé comme dix, j'ai appris à négocier
des contrats. Par rapport à d'autres artistes, je suis assez
privilégié car j'ai évité de tomber dans les pièges évidents et de me laisser enfermer
dans un système "showbiz", Il faut savoir s'organiser; quand nous avons
créé le studio de Milan, de même que lors de la réalisation de mon film, on s'est
débrouillés sans
véritables moyens financiers.
-Tu ne fais plus de productions. Cela ne t'intéresse
plus?
-Non, c'est surtout que je n'ai trouvé personne de très intéressant. Je n'ai pas cherché beaucoup, non plus ! Certainement qu’en
traînant à droite, à gauche…
-Revenons à une question moins
"terre à
terre". Tu cites parfois Dieu dans tes textes, mais tu restes assez
vague. Est-ce pour toi une notion imprécise, ou même qui ne te touche pas ?
-Lorsque j'étais plus jeune, le côté ésotérique, le
décorum, le mystère qui entourent la notion de Dieu m'intéressaient un tant soit peu. Mais finalement,
l'existence, la non-existence, la
foi ... tout ça ne m'intéresse pas, car cela fait partie des lieux communs. Sans
parler du bouddhisme, il me semble plus facile de vivre comme eux, c'est-à-dire en
considérant la religion comme une forme de superstition, tout en restant en parfait
accord avec soi-même.
-Les gens qui ne te comprennent pas, qui ne te connaissent
pas, ont tendance à te ranger parmi les bizarres et les marginaux, alors qu'en fait
tu es simplement et apparemment le contraire.
-II n'y a pas de comportement plus normal que de
vivre comme on l'entend. C'est un privilège, mais les gens n'aiment pas les privilèges.
Dans l'artistique, on s'extrait du monde normal pour se mettre d'office dans la
position de privilégié ... Mais, même dans l'artistique, beaucoup
n'assument pas leurs privilèges jusqu'au bout, et se laissent "bouffer"
en route; ils capitulent lorsqu'on souhaite modeler leur musique. J'ai refusé de
capituler, et c'est pour cela que je passe pour égocentrique.
Propos recueillis par Daniel LESUEUR (Le Magazine de la Discothèque n° 23 / Juin 1981)
**********************************************************************************************************
Un nouveau disque, un film, les loups, quelques mots sibyllins et le ciel va tomber
Gérard
Manset : la ligne de fuite
Et c’est comme une gangrène
blanche. Quand le silence gagne. « Quand le silence même se
tait ! »
Les bruits qui meurent, les
tympans qui se couvrent, les pièces qui se vident, la vie qui s’estompe. Gérard
Manset murmure dans un recoin et Kafka
écrit : « L’insatisfaction dont une rue offre l’image :
chacun lève les pieds pour quitter la place où il se trouve ». Tout
s’effrite. Il ne reste, dix ans après, que des ombres. Portées. Des restes de
rien dont le dernier album, couleur fin de siècle de Manset- « L’Atelier
du Crabe » - et son premier film- « Le Masque sur le Mur » -
disent les fastes tristes : « Dans la maison abandonnée/On
entend ses pas résonner ». Beckett en rock. « J’aurais voulu écrire « Oh
les beaux jours », avoue l’auteur de « Rien à raconter », qui
précise : « Tout le reste est à jeter ».
« Il fait le même disque
depuis dix ans ! » protestait hier un garçon raisonnable, s’étonnant
de l’intérêt un peu obséquieux et démonstratif qu’un lot d’indéfectibles
fanatiques porte contre vents et marées à ce prince des ténèbres du rock
français. Ce n’est pas tout à fait ça…Mais, justement !.
Qui est-il ? Où vit-il ? Que
fait-il ? Pourquoi existe-t-il ? Des réponses à ces questions posées
au maître du mystère en manteau de cuir, dépend le sort de quelques milliers de
fidèles fanatiques penchés jour et nuit sur ses grimoires et ses ondes rock
hiéroglyphiques sous le signe du cancer. Manset fait mine de tout dire :
« Il n’y a pas de secret Manset… » affirme-t-il « Et je le
prouve ! ». Il se rase, rudement, au rasoir mécanique, le visage à
découvert (l’a-t-on bien noté : il est désormais glabre). L’image est
belle. C’est le film du Crabe. La mèche noire relevée, le voyageur du couloir
s’oint le menton et les lèvres de mousse à raser. Pour, peu à peu, creuser à
coups de lame dans la neige. Artificielle. « Je ne passe pas mes nuits
dans les studios ». On entend monter une rumeur superbe. C’est
« Caesar ».
« Caesar », le
chant le plus sombre et le plus ésotérique de la saga du crabe. Et tandis que
les chœurs en latin déferlent, tandis que l’invocation à « César »
l’absolu inondent la salle, la caméra plonge dans les entrailles de la mélodie
sacrée. Studio bouleversé, consoles éteintes, baffles mortes, imaginations
tuées, casques vides, guitares sans têtes, oiseaux sans cordes. On voit des
murs rouges, on voit des peintures à bout de nerfs, on voit une de ses deux
filles, on voit sa femme blonde.
L’instant d’après, il se perd
encore dans la neige avec la bise aux lèvres. Il chante comme il gèle :
« Je n’ai pas peur du jour ». Il vous démontre sa vie normale. Mais
lorsque la voix qui l’interroge se fait trop pressante, lorsque l’investigation
trop inquisitrice, il dit quelque chose comme : « Ma vie privée, je
ne pense pas que vous puissiez la comprendre. J’ai déjà assez de problèmes pour
la comprendre moi-même… ». Un pan de voile soulevé. Et tout retombe.
Gérard Manset, un instant
pétrifié, se tait soudain à la recherche d’un mot, d’un sens suspendu, en
détournant le regard. Il dit : « Il n’y a rien à dire. Rien à
ajouter. Il suffit d’entendre « Y’a une route » ; « Y’a une
route » ? Bon. C’est tout. « Y’a une route ». Il se tait et
une porte de voiture claque. C’est un film décroché.
MARTYRISER
-Ton bestiaire fantastique,
Le Crabe, en premier ?
-Le Crabe, c’est le Cancer.
Mon ascendant. Le Lion, il n’y a pas d’explication à donner, mais le cancer, il
y en a une. Le trait principal du cancer, c’est …la lune. Donc, la nuit :
Introversion. Signe tourné vers l’intérieur. Et surtout, c’est la patte. La
pince. Donc mobilité assez lente, poids et saisie. Une fois qu’elle a attrapé
quelque chose, la pince ne s’ouvre plus. Dans ma vie, je crois n’avoir rien
entrepris que j’aie abandonné par la suite. Il y a deux catégories de gens :
ceux qui, pour avoir quelque chose d’autre, sont obligés de faire une
« substitution », de perdre un élément en le remplaçant par un autre
élément. Et ceux qui gardent l’élément ancien et qui y ajoutent l’élément neuf.
Moi, le crabe, j’ajoute des choses. Je fais un tas. Ma vie n’est qu’un tas.
- C’est contradictoire avec
la stratégie du voyage et de la fuite, ça ?
- Non. Justement, j’essaie de
concilier. Mais, c’est de plus en plus difficile. Mais même si ça et ça, c’est
contradictoire, même si l’on me dit : « Tu ne peux pas avoir les deux
en même temps », je dis : « Si ! ». Et je veux les
deux.
-Le Crabe, tu le fais crever
dans le film ?
-Oh…Parce qu’il est sur le
dos ? C’est des images tout ça !
-Qui a demandé qu’on fasse
ces images ?
-Moi. Mais bon… Je voulais
juste le couper en deux. Le martyriser un peu. Ce sont des symboles… Il est sur
le dos, il est sur le ventre, il bave. Bof. C’est facile. Il ne faut pas
chercher des sens cachés. Ils y sont, les sens ! Il peut y en avoir mille.
C’est juste efficace.
-Le poisson.
- (Manset sourit et fait
silence). Là, oui ! Le texte est limpide : « Poisson aux ongles
qui cassent ». Il y a surtout la notion d’Océan. Ce qui est important, ici,
c’est : « La mer descend ». Il y a des images Thaï qui
représentent Bouddha…. Je ne sais plus ce qu’il a fait comme traquenard…. Et il
y a la Déesse Terre. Elle tord sa chevelure, et de sa chevelure naissent les
océans. Sur les représentations Thaï, on voit les océans représentés par des
vagues, avec des poissons –des têtes de poissons- qui sortent de l’océan. Et
ils ont toujours des profils très particuliers. Ce ne sont pas toujours des
femmes… Parfois, ce sont d’autres animaux, des démons.
-Mais, tout ça, c’est mi-
conscient mi… ?
-Pfff… Ça vient on ne sait
pas trop comment. Là, par exemple, il y a une nouvelle chanson que je n’ai pas
mise sur le trente : ça s’appelle : « Les Loups ». Il
existe un certain nombre de figures, d’ustensiles à ma disposition et j’y viens
quand c’est nécessaire. Je fais ma cuisine avec.
L’ALCHIMISTE
-Et les mots clés, la
Mer ?
-C’est le cancer. Le cancer,
c’est l’élément marin, la mer, l’eau. C’est le regard tourné vers l’enfance… On
ne vit que dans l’enfance. C’est une des raisons pour lesquelles je suis obligé
de me fabriquer des souvenirs. Pour me fabriquer des souvenirs, je suis obligé
de fabriquer des objets. Parce que les « objets » sont les seules
traces. Ils évitent de parler et ils restent.
-Les trafics de studio, qu’est-ce
qu’il en est exactement ? Manset, magicien de l’électron ?
-Manset magicien, il n’a pas
duré longtemps ! La seule fois où j’ai trafiqué –ce qui n’était même pas
du trafic d’ailleurs-, la seule fois où j’ai coupé des bandes, c’était
« Orion ». Je voulais arriver à avoir un puzzle qui me satisfasse. Je
voulais des petites ambiances, des échos, des machins.
Depuis, jamais de ma vie, je
n’ai fait un seul trafic ! Si on appelle « trafic » le fait
d’avoir mis un deuxième piano qui était décalé dans « Le voyage en
solitaire ». Si on appelle trafic, le début de « Le Temps Te
Vide » avec les violons à l’envers en les ralentissant ! A ce
moment-là !... Mais ce n’est pas du trafic, tout ça. C’est simplement se
servir de ce qu’on a pour faire passer exactement ce qu’on veut. Dans les temps
qu’il faut : avec la vitesse qu’il faut : avec la longueur qu’il
faut. Les mixages, oui ! Je fais des mixages, je les ai toujours faits.
Mais depuis que j’utilise le Studio de Milan, depuis « Le Voyage en Solitaire »,
même en vingt-quatre pistes, je n’ai fait que courir après la technique !
J’ai toujours eu le dixième, ou même le vingtième de ce qu’il y a comme
matériel dans les autres studios. Ce que j’avais fait en 68 –en 67, même !
- dans un studio quatre pistes, j’attends depuis quinze ans de pouvoir le
refaire ! Tout compresser, comme dans « Le Paradis
Terrestre » - à un moment, il y a des couplets qui reviennent, au
milieu du refrain entre les phrases : ça, c’est compresser une voix au
mixage- je pouvais le faire en 68- ça n’avait jamais été fait à ce
moment-là : personne ne pouvait même oser imaginer chose pareille ! -
et je n’ai jamais pu le refaire depuis !
-Ce n’est pas un choix
déterminé ! C’est les circonstances ?...
-Voilà. C’est pour ça que je
me suis cantonné, sur les trois derniers centimètres par exemple, dans un
matériel de chansons où il n’y a pas de trafic à faire.
LE SOLEIL ET LES VISAGES
-La sculpture ?
-Je me suis un peu détaché de ça, maintenant, pendant un
moment, je collectionnais des choses. J’ai regretté de ne pas pouvoir
collectionner certaines autres. Je me suis demandé, dans le cas où j’aurais
beaucoup d’argent un jour, si je m’achèterais une toile de Van Dongen, une
toile de Matisse, une toile de Braque, si j’aurais une statue de Donatello…. Et
puis je me suis complètement détaché de tout ça. Je ne vivrai pas, je ne
vieillirai pas, dans une maison entourée de vieilles fouteries. Ce sont de
vieilles fouteries, pour moi, maintenant. Même s’il s’agit de Braque ou de
Donatello, je précise. Quand je disais que je crois à « l’objet »,
j’y crois, parce que je sais que c’est le seul moyen de transmettre quelque
chose aux autres. Mais je garde les objets en question à cause de ce que j’ai
dit tout à l’heure du cancer : parce que ce sont « les miens »,
parce qu’ils me rappellent une certaine jeunesse, une certaine enfance, un état
qui a disparu. Que j’ai perdu. Je ne les garde pas pour leur valeur
« artistique ». Je me séparerais aussi bien d’un trente centimètres
que d’une toile de Braque, s’il est question de valeur artistique : mais
je garderai le trente centimètres pour sa valeur affective. Ça c’est tout
récent. C’est depuis que j’ai été en Asie. C’est quelque chose que j’ai
rapporté avec moi : un détachement des choses qui devient absolument
indispensable. Ne plus en avoir. Ou, du moins, essayer de les oublier. Refuser
tout ce qui « représente » une richesse. Avoir sous les yeux quelque
chose dont je saurais que « ça vaut tant », non. Pour revenir à la
sculpture, dans l’art d’Extrême-Orient, auquel je suis très sensible, ce qui me
touche le plus, c’est effectivement la sculpture. J‘ai découvert qu’il n’y a
pas plus proche de l’aspect des gens de ce peuple, que ses sculptures. Ça n’est
pas fait au hasard. Quand j’étais enfant et que je commençais à dessiner, à
dix, douze ans, je trouvais les estampes japonaises « mal dessinées ».
Parce que les pattes des chevaux étaient situées sur le même plan- l’absence de
perspective, c’est une des caractéristiques de cet art-là. Je ne comprenais
pas. De la même manière, quand je voyais les nez qu’ils avaient, ou les yeux,
je trouvais ça caricatural, déformé. Leurs attitudes aussi. On a tendance à
considérer que c’est exagéré. En fait, en Thaïlande, c’est pareil. Aux Indes,
aussi. L’art du Gandhara, c’est la même chose en ce qui concerne la sculpture.
Tout le bouddhisme, tout ce qui s’est propagé comme sculpture bouddhique à
travers la péninsule indochinoise, venant des Indes. Eh bien, quand on se rend
compte à quel point ces visages sculptés sont les visages de ce peuple, de ces
gens-là, on ne peut plus s’empêcher d’aller fouiller profondément, d’aller
chercher le moindre détail, aussi bien dans ces sculptures que chez ces gens.
-Tu avais pratiqué la sculpture, toi ?
-Non. Enfin, du modelage, des bricoles…. Un jour, j’en
ferai. En Thaïlande, c’est une des seules choses que je me verrais pouvoir
faire. Il y a du soleil. Pour la sculpture, il faut de la lumière verticale.
Enfin, on dit ça.
MORS
En sortant de chez lui, je me suis aperçu que j’avais
emporté son stylo en otage (feutre noir de type « Fineliner »). C’est
ainsi que l’on remercie les sphinx qui répondent. En les abusant ! J’ai
regardé la relique sacrée : « Voilà donc le stylet moderne avec
lequel l’homme-oiseau signe ses traces dans la cire du temps ? » En
détaillant l’objet de plus près, j’ai vu : le bout et le capuchon étaient
tout marqués. Gérard Manset mord son stylo.
BAYON
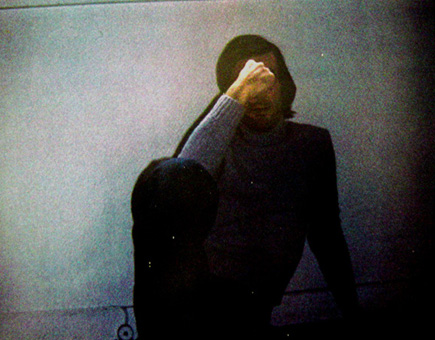
(Paru dans « Libération » le 29/01/1981)
« L’Atelier du Crabe ». Un disque. Pathé
Marconi.
« Le Masque Sur Le Mur ». Un film.