Gérard Manset
portrait d'un homme sans visage
échanges avec les journalistes
C’EST
UNE PIERRE
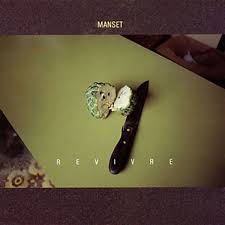
19/05/1991
-Arnaud Viviant- Les Inrockuptibles-
Ce jour-là, entre un bistrot éteint de Max Dormoy et un restaurant thaï fortement déconseillé par le Gault-Millau, celui qui n’a rien à dire évoquera longuement le voyage, les femmes, le poker, Scorpions, la solitude, les antipodes, le désespoir ou Léo Ferré.
Arabesques, circonvolutions, propos parfois inquiétants ou tranquillement inquiétés. A la fin, quoi ? La vérité ?
J’aurais préféré que cela soit un portrait, voire une rencontre ponctuée d’une phrase ou deux, enfin tout ce qu’on veut, sauf une interview. Car je trouve que mon langage parlé n’est absolument pas conforme à l’image que j’ai d’un artiste. Ainsi, je n’aime pas véhiculer une certaine forme de vulgarité, comme cela a pu se produire quelquefois à la radio. Voire, il y a maintenant plus d’une dizaine d’années, dans certaines interviews à la presse où le journaliste avait repris quasiment mot à mot certaines circonvolutions et périphrases dans lesquelles je m’engageais, ponctuées, peut-être pas de grossièretés ou de choses maladroites, mais plutôt, oui, je le répète, d’une certaine vulgarité dont j’ai horreur. C’est une des raisons pour lesquelles je préfère, le cas échéant, me cantonner dans le vouvoiement, et répondre par oui ou par non aux questions. D’ailleurs, je n’ai pas grand-chose à dire. Enfin, allons-y quand même.
On explique la sortie, sinon précipitée, du moins rapide, de Revivre, par le fait que vous voulez de nouveau partir.....
Qu’en est-il au juste ?
Ce n’est pas une volonté de repartir. Personnellement, je suis et je ne suis pas là. Dans ma tête, je suis même beaucoup plus ailleurs qu’ici. En même temps, il y a cette bicéphalité qui fait qu’il m’est définitivement impossible de vivre ailleurs qu’ici. Je suis né à Saint-Cloud, j’ai traîné mes semelles un peu partout, mais je reste attaché au clocher. Donc, quel que soit le côté sucré, l’aisance, la félicité des antipodes, je n’en suis pas. Il y a en moi une perversion définitivement ancrée qui est celle, sinon de la culture, du moins d’une boulimie de signaux culturels tous azimuts, qui me rattache ici. Même si je n’en suis pas dépendant. Car, à dire vrai, je ne vais voir que très peu d’expositions, je ne lis quasiment pas, je n’ai jamais mis les pieds au théâtre de ma vie, la danse je ne connais pas, et le cinéma je n’y vais qu’une fois par an. Pourtant, j’ai besoin de ce grouillement, de ce brouillamini permanent de vies différentes qui n’existe qu’ici, et bien certainement pas dans le tiers ou le quart-monde où, s’il y a grouillement, brouillamini, ce n’est que de vies qui se ressemblent.
Vous n’avez toutefois pas répondu à une partie de la question. A savoir : comment s’explique cette soudaine accélération dans la parution des disques de Gérard Manset ?
Ah, voilà une question précise. Essayons d’être simple. Matrice, c’était il y a un an et demi. Mais pour moi, comprenez, c’était il y a trois ans. Trois ans maintenant que je me coltine ces chansons. Après quoi, il y a eu au printemps dernier la compilation Toutes choses. Mais ce n’était pas des titres neufs. De quoi s’agissait-il exactement ? De faire un peu le tri dans la discographie, d’épousseter l’affaire. Quant à Revivre, j’avais le choix de le sortir à la rentrée prochaine, c’est-à-dire en octobre 91, soit maintenant, au printemps. Or, il faut savoir qu’à l’exception de Train du soir, tous mes disques sont sortis à l’automne. Une nouvelle fois, donc, j’ai voulu casser ce sempiternel rythme automnal. Pourquoi ? D’abord, parce que je voulais faire une croix sur l’aspect tragique de Matrice, son côté oeuvre au noir bien souligné. J’ai voulu Revivre volontairement plus soft, et donc le printemps, avec ses bourgeons partout, me semblait un temps de sortie plus propice. Le plus tôt possible dans le printemps, afin que le disque ait le temps de s’installer, de faire le plein des ventes avant l’été, et que, dès septembre, de façon définitive, enfin, définitive et provisoire à la fois, Manset soit oublié.
Matrice a été disque d’or. Cela a-t-il changé quelque chose pour vous ?
Non. La chose est en l’état, intacte, compacte, homogène. La chose est tenue, gérée, dirigée, élaguée, de façon tout à fait concise, précise, depuis toujours, depuis le premier jour, depuis le premier 45 tours Animal on est mal. Bien sûr, quelques petits accrocs sont parfois venus griser le tableau. Mais bon. Quant à la méthode de vente, elle est toujours la même. Conditionnée plus ou moins par le produit, et cela sans l’avoir voulu, sans l’avoir cherché, sans même savoir que j’aurais la patience d’attendre dix, douze, quatorze, seize albums. Pensant à chaque fois, depuis La mort d’Orion, que ce serait le dernier. Ou, en quelque sorte, ne faisant qu’honorer des contrats que je m'étais soigneusement rédigés moi-même. Cela peut sembler une forme de fascisme dans les conditions de travail, ou tout du moins un privilège ultime, ces contrats autorédigés. Mais non. C’est simplement qu’au royaume des aveugles, un borgne qui a fait ses preuves et qui présente un contrat aux clauses dures mais respectables, ne rencontre aucune opposition. Rien n’a donc changé. Cette forme ultime de sécurité a toujours existé, depuis le premier titre du premier 45 tours. Elle a ensuite toujours été renouvelée quasiment d’office, et même par anticipation, afin de n’être pas sujet aux pressions d’autres maisons de disques. Bref, je n’ai jamais privilégié qu’une chose : le disque, son contenu, sa pochette. Et voilà d’ailleurs pourquoi j’ai balancé une certaine quantité de choses que j’avais faites : parce qu’elles n’étaient pas homogènes avec l’idée d’éternité que je voulais les voir représenter.
Peut-on dire que Matrice était un album sédentaire et Revivre un album voyageur ?
Non. Il y a une même châtaigne avec deux gousses. La peau, l’écorce sont les mêmes. Simplement, il y a des réalités que je ne veux plus assumer. Ce sont : la violence, la dureté, la noirceur de Matrice. A la fin, je trouve qu’il y a une forme d’impudeur dans la voix qui fait qu’une phrase dans une chanson peut être beaucoup plus destructrice que cinq pages dans un roman, quelle qu’en soit l’horreur. C’est par exemple Jacques Brel chantant C’est dur de mourir au printemps.? Développée sur trois cents pages, cette idée, c’est du roman de gare. Mais chantée par un écorché comme Jacques Brel, et je dis cela sans être particulièrement sensible à l’homme, cette phrase a dû en démolir certains. Il faut donc être très vigilant par rapport à ce que porte, transporte, transmet la voix. Voire s’en tenir à distance. Quant à ceux qui soulignent le côté cabot de l’affaire, je ne veux pas citer de nom, mais il est clair qu’ils sont relativement détestables, et à
proscrire.
Ce que vous venez de dire a tout de même l’air de s’opposer à une phrase de Tristes tropiques selon laquelle on a encore le droit d’être cynique ...
Oui. Je sais qu’il y a actuellement une petite polémique autour de cette chanson. Je me suis amusé avec ce texte. Il ne faut pas me demander si j’adhère à tout ce que je dis. Ceci n’est qu’une crise d’urticaire, réactionnaire, qui se retourne d’ailleurs comme un gant et sur laquelle il n’y a pas à réfléchir. Au demeurant, il y a dans Revivre d’autres titres moins descriptifs que celui-ci. Tel Le lieu désiré qui, s’il avait été sur Matrice, aurait possédé quelques couplets de plus, des phrases que j’ai gommées, un aspect plus dur et plus précis que ce qu’il en reste sur Revivre. Là, ce n’est qu’une évocation éthérée, qui se résume à :
Le menton creusé/La barbe de deux jours/Sur le lieu désiré/Il reviendra toujours.
Bon, une fois que j’ai dit ça, j’ai tout dit et on se demande pourquoi la chanson continue (rires).... Mais mieux vaut rester sur ce genre d’évocation ambiguë où chacun peut revivre ce qu’il veut, sans être malmené.
A propos de lieux désirés, pouvez-vous expliquer comment revient dans vos chansons la documentation de type quasiment ethnologique que vous accumulez durant vos voyages ?
D’abord, et pour résumer, je dirais qu’il y a eu à l’époque "rien", puisque je ne connaissais pas le monde. Puis l’époque "foi-illumination" où j’en ai pris plein la tête. Maintenant, comment ai-je retranscrit les choses, comment les ai-je ressorties, ou plutôt comment me sont-elles ressorties ? Là encore, deux époques. D’une part, celle que je qualifierais d’Actuel, en référence au magazine. C’est-à-dire frime. Faire tout avec rien, aller sur tous les coups, grossir les choses, en faire une montagne. Le tout agrémenté d’une prose particulière, mode, kitsch, liée à l’époque. J’ai ainsi longtemps tenu des carnets, oui, j’ai écrit pas mal de choses, que je gardais, en étant vaguement influencé, non, pas vaguement, influencé tout court par ce genre d’écriture : Actuel, Libé. Là, j’ouvre une parenthèse : depuis un an, Libé s’est calmé au niveau de l’écriture, il est passé d’une extrême à l’autre. A cause des femmes. Lesquelles sont toutes très compétentes et contraignent le monde. Sous peu, il n’y aura plus de différence entre les quotidiens car tous seront écrits à 90 % par des femmes. C’est déjà largement visible dans les hebdomadaires, et définitivement dans les mensuels. Fin de la parenthèse. Or donc, après cette période Actuel, j’avais toujours envie d’utiliser certaines choses, mais de manière instinctive, primaire, je me rendais compte que ce n’était pas la manière. Ce n’était pas élégant, c’était provisoire. Or, j’ai horreur du provisoire. Jusqu’au jour où, il y a six ou sept ans, révélation, je suis tombé sur Nerval. Je sais que ça fait un peu itinéraire du Petit Poucet, mais c’est comme ça. Nerval, le Voyage en Orient. Et là, en une page et de façon fulgurante, je me suis rendu compte que la solution était là. Ecriture propre qui permettait de tout dire, avec une profondeur, une acuité infiniment supérieure aux phrases à l’emporte-pièce des Actuel et des Libé. A partir de ce moment-là, je me suis donc attaché à la forme. Voilà.
C’est drôle, vous dites avoir horreur du provisoire et pourtant vous envoyez vos disques au pilon.
Pour que ce qui reste ne le soit justement pas, provisoire. De toute façon, la chanson est provisoire. Et puis, il faut bien s’amuser. Non, s’amuser, ce n’est pas le mot. Disons que les choses ne peuvent pas rester comme ça, permanentes. D’ailleurs, il y a encore bien assez de titres génériques en circulation : Royaume de Siam, Lumières, Y a une route, Matrice Et puis la musique, on s’en fout. Comment dire ? La musique, c’est l’hypocrisie absolue, le marché définitif, la consommation ultime. Toute cette musique partout, ces CD, ces machins, ces mètres cubes entiers de disques, alors qu’une bonne dizaine de titres suffirait, et qu’on devrait virer tout le reste des magasins. Ne garder, selon moi, qu’un bon CD des Stones, un bon CD de musique californienne, de l’époque baba, tiens, flower-power. On garderait aussi Revolver des Beatles, et celui-là suffirait. Et puis quand même quelques CD classiques : quelques symphonies de Beethoven, quelques quatuors de Schubert, de Schumann, tous les concertos pour violons, quelques concertos pour pianos et violoncelles. Et puis un album de Bob Seger. Ou plutôt une compilation. Voilà. On aurait déjà largement de quoi faire, on pourrait partir tranquillement sur son île. Alors le reste ce qu’on appelle la chanson française n’est qu’une industrie comme une autre. C’est Citroën avec ses BX, ses CX, ses ZX C’est le pneu, la chanson française, c’est l’industrie du pneu.
Est-ce qu’on ne garderait pas un Léo Ferré dans le tas ?
Bon, au panthéon des poètes, cet homme a sa place. Quand il montera là-haut, oui, il sera de la famille. Cela dit, il fait partie d’une catégorie d’artistes fragiles dont je ne peux me sentir frère, ni de sang, ni de race. C’est quelqu’un qui ne maîtrise pas sa destinée, il est un peu ballotté. Et puis il est illuminé. Je n’ai aucune affinité avec ce genre de sensibilité exacerbée. Moi, j’aime les poètes purs et durs. Ceux qui ont un caractère affirmé, ceux qui pénètrent les choses, qui ont du relief. Et pas un relief de nature maladive, de décalé, de désaxé.
Pourtant, Léo Ferré et vous avez l’air de partager la même désinvolture par rapport à la musique.
Alors là, vous vous trompez totalement ! Le plafond de ce café devrait même vous tomber immédiatement sur la tête. Car, quelqu’un de désinvolte par rapport à la musique, c’est moi et pas Léo Ferré. C’est même la seule critique que j’admette comme elle englobe toutes les autres. Désinvolture, oui, le mot est très bon. Cela dit, et même si cela peut sembler contradictoire, je refuserai toute critique concernant mon travail sur chacun des albums. Car ma désinvolture vis-à-vis de la musique est globale, c’est, si vous voulez, un détachement. En somme, je ne considère pas cela comme important et je préfère côtoyer un joueur d’échecs, un Kasparov quelconque, plutôt qu’un auteur-compositeur. Qu’a-t-on à apprendre de quelqu’un qui gratouille la guitare, d’un rimaillon ? Cette désinvolture existe donc, non pas parce que je méprise la musique, mais parce que je ne la tiens pas en haute considération. Et a fortiori la chanson. Maintenant attention ! Une page de Beethoven, cela équivaut à une page de Chateaubriand. C’est aussi riche, construit, rigoureux, personnel. Mais là, nous sommes loin de l’industrie du disque. Pour en revenir à Léo Ferré, il n’est pas du tout comme moi. Lui croit en ce qu’il fait, il défend ce qu’il fait, il se bat pour ce qu’il fait. Léo Ferré a des convictions artistiques, politiques, sociales, cosmiques ! Il est sur son nuage. C’est un artiste avec un petit a. Ce qui n’est peut-être pas une tare, mais certainement pas une qualité ! Moi, je ne suis pas de cette nature, je ne m implique pas dans ces choses-là. Cet aspect cabot et déclamatoire, je n’entre pas dedans. C’est du spectacle et le côté saltimbanque n’est jamais recommandable. Bref, Ferré, Brel, c’est un monde auquel je n’appartiens pas. Ce qui entraîne chez moi, d’ailleurs, une certaine forme de solitude. Je ne me sens pas chez moi dans la famille qui devrait être la mienne.
Et cette solitude vous poursuit sous les tropiques ?
Oui, il y a une errance, comme ça, permanente. Un manque d’attaches, de racines. Bon, il y a tout de même des compensations. Je n’ai jamais parlé, au-delà des deux, trois banalités d’usage, de ce que j’aimais dans le voyage. D’abord parce que c’est très personnel. C’est comme l’enfance, ou du moins ce que la psychanalyse nous en dit. Le voyage, c’est une autre forme d’enfance dans laquelle on évolue, où certaines choses vous marquent et d’autres pas. C’est aussi une forme d’initiation constante, nécessaire. Elle a d’ailleurs toujours existé : Sparte envoyait des types dans la montagne avec juste une couverture. Soit ils revenaient, soit ils crevaient de froid. Voilà le voyage. Sauf que maintenant, il faut s’envoyer soi-même.
C’est donc spartiate, le voyage ?
Oui, spartiate et mystique, mais c’est la même chose. A la fin, qu’est-ce qu’on cherche ? On est venu pour quoi ? Pour en prendre plein la tête, être illuminé, secoué, mis à genoux. Pas pour qu’on nous serve la même bouillie tous les matins. Evidemment, c’est un privilège d’avoir un jour assez de recul pour comprendre qu’on n’était pas fait pour cette bouillie, mais pour aller chercher autre chose ailleurs. Tout le monde n’a pas cette chance. Certains sont assommés dès le premier jour, et toute leur vie, il va falloir qu’ils y aillent, sans avoir le temps de sortir la tête de l’eau, y respirer un grand coup.
Vous amusez-vous en enregistrant vos disques ?
Oh oui. Il y a une phrase symptomatique dans une chanson qui s’intitule Je suis Dieu, chanson que j’ai d’ailleurs envoyée vite fait au pilon. Cette phrase dit Et je fais tomber les gens dans des pièges. Un disque, c’est un piège, un trou que je creuserais et dans lequel j’installerais des pals. Certains tombent dedans, d’autres pas, mais moi je sais où les cartes sont biseautées, même si elles le sont peu. Un certain public, et a fortiori les médias, cherche toujours à interpréter. Ils traquent le mot, l’originalité, le son, le machin. Pourtant, il y a mille et mille manières de tromper l’adversaire : on peut ne rien vouloir dire du tout en ayant l’air de dire, on peut dire en s’efforçant de ne laisser aucune trace. Donc c’est amusant. En revanche, je n’ai pas ri du tout quand certaines personnes m ont averti qu’il y avait de gros problèmes de son avec le premier master de Revivre. Soudain, j’étais pris à mon propre piège. Sinon, la situation me fait penser à l’introduction de Mauvais karma : " Quelqu’un joue là-bas/Tire le manche vers le bas/Les choses vont et viennent/S’allument et s’éteignent/Et sont heureuses et saignent/Interminablement/Sur cet écran". Quelqu’un est au-dessus de la mêlée, ailleurs, question de stratosphère. Il tient le manche, devant l’écran tout le monde gesticule, lui il fait reculer, avancer, arrêt sur l’image, il rigole et des types tombent dans le trou. Un disque, c’est pareil, même si on se trompe. Mais on ne peut pas se tromper.
Et vous rigolez quand on vous dit que Revivre est moins bon que Matrice ?
Ah, oui, je me marre. Car on ne peut pas apprécier Matrice et dénigrer Revivre. Ces deux disques sont équivalents sur des tas de terrains. Certes, Revivre n’a pas l’esbrouffe, le côté rameuteur de Matrice. Par exemple, un morceau comme Banlieue Nord sur Matrice, c’est du péplum, c’est Quo Vadis. Je ne dis pas que je n’aime pas, parce qu’heureusement, à un moment, ça monte : Mon Dieu, montrez-nous quand même , là, j’avoue, j’ai le frisson. Après, il y a des choses plus intimistes, on ne peut pas toujours faire du cinémascope. C’est Exil ou Filles des jardins qui trouvent leurs équivalents absolus sur Revivre avec Le lieu désiré ou Chant du cygne. Bref, il s’agit du même album. Donc je me marre. Enfin, plus ou moins....
Allons plus loin : c’est toujours le même album, non ?
Si l’on veut. La plus grande liberté, je l’ai découverte il y a quatre ou cinq albums, lorsque j’ai compris que je n’avais même plus besoin de signer mes titres. Qui allait me prendre Comme un guerrier ou Matrice ? Personne. Il y a cette signature constante. Alors, si l’on veut chipoter, on peut dire que par rapport à Banlieue Nord, quelques couplets de Tristes tropiques auraient besoin d’être déposés à la Sacem. Il y a des lieux communs, on sent moins l’implacable personnalité de l’auteur. Mais c’est involontaire. Cela fait partie du jeu. J’attendais qu’on me dise : Voyons, Gérard ! Ne sommes-nous pas nous-mêmes des peuples opprimés, c’est d’un banal !?
Pourquoi refusez-vous d’être photographié ? C’est métaphysique ? Ou policier ?
Eh bien, cela a encore à voir un peu avec Tristes tropiques. On peut considérer ce refus comme une forme d’imbécillité primaire, première, animale, instinctive, difficilement formulable mais sécurisante : la peur de se faire voler son âme. Je vous vois hocher la tête. L’explication ne vous plaît pas ?
Disons que je la trouve assez indienne, peu civilisée...
Oui, oui, encore une fois, c’est : "Ne sommes-nous pas nous-mêmes des peuples opprimés". Alors, bien sûr, après, il y a des ramifications. Lesquelles ne font que raffermir, étayer, rendre indiscutable l’affaire. On ne voit le monde, n’est-ce pas, qu’à travers ses propres conceptions du monde. Or, les miennes sont les suivantes : je ne vais, ne fonctionne que là où il y a un pan caché, dissimulé, quelque chose de flou, de pas très clair, de difficilement exprimable, une polémique sur laquelle on peut discuter des jours ou se taire définitivement. C’est, si vous voulez, l’Immaculée Conception, le Saint-Suaire, ou encore les pyramides. Qui les a construites, les pyramides ? On ne veut pas savoir. Par connivence avec le public, j’essaye donc toujours de ménager quelques pans d’ombre. Un peu comme l’architecte qui dirait:" Je viens de construire un immeuble à Paris dont la façade fait très mal. Mais je ne vous donnerai pas l’adresse." C’est un jeu de pistes. Enfin, tout ça pour dire que mon attachée de presse me donne des boutons quand elle me dit :"Tu sais, pour les Inrockuptibles, c’est très important les photos, l’esthétisme ", tous ces arguments que je connais par coeur. Je m oppose totalement à cette forme d’esthétisme qui ressemble à ces raisonnements dont les prémices sont fausses, et dont la construction seule est juste.
Avez-vous le sentiment d’appartenir à une génération ?
Oui, celle de 68, mais à l’époque je la réfutais. Au moment des pavés, j’étais en train d’enregistrer La mort d’Orion, et alors que tous mes copains étaient au Panthéon, sur les barricades, je n’ai connu, moi, du Quartier Latin à cette époque, que des coupures de courant, des baisses de tension. C’est évidemment le hasard. Mais je ne sais, de toute façon, si j’aurais adhéré à ce mouvement. Car j’étais personnellement totalement pour l’image du père, je trouvais tout à fait désastreux qu’on brûle tout, qu’il n’y ait plus d’ordre, d’enseignement, qu’on ne vénère plus personne. Eût-il mieux valu que je sois comme les autres ? Je ne sais pas. Et puis les meneurs étudiants me semblaient d’un tel ridicule ! Alignant un tel chapelet de banalités, celles-là que je ressors aujourd’hui avec dérision dans Tristes tropiques ! Je me demande de toute façon comment les gens peuvent adhérer à des partis politiques, quels qu’ils soient. J’ignore si c’est une tare, mais il y a là une forme de crédulité que je n’ai pas. J’aimerais croire à toutes les carottes que l’on nous tend, mais je ne veux pas. Ce qui, encore une fois, entraîne une forme de solitude et de désespoir. Il faudrait être comme tout le monde : brebis. Donc, j’ai raté 68. Et des années après, et là sans la moindre excuse, j’ai raté la plus grande période à mon avis depuis la Renaissance : le flower-power. Led Zeppelin et tout le toutim ! (Rires). Je n’étais pas à Woodstock. C’est lamentable ! Incompréhensible ! Enfin, pas tout à fait. Car à l’époque, je ne pouvais pas adhérer à cette planerie collective. Cela me semblait un mouvement de déchéance absolue, de doux illuminés, une perte. Pourtant, quand on compare cette effervescence à celle d’aujourd’hui, on se dit que c’était vraiment la Renaissance. Bref, j’ai raté ça et je le regrette amèrement. J’aurais dû passer trois ans à Woodstock, cinq ans en Californie. D’autant qu’aujourd’hui, il n’y a plus aucune raison de se sentir quelque part aux Etats-Unis.
Et la drogue ? Jamais essayé ?
(Las) On m'a demandé cela il y a tellement longtemps. Non, bien sûr, je n’ai jamais essayé. Vous savez, j’ai en permanence la faculté de bloquer l’imagination, l’inspiration. Car ça va très vite : la moindre idée, la plus petite suggestion, et c’est parti, je construis mon affaire. Et c’est non-stop : une véritable prolifération tous azimuts, des greffes infinies, les unes sur les autres. C’est quelque chose que l’on ressent avec l’écriture de Bayon, ce débit, cette inspiration sans relâche, ce vomissement, cette logorrhée. Eh bien, c’est pareil chez moi.
Vous avez longtemps joué au poker....
Tiens ! Je me demande d’où vous tenez ça. Eh bien, le poker, avec le recul, c’est vraiment une belle école. Une vraie psychanalyse. Les gens jouent réellement comme ils sont, on les dirait allongés sur un divan. Pour apprendre à se connaître, il faut jouer au poker, c’est évident. Toutes les gammes de bluff, de surenchère, de suivi prennent ainsi, suivant les caractères, des allures différentes. Il y a par exemple des poètes qui sont à table. Vous les voyez. Ils ne jouent pas nécessairement mal, mais ils gèrent leur main de façon aléatoire. Quant aux femmes, je me souviens qu’il y avait, quelquefois, une copine à table. Je jouais quelques tours par correction, puis je demandais à être remplacé. Sans être misogyne, il était impossible de jouer avec elle. Je pouvais pratiquement calculer tout le monde, sauf une femme. C’est comme s’il y avait eu un cheval à la table, ou une chaise. C’était un être d’un autre monde, irrationnel, sujet à des humeurs tout à fait hors d’atteinte : flambant à un moment, ne sachant plus rien à un autre, prenant, ne prenant pas, suivant, ne suivant pas. On ne comprenait pas. Quant à moi, je jouais ainsi : vite, bien, jamais aléatoire. Et je jouais ce qu’on appelle béton, sans pratiquement jamais me recaver , me renflouer. Jusqu’au jour où j’ai quand même tout laissé sur un coup et où j’ai arrêté.
Comment ça s’est passé ?
C’était un coup où plusieurs mains sont montées très haut, il y avait des jeux maîtres à droite et à gauche. J’ai été obligé de payer. Mais n’importe quel joueur à ma place y aurait laissé son tapis. C’était un concours de circonstances troublant.
Mais où était le plaisir au poker ? Dans les poussées d’adrénaline ?
Oh non, il n’y a jamais eu de poussée d’adrénaline. Je suis malheureusement un être très froid. Non, le plaisir, je le trouvais plutôt dans un certain esthétisme arithmétique. Et puis le poker, c’est comme la vénerie, un univers avec un vocabulaire particulier, des rites, des règles, des coutumes. Ce sont des activités que je ne pratique plus guère aujourd’hui, mais pour les mêmes raisons, j’ai pénétré dans le monde de la sauvagine avec les gabions, les appeaux Ainsi que celui du surf- casting et de la pêche à la mouche, où il y a mille mouches différentes, plusieurs façons de les nouer, de les présenter. Ce sont des univers à part, comme le poker. Néanmoins, j’insiste, je n’aurais pas tout laissé sur une partie. J’étais plutôt là en spectateur. Je n’avais pas la nature d’un joueur, même s’il m’est arrivé d’aller à quelques tables plus importantes que celles de mes amis, notamment sur la côte d’Azur, à Cannes. Dès que les premières difficultés se sont présentées, j’ai laissé la place. En fait, ça revient à ce que je disais précédemment sur le voyage et l’initiation. A l’époque, le poker, c’était peut-être une façon de voyager.
Ça ne vous manque donc pas ?
Non, ce que je regrette, ce n’est pas vraiment le poker, mais plutôt la notion de lieu, de club où, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, on retrouve les copains, les Bayon, tout ça, pour discuter, boire un verre ou deux, sans même parler de jouer aux cartes. Roda-Gil, il fait ça à la Closerie des Lilas, mais moi je ne suis pas très Closerie. Alors oui, un club, un lieu de rendez-vous, ça me manque.
Vous ne parlez pas souvent de vos musiciens ?
Oui. Je constate souvent que je suis seul à tout faire. Et je réponds à ceux qui me le reprochent que je ne trouve personne Pendant très longtemps, je me suis plaint des musiciens, car je n’ai jamais obtenu d’eux ce que je voulais. J’étais donc obligé de jouer moi-même avec tous les pains que cela suppose. Et si jamais je voulais les faire rejouer, j’avais tout de suite droit au sarcasme, à l’ironie. Pourtant, en vingt ans, j’ai croisé quelques collaborateurs, individus, copains, auxquels je dois beaucoup. C’est le cas de Mike Lester, qui fait la moitié des guitares sur Revivre ou Matrice. Mike m a fait découvrir deux choses : le karaté et Bob Seger. C’est quelqu’un qui a l’esprit 100 % rock, c’est-à-dire martial. Un type en or, absolument inattaquable, un peu plus jeune que moi au demeurant. Enfin, toujours est-il qu’il m' a amené les guitares que j’attendais : à la fois hard et humaines, vraies. Je crois en effet que le hard-rock est une des plus grandes écoles musicales qui soient. Là encore, comme au poker ou dans les arts martiaux, il s’agit d’une école de vérité. De même qu’un coup de bluff ne fait pas trois jours à une table de poker, il ne peut y avoir d’esbrouffe, de tricherie, de mystification dans le hard-rock. Les types arrivent, ils allument l’ampli et ça joue. C’est pourquoi je maintiens que Scorpions n’est pas un petit groupe. Au début, ils faisaient marrer tout le monde. Mais non ! C’est une très grande musique, Scorpions, il y a des auteurs derrière, il y a un pulse ! Ce n’est pas comme les disques de Michael Jackson, où on ne sait pas qui fait quoi, qui apporte quoi et combien cela a coûté. Et tant mieux s’ils font actuellement un carton ! Or, c’est Mike qui m a fait un peu découvrir tout ça. Bien sûr, il y avait eu des prémices : les Small Faces, par exemple. Mais en me balançant il y a une bonne quinzaine d’années Bob Seger dans la tête avec Night moves et tout ça, Mike a vraiment renversé la vapeur. Il a ouvert une porte en moi et tout le reste a suivi. C’était le début de l’ère des auteurs-compositeurs purs et durs, et j’ai découvert que Bob Seger était le plus pur et le plus dur d’entre eux : voix rocaille, bonne instrumentation. Et puis tourner trois cents jours par an, ce qui fait que, lorsqu’il rentre en studio, ça sonne. Trois guitares sèches, une basse, une batterie et ça suffit. Voilà des musiciens respectables. Peut-être que leur vie ne l’est pas, quoique je me demande si Bob Seger n’est pas un peu curé sur les bords. En tout cas, j’aurais bien voulu suivre une de ses tournées comme ça, pour voir, dans le camion.
Le suivre, d’accord. Mais la faire ?
Oui, on me questionne beaucoup sur mon refus de jouer sur scène. Pourtant, il faut comprendre. Nous, bons Français avec le béret et la baguette, nous sommes, comparés aux Américains, comme culs-de-jatte en ce qui concerne la scène, les tournées. Nous aurons toujours droit à Michel Berger et France Gall. Qui sont gentils, qui font, et je le dis sans une once d’ironie, de mépris ou de critique, une musique bien propre. Simplement, ça n’a rien à voir avec la compétence américaine. Nous, nous avons Truffaut, que nous tenons pour un génie sous prétexte qu’il met trois heures pour ficeler trois plans avec des acteurs qui ne savent pas jouer. Eux ont Spielberg. Bref, l’Amérique possède des paramètres de grandeur et de démesure que nous n’avons pas. Nous, nous sommes un petit pays, avec des baraques les unes sur les autres, des appartements en tas. Eux, c’est cow-boys, Marlboro, éperons, et ça part. Et la route, c’est ça. Bob Seger, ça roule tout seul.
Gainsbourg vient de mourir. Or, comme vous, il ne se contentait pas de composer. Il peignait, il photographiait, il écrivait.
Oui, on ne peut pas lui retirer ça. Mais ça m’emmerde de parler de lui. Je n’ai jamais été amateur. Je ne regrette qu’une chose : ne pas l’avoir rencontré pour lui dire, gentiment, ses quatre vérités. Je suppose qu’à un moment, cela lui aurait vraisemblablement fait du bien, sinon plaisir. Car j’ai l’impression qu’autour de lui, il n’avait que des amateurs inconditionnels. Ce qui est bien déplorable. Aussi se trouvait-il dans un cycle infernal. Plus il augmentait la dose, moins cela se retournait contre lui. Plus il lançait la balle haut, plus les gens applaudissaient. Et puis aussi, comment s’explique son désastre personnel, cette fuite en avant irrépressible, quel qu’était son talent ? Par l’absence de hiérarchie. Je m’explique avec un exemple. Bayon, mettons, dont je suis en train de lire Le lycéen, et qui est définitivement la seule personne qui me fasse rire avec Louis de Funès, sort un bouquin. Est-il meilleur ou pire que celui de Labro ? Qui va le dire ? Ainsi, ce qui est très déstabilisant pour les artistes, c’est l’absence d’échelle de valeurs indiscutable. Autrement dit, vos relations, vos amis, vos intimes, vos pairs peuvent bien vous répéter que vous êtes le meilleur, cela ne vous empêche pas de rentrer le soir et de douter comme au premier jour. Et de vous demander si tout cela, à la fin, n’est pas qu’une vaste farce...
*********************************************************************************************************************
REVIVRE, DIT-IL
par Philippe BARBOT (Télérama n°2150 du 27/3/1991)
par Philippe BARBOT (Télérama n°2150 du 27/3/1991)
Aussi avare de mots que de photos, l'animal. Mais pour « Revivre », Manset s'explique. Scoop ! Il abandonnerait la course en solitaire pour les voyages en groupe. Paroles d'Evangile restituées par un fan.
C'est un fruit exotique qui gît sur un étal. Tranché net par une lame, rustique mais effilée qui repose à côté de son culinaire forfait. De la blessure clinique, sourdent quelques noirs pépins. Bref, c'est un agrume coupé en deux. Mais c'est surtout le cliché, pris il y a quelques années dans une ruelle de Bahia, qu'a choisi Gérard Manset pour illustrer la pochette de son dernier album. Ne cherchez pas, il n’y a pas de symbole.
Le disque s'intitule « Revivre ». C'est aussi le titre d'une des sept chansons du disque, préféré de justesse à deux autres qui sonnaient tout aussi bien, « Capitaine Courageux » et « Tristes Tropiques ». Mais bon, vous imaginez les problèmes de copyright...
C'est vrai, pourtant, dans l'œuvre de Manset, il y a du Rudyard Kipling pour la geste obstinée, et du Claude Lévi-Strauss pour l'ethnologie poétique. Et ce disque, s'il en était besoin, le prouve une nouvelle fois : textes sculptés à la main, ciselures de rimes, pas un mot de trop, pas la moindre coquetterie gratuite, pas le moindre écart de lyrisme douteux, tout est soupesé, affiné, éprouvé. Écoutez-moi ça : « On voudrait revivre / Mais ça veut dire/On voudrait vivre encore la même chose / Refaire peut-être encore le grand parcours/Toucher du doigt le point de non-retour. » Qui d'autre que lui, le Gérard l'ermite, le chantre d'Asie, pourrait se le permettre ?
Revivre, donc. Renaissance et répétition, deux thèmes chers à l'auteur de « Y'a une route », mais ici, comment dire, régénérés. Pas dans l'habit : toujours cet éternel et familier piano frileux, cette boite à rythmes laconiques et ces quelques effusions de guitare électrique qui rappellent « Matrice », l'album précédent. Pas étonnant : la plupart des chansons ont été enregistrées en même temps et sortent de la même matrice, justement. Mais cette consanguinité (les deux disques sont davantage frères jumeaux que fragments d'un dyptique) se tempère cette fois de climats apaisés, presque sereins. Avec, immédiatement discernables, trois points de mire, trois crêtes : « Le Chant du cygne », un des cinq plus beaux textes du Gérard Musset, dans la lignée de « Toutes choses » ; « Le lieu désiré », sorte de suite immobile à « Il voyage en solitaire » ; et « Capitaine Courageux » symphonie spatiale toute de mouvements aquatiques, dans le sillage de « Camion bâché ».
Après avoir nettoyé sa discographie, entre laser et pilon, et dépassé, enfin, la barre fatidique des cent mille exemplaires vendus, l'animal se sentirait-il un peu moins mal?
« Ce succès m'a permis de franchir une ligne de démarcation psychologique, c'est vrai. Mais je suis encore bien loin des Cabrel ou des Goldman, on ne fait pas le même métier… En fait, avec le recul, j’ai pris conscience d'un paradoxe tordu : « Matrice » était un disque très dur, et c'est ce pourquoi je suis fait, ce qui rend sans doute ma démarche artistique unique. Pourtant, j’ai décidé de ne plus colporter ce genre de choses. Je ne veux pas laisser cette image de... torturé. Les excès, en tout, sont à récuser. Il y a un juste milieu et je crois l'avoir approché avec ce disque. »
Dans un bistrot de la porte de Saint-Cloud, Manset s'explique. Rendez-vous quasi rituel qui, cette fois, en accord avec lui, ne prendra point la forme d'une classique interview. Artisan tatillon du mot, Manset redoute la trivialité d'une conversation sur le vif, la crudité banale de phrases extirpées de leur contexte. Car, c'est notoire, l'auteur de « Rien à raconter » est un interlocuteur plutôt disert.
« Tu trieras tout ça », s’inquiète-t-il parfois, au sortir d'un long détour oratoire. En voici une tentative, condensée, ramassée et, sauf son respect, épurée. Dur de réécrire Manset...
REVIVRE, MODE D'EMPLOI
« Rien à voir avec la réincarnation bouddhique. ici, c'est plutôt au sens conventionnel, chrétien, du terme. Mais, derrière le cliché éculé, une idée, une nuance m’a intéressé : si on repassait à travers les mêmes tamis, les mêmes épreuves, Si an avait la possibilité d'analyser à chaque seconde, image après image, le film de sa vie, de ses faits et gestes, sans doute pourrait-on être en règle avec soi-même Et il n'est pas dit qu'on aurait envie de modifier ce qu'on a déjà vécu… »
CHANSON DEBOIRE
« J'ai beau tendre vers quelque chose de littéraire, car c'est mon seul propos, ma seule raison de faire de la musique, je sais que deux ou trois phrases chantées ont souvent plus d'impact que dix pages de texte. Pourtant, j'exècre le mot chanson. Si l'on dit une chanson de Trenet, d'accord, le mot chante de lui-même. Mais, ce qu'est devenu l'univers de la chanson n'a rien voir avec ça. Je suis toujours sidéré par la tolérance du public envers certains… chanteurs. La vraie tolérance serait de les laisser s'exprimer, mais de refuser de tomber dans les pièges tendus à la goujaterie, à la vulgarité. »
FILS DES TROPIQUES
« Il y a une phrase, dans la chanson « Tristes Tropiques », qui dit : « Ne sommes-nous pas nous-mêmes des indiens des plus rares... ». C’est un peu une provocation, dans le contexte actuel de boulimie écologique. Nous aussi, nous avons droit aux plumes, aux amulettes, aux scarifications, aux sévices, aux déplacements de population, même si c'est de manière plus dissimulée. Peut-être qu'un jour il faudra dire que la misère, affective, nutritive, est chez nous. Et que les bons vivants, ce sont eux, les peuples des tropiques, avec leurs étuis péniens et leur curare... »
MODERNE INANITE
« On me reproche parfois le son de mes disques, dépassé, disent certains. Mais on ne se rend pas compte du ridicule de l'actualité. J'ai revu récemment Le Pacha, à la télé, un film avec Jean Gabin. Il y a une scène tournée dans une boite de nuit où l’on voit des jeunes gens très flower power, avec des colliers et des vestes à dorures, danser le jerk... Immédiatement, le film date. Dans la création artistique, il faut tenir compte de l’horreur de la modernité. »
SOLO FINAL
« Pour la première fois, j'ai fait le vide des titres que j'avais en réserve, pour ne pas me retrouver piégé par mon fonds de commerce. Il ne m'en reste qu'un, qui s'intitule « Toujours elle » et que je n'ai pas enregistré pour le sauvegarder. J’aimerais que ce soit le point de départ d'un autre univers sonore, d'une autre façon de travailler. J'ai désormais besoin de la notion de groupe, d'atelier plutôt, comme en peinture. J'envie ces peintres d'Asie qui travaillent dans la rue, au coude à coude.
La production artistique ne peut être éternellement solitaire, dans une chambre de bonne ou dans un palace. Sinon, on est condamné à se scruter le nombril. J'ai envie d'avis, de conseils, de réactions. Après tant d'années, c'est sans doute mon désir le plus important : je ne veux plus travailler seul ! »
***********************************************************************************************************************
RÉSURRECTION
Par Yann PLOUGASTEL pour l’Évènement du Jeudi (28/3/1991)
Porte de Saint-Cloud, vendredi midi, brasserie Les Trois Fontaines. Au fond de la salle, un homme redoute d'avoir la migraine. Il a tenu à ce que la lumière vienne de sa gauche. Un ami l'a surnommé « le pèlerin du silence ». Un autre, plus soucieux de références littéraires, a ajouté .... « Une sorte de Beckett du rock. » On ne sait pas grand-chose de lui. Un nom. Des disques. Une poignée de morceaux qui montent à la tête (migraine ?). « S'il chante / C’est qu'il est deux / C'est qu’il est heureux / Dans son monde à lui.» Au programme : du noir, de la peine, quelques étoiles, des membres rompus, des amours perdues, des larmes dans la nuit, beaucoup de vide... Plusieurs milliers de fidèles lui vouent un culte secret sans qu'il apparaisse à la télévision ou donne un concert. II jette juste de temps en temps des messages à la mer.
L'homme a un pull informe, un jean trop large et des baskets improbables. Comme d'habitude, il y a un point d'interrogation qui danse dans son dos. Quel masque porte-t-il aujourd’hui ? Va-t-il être le guerrier solitaire, le voyageur immobile, le prisonnier de l'inutile, le capitaine courageux, le philosophe énigmatique, le bouddhiste sourcilleux ? Sur les pochettes de ses albums, son image apparaissait de plus en plus fugacement, brouillée ou floue. Celle fois-ci, pour « Revivre » rien ! Un fruit brésilien coupé en deux et un couteau (« Découper le monde à coups de rasoir pour voir au cœur du fruit le noyau noir » chantait-il autrefois). Comme s'il n'existait plus… « J’ai assez donné dans l'impudeur de la première personne, désormais on donne dans le « on ». Puisqu'il n'est plus rien qui puisse montrer qu'on est sûr, autant prendre le parti de l’afficher », assène l'homme au menton creusé. Puis il commande une bouteille de bordeaux. On l'avait quitté zen, buveur de thé et adepte du riz complet, il revient amateur de vin... Plus tard, il ira jusqu'à avouer son admiration pour Jean d'Ormesson (« I ’image du père Idéal ») Jean-Edern Hallier (« l'inconscience ne naît pas du néant ») Cet homme, chez qui le rire est mort, aime saccager les illusions de ceux qui croient avoir percé une part du mystère. « On marche de travers / Comme un crabe / Et la mer descend », avouait le refrain d'un de ses morceaux clés.
INSTANTS DE GRÂCE ET DE FACILITÉ
Apres avoir annoncé qu'il renonçait à la musique pour peindre et écrire, puis revisiter son œuvre en élaguant l'indigne à coups de serpe pour ne garder que les chants du cygne, l'homme du train du soir a repris la route du studio. Pour deux albums ; Matrice, plongée parfaite entre ténèbres et silence (« Renvoyez-nous d'où on vient »), qui, depuis le carton de Il voyage en solitaire, s'est avéré la meilleure réussite de notre homme ; et aujourd'hui « Revivre », versant arrogant de la même montagne (malgré un mixage en dépit du bon sens qui relègue les mots dans un lointain préoccupant). «Le crabe, c'est le Cancer. Mon ascendant (…) Le Cancer, c'est l'élément marin, la mer, l’eau. C'est le regard tourné vers l'enfance…. On ne vit que dans l'enfance. » D'où cette volonté de re-vivre qui ne correspond pas à une résurrection mais à un besoin de « vivre encore la même chose », comme si on ne pouvait échapper à une ornière tracée. Ce dernier disque est bizarre. Hybride. Avec des instants de grâce (« Chant du cygne », « Revivre »,) et des facilités qui tournent à la caricature (« Tristes Tropiques » ou « Eden Bay »). Comme s'il s'agissait de relativiser — à la baisse — la luminosité de Matrice. Porte de Saint-Cloud, vendredi, 15 heures, brasserie Les Trois Fontaines. On a envie de citer Verlaine :« Dans une rue au cœur d'une ville de rève / Ce sera comme un instant qu’on a déjà vécu / Un instant à la fois très grave et très aigu. Gérard Manset a mal à la tête.
**********************************************************************************************************************
UN ENTRETIEN AVEC GÉRARD MANSET
(LE MONDE | 11.04.1991)
JE, D'OMBRE ET DE LUMIÈRE
(LE MONDE | 11.04.1991)
JE, D'OMBRE ET DE LUMIÈRE
Singulier et sombre, rocker sans autre excès que celui de son caractère, Gérard Manset vient d'achever un album suave, « Revivre », suite attendue du très beau et très dur Matrice de l'an dernier, juste après un coffret chic en forme de best of.
Yves Simon, à quarante-cinq ans, connaît les honneurs de l'intégrale, dix CD, à paraître en deux fois d'ici à la fin de l'année. Bien campé dans son époque, il a choisi de s'éloigner de la scène il y a plus de dix ans. Gérard Manset peint. Yves Simon écrit. Ils voyagent. L'un chante et l'autre pas. Question de mots, et question de fond : qu'est-ce que la chanson ?
Réponses esquissées par deux auteurs-compositeurs-interprètes d'après soixante-huit.
MANSET est un sujet difficile. Dire que c'est un mystère serait contribuer à la construction du mythe. Bâtir un prophète là où il n'y a qu'un chanteur serait insulter ses propres exigences : celles du vrai, de l'authentique. Et, d'ailleurs, est-il chanteur ? Question posée, réponse évitée : " Voilà bien un mot à proscrire. " Mais que fait-il donc dans la vie ce grand garçon brun, adolescent tourmenté de quarante-cinq ans environ, qui déteste le bruit et la fureur du siècle et qui voudrait à tout prix ne pas en être le produit ?
Les quelques traces de réalité décelées dans sa vie protégée indiquent qu'il voyage, qu'il a appris les langues orientales dans une école, et, surprise, qu'il serait plutôt sympathique une fois ôtée la noirceur mélancolique imposée par l'image Manset.
De Manset, on retiendra qu'il ne donne pas d'interview, sauf quand il en donne, qu'il pratique assidûment les arts mineurs -la chanson, la photographie- et s'adonne avec une passion impatiente et déçue à un art majeur, la peinture.
Dans un café de la Muette, Manset parle. Pour le jeu des questions-réponses, c'est non. " Ça, c'est bien quand on a vraiment quelque chose à dire. " Lui...
« Revivre » vient de sortir un peu plus d'un an après « Matrice », album unanimement encensé par la critique. Ce matin-là, l'homme secret qui habite le rock français n'est pas dans son assiette. Insatisfait du mixage de son quinzième disque - la voix était trop en arrière - il en demandera quelques jours plus tard le retrait des bacs des disquaires. L'imperfection a quelque chose de la souillure. Remixé adéquatement, Revivre fait aujourd'hui une seconde sortie, ce qui ne lui confère pas pour autant la qualité de« Matrice », mais voilà qui passionnera les collectionneurs.
La création a des caprices. Manset, dit-on, fabrique des blocs, dont il tire d'abord le meilleur, puis l'acceptable. A la question des dates, de la chronologie, l'auteur-compositeur répond: « Si on passait mes albums au carbone 14, on constaterait qu'ils sont tous de la même époque. Je maquille. »
Seul confidence, en signe de bonne volonté : « Capitaine courageux », plus quatre ou cinq titres de son nouvel enregistrement ont été composés avec « Matrice ».
Il enlève ses lunettes noires. Et les remet aux premiers signes d'agacement.
« Plus on avance, plus le bon sens disparaît. Auparavant, on pouvait passer les trois-quarts de son temps à s'affiner. Le reste était consacré à la technique et au commerce; maintenant, c'est l'inverse. Dix minutes de création et dix mois de justification, de mise au point. »
Sincère, manipulateur, fragile, tourmenté, talentueux, Gérard Manset tourne autour de la chanson, la triture en boucles répétitives. Même ton, même guitare électrique, même voix solitaire et tremblante, même rythmique, même déprime. Exil. Automutilation. Y a une route, Camion bâché : le style Manset a un on-ne-sait- quoi d'hypnotique, comme ces spirales sans début, ni fin, par lesquelles les tourments de la dépression se prolongent dans un délice maniaque.
Gérard Manset serait-il prisonnier de lui-même ?
« Dans le malentendu total et global de la mystification artistique, je suis un petit cas particulier vécu avec honnêteté. Un artisan peut-être un peu plus qualifié que les autres. Depuis Bouddha, on n'a pas inventé grand-chose. Tout n'est que redite. La personnalité, l'identité d'un individu tient à cette façon particulière d'exprimer les mêmes choses. D'où les excès d'aujourd'hui, eux seuls sont surprenants. »
La légende dit : Gérard Manset fait tout, tout seul. Il écrit, compose, arrange, mélange et veille avec un soin pointilleux sur le travail de studio.
« Le travail et la concentration passent par le refus du monde. » Ecrasante responsabilité que celle de l'homme retranché. « Immédiatement après la satisfaction, commence le doute. » Et le rocker avoue aujourd'hui sa tentation du groupe, son envie d'oreilles habiles à détecter les vices de fabrication avant lui, son rêve impossible de spectacles vivants.
Le succès de Matrice -la barre des cent mille exemplaires vendus est enfin franchie- lui aurait-il donné l'envie de redescendre au rang du commun des mortels ?
Manset, qui oscille entre la divinité (un ésotérique " Je suis dieu " lancé dans les années
70, et pris au pied de la lettre par les fans) et le sentiment de la nullité (" Je suis totalement stérile "), trouve l'époque impudique.
« La danse, le cinéma, la chanson : du cirque, une foire infantilisante. Chanter est exhibitionniste. Le vagissement, le glapissement de la voix, c'est comme se déshabiller », et la boulimie de consommation made in USA a perverti cette époque " à vomir ". Manset n'est pas gai. Où met-il le plaisir ? " Dans le quotidien. " Haussement de cils.
A LA RECHERCHE DE LA MYSTIQUE PERDUE
On ne peut pas parler d'itinéraire musical à propos de Gérard Manset.
Plutôt de repères, en forme d'albums, puisqu'il a rayé la scène du registre de ses phobies.
1968 : un tube météorique dans une année agitée : « Animal, on est mal ». 1975 : « la Mort d'Orion » (sic !!), lettré et confidentiel. « Lumières », en 1984, album prophétique, à la recherche du dépouillement et de la mystique perdue (« Finir pêcheur ») et « Matrice », en 1990 (resic… !!), incisif et dur (« Banlieue nord »).
Jusqu'à 1977, il se prête au jeu du chanteur. Ne se cache pas autant. Ne se mutile pas encore le visage du N de son nom (comme sur la pochette de « Matrice »). Mais cette année-là, lui, " l'entier, l'excessif ", ne supporte plus de travailler au beau milieu du fatras de la télévision, des spectacles approximatifs. Il se retire. Part. Ailleurs, « là où les mots sont vrais. En Thaïlande, pays de western, où l'étymologie est respectée, les rapports de forces disent leur nom ». Il y écrira un roman, « Royaume de Siam ».
Sac au dos, voyageur solitaire, personnage sombre, il réserve ses œuvres à ceux qui se laissent élire. Dépouillé, ennemi de l'inutile et du superflu, allusif, Manset apparaît, disparaît. C'est une seconde nature, au demeurant payante sur le plan de la carrière, un art du contraste.
« La faute ne vient pas de ceux qui choisissent de rester dans l'ombre, mais des médias qui ont sous la main des gens qui veulent bien s'exposer. »
Dix ans après sa désertion physique, dix albums plus tard, il annonce son retrait définitif de la chanson. Les disques jugés imparfaits sont au pilon (tous). Les « accros » de la poésie noire, admirateurs de la première heure ou nouveaux venus dans le cercle manséiste, essaieront de reconstituer la collection complète avec dévotion.
Seul 45-tours, hormis « Filles des jardins », tiré de « Matrice », « Caesar », titre chanté en latin, extrait de la Mort d'Orion (rere-sic…). Rarissime.
A la fin de l'année passée, avec le dédain apprêté du dandy, le rocker bouddhiste fait son autocritique et sauve vingt titres de son œuvre passée, les remixe, et les emballe dans deux CD à tirage limité et numéroté, accompagné d'un double jeu de cartes (le bridge) estampillées d'une toile du peintre anglais Sir Edward Burne-Jones -des jeunes filles hypnotiques et diaphanes -qui orne la pochette. C'est chic, très chic. « Bien sûr, l'habillage est une opération de marketing. »
On dit Manset ésotérique, il en devient agaçant, comme une secte à lui tout seul.
« Il y a des lumières, des voix soufflées de loin. » Ceux que le siècle n'aura pas encore totalement dévorés comprendront. « Un langage codé ? Ah, oui, on dit ça ? C'est normal, c'est comme ça que je reçois les mots. Je suis ami et complice avec les mots. Poète, voilà peut-être le substantif qu'il me reste, entre le respectable et l’inintégré, je dis bien l'inintégré. » Il note ce mot dans un carnet de poche.
« Mon travail doit tendre vers la littérature. »
Manset l'élitiste ne lit pas. N'écoute pas de musique.
« Beethoven, je pourrais. Mais, non, c'est trop castrateur. Et puis, par préscience, je débusque tous les lièvres de la création artistique. » La première page du premier chapitre de « l'Assommoir » de Zola lui suffit à comprendre l'ampleur de l'écrivain.
De même, de courts extraits de « Tristes tropiques » donnent la mesure de Lévi-Strauss, « un de ces êtres intelligents que les gens omettent d'écouter, quelqu'un qui a gardé le bon sens qui nous fait aujourd'hui cruellement défaut ».
Pas besoin d'épiloguer. « De toute façon, la réalité d'une création artistique se mesure au volume et au poids. A l'intérieur de ces portes verrouillées, je construis des jeux de piste, des lieux où je maintiens les choses. »