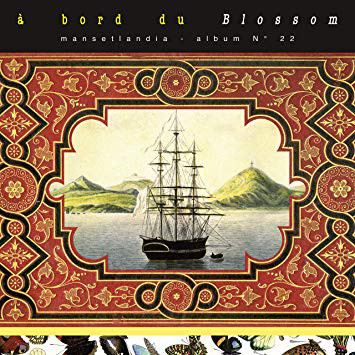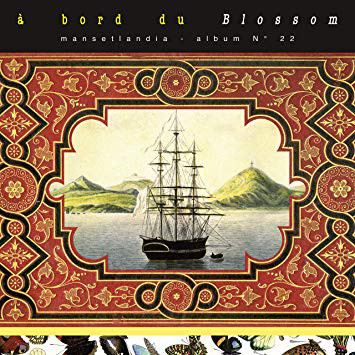Gérard Manset
portrait d'un homme sans
visage
échanges
avec les journalistes.....
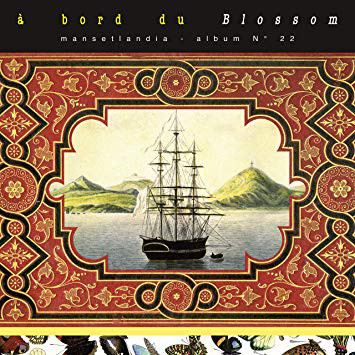
Gérard Manset, infatigable explorateur du paradis perdu
AFP , le 20/09/2018
"Je
ne suis jamais sorti de l'état d'innocence. J'ai cette chance d'être
une sorte d'errant permanent dans un monde flottant": Gérard Manset
invite une fois de plus au voyage, "à bord du Blossom", son nouvel
album élégiaque dédié au paradis perdu.
L'artiste de 73 ans est un
cas à part dans le paysage musical français. Méconnu du grand public,
l'auteur- compositeur-interprète de disques importants tels "Gérard
Manset" (1968), "La mort d'Orion" (1970) ou "Royaume de Siam" (1979)
s'est toujours appliqué à entretenir le mystère à son sujet, prenant
soin de rarement apparaître médiatiquement et refusant de se produire
sur scène dont il abhorre "l'impudeur".
En 50 ans de carrière, le
chanteur d'"Animal on est mal" est ainsi devenu une sorte de mythe
vivant, vénéré par ses fans et qui jouit d'un statut unique dans
l'industrie du disque, creusant le sillon de son oeuvre atypique en
toute liberté.
"C'est quelque chose que j'ai entretenu. J'ai vu mes
amis entrer dans les bureaux et se faire jeter, alors que moi j'en
sortais avec ce que je voulais. Parce que j'étais raisonnable. J'ai
quand même vendu pas mal d'albums et maintenant je suis devenu une
sorte de danseuse", sourit l'intéressé, dans un entretien avec l'AFP.
Sa
dernière odyssée musicale sort vendredi et ne manque pas de lyrisme.
Comme souvent chez Manset, l'exotisme est au rendez-vous, et avec lui
certains de ses thèmes favoris: la nature, l'enfance, l'innocence et le
paradis perdus.
Cette fois, le chanteur-narrateur nous embarque "à
bord du Blossom", un navire britannique du XIXe siècle commandé par le
capitaine Frederick William Beechey, parti à la découverte d'une Terre
pas encore cartographiée et à la rencontre d'une tribu primitive,
incarnation d'une société ingénue idéalisée par Manset l'utopiste.
Et
si Manset lui-même avait découvert le dernier petit îlot encore jamais
exploré sur Terre lors de ses pérégrinations ? "Je n'y avais pas pensé
! Peut-être qu'à mon insu, j'ai trouvé cet îlot sans le savoir !"
- "De quoi devenir fou" -
"Mais
en fait, cet îlot, il existait encore dans les années 1970, 1980",
reprend-il, nostalgique. "Il y en avait des milliers aux Philippines,
en Indonésie, au-dessus du Venezuela... Depuis, il y a eu internet, les
outils de communication, la mondialisation et il n'y aura plus jamais
rien de tout ça."
Tel un "capitaine ad hoc" tenant un journal de
bord, Manset ravive de nombreux mots oubliés tirés d'ouvrages
d'anthropologie ou d'anciens récits d'aventure - goémon, madrépore,
santal, ménure-lyre, paradisier - et nous promène dans des contrées
lointaines, Alao, la mer des Balabac, Surigao...
Celui qui voyage
pourtant "en solitaire" sait aussi bousculer avec des chansons qui
ramènent à la dure réalité du présent. La ballade pop "On nous ment"
s'enchaîne ainsi à "Ce pays" qui ouvre l'album avec ses cordes
désenchantées.
"J'aime mettre en rapport des choses qui n'étaient
pas faites pour se rencontrer. Dans +Ce pays+, je décris pendant dix
minutes un monde paradisiaque, où on sent quand même que ça va se
gâter. Mais +On nous ment+ est aussi immature, là aussi on garde un
pied dans l'innocence", souligne Manset de sa voix sur le fil.
Une
innocence dont il se détache avec le magnifique "La vierge pleure".
"J'ai retrouvé ces mots que j'avais écrits il y a très longtemps: +elle
a reçu son émissaire, il lui remet la lettre+. J'en ai eu des frissons
! Et j'ai déroulé jusqu'à la fin: +Dans le grand palais du
passé/Quelqu'un lave par terre/Tant de choses sont entassées/La vierge
solitaire décide de se taire/Pour des millions d'années+".
Sur cette
chanson, Manset a une voix grave. Et c'est avec la même mine qu'il
affirme ne plus voyager: "le monde a beaucoup changé. Avant, je partais
sans rien, dans un avion à moitié vide. A l'aéroport, le mec tamponnait
le passeport parfois à l'envers et on passait. Maintenant, ce sont les
files d'attentes, les empreintes digitales... De quoi devenir fou. La
confrontation des deux époques est difficile."
**************************************************************************************************************
25/09/2018 pour RFI
Gérard
Manset, figure tutélaire de la chanson française, publie son 22e album.
À Bord du Blossom relate en chansons et en textes les pérégrinations
d'un capitaine dans les mers du Sud. Comme à son habitude, l'artiste a
créé comme il voyage, en solitaire.
RFI Musique : Quels sont les récits de voyage qui ont façonné votre imaginaire ?
Gérard
Manset : Il y en a peu. Pierre Loti, évidemment, car c'est l'un des
rares à avoir écrit autant de récits de voyage. Il est du XIXe siècle,
le siècle que je privilégie. J'ai à peu près lu toute son œuvre, je
suis un inconditionnel admiratif, car j'ai aimé sa vie, son courage,
ses multiples aventures, très touchantes. Il a écrit Le Mariage de Loti
qui se déroule à Tahiti, qui est d'une beauté à pleurer à toutes les
pages ; le Roman d'un Spahi, dont l'action se situe à Saint-Louis du
Sénégal, également de toute beauté ; Aziyadé, qui se passe en Turquie,
Mon Frère Yves, en Bretagne, ou encore Ramuntcho, au Pays basque.
Il
y a peu d'écrivains français qui ont autant écrit sur le voyage,
contrairement aux Anglais ou aux Américains… Petit, je lisais Belliou
la Fumée ou Croc blanc, de Jack London. Celui que j'ai dans la poche
(il le sort de son manteau), c'est Lord Jim de Joseph Conrad.
Merveilleux roman qui se déroule dans des pays que j'ai bien connus et
aimés, dont j'ai parlé la langue, c'est-à-dire l'Indonésie, toutes les
îles de la Sonde. Les voyages ont été toute ma vie. Ceux que cela
intéresse pourront faire leurs recherches sur mes 30 années de voyages,
ma demi-douzaine de livres de photos et les 15 ouvrages parus.
Que cherche le voyageur ?
Je
peux difficilement répondre tellement ce sujet est inopportun ! Depuis
une quinzaine d'années, avec l'Internet, il n'y a plus de voyages. Je
l'ai souvent raconté : j'arrivais dans des aéroports, il n'y avait pas
de douane, pas de sécurité, on prenait son billet au pied levé, les
avions étaient vides… Avec le tourisme de groupe, la démographie, les
comités d'entreprise ou le troisième âge, c'est un monde révolu.
Les
voyages que j'ai accomplis, c'était seul, avec mon appareil photo à
l'épaule, sans bagages, un carnet, un stylo et des "travellers chèques"
en poche. Une époque à laquelle les populations aimaient accueillir les
quelques rares solitaires qui se baladaient ainsi, alors
qu'aujourd'hui, c'est très suspect.
Deux chanteuses originaires des Antilles vous accompagnent sur cet album. Comment les avez-vous rencontrées ?
J'avais
allumé ma télé et je les ai aperçues toutes les deux sur un plateau
rigoler au moment où elles reposaient une guitare. Tanya St Val et
Lycinaïs Jean ne me connaissaient pas, bien sûr. Elles ont chanté sur
Mon Karma. La seconde est revenue au pied levé pour Ce Pays et
Paradisier.
Quel est ce projet Mansetlandia inscrit sur la pochette de votre album ?
Il
y a en moi deux personnages : l'auteur poète qui se réveille tous les
matins avec 1000 choses à écrire, avec son petit jardin intime ; il y a
aussi celui qui ouvrirait la fenêtre et verrait ce jardin luxuriant
qu'il faut entretenir, c'est le producteur de musique, celui qui gère
le fonds de catalogue. J'ai souhaité regrouper mes albums dans une
sorte de boîte, Mansetlandia, comme un concept de société.
Sur le
Net, certains tiennent à mon égard des propos laudatifs, d'autres
trouvent que c'est toujours pareil, une sorte de ressassement
personnel, de thèmes récurrents, une musicalité qui est toujours la
même puisque c'est moi qui écris et dirige tout. J'admets que je puisse
lasser, c'est le lot de tous les écrivains. Comme avec Pierre Loti, le
style est le même, seules les escales changent. On peut dire que ce
Capitaine Manset est passé à travers beaucoup d'albums et de chansons :
Capitaine Courageux, Lumières… Sur cet album apparaît une
certaine Maria-Teresa, dans Manila Bay, qui était citée il y a très
longtemps sur Eden Bay… Une Chambre à La Havane se retrouve dans mon
ouvrage Cupidon de la nuit, que je viens de publier. Un livre qui est
un peu le corollaire de cet album.
Écrivez-vous différemment pour Raphael, Pagny, Bashung ou pour vous-même ?
J'écris
différemment lorsque l'on me demande seulement un texte pour une
musique qui existe déjà. Car lorsque je compose, l'inspiration me vient
en bloc : paroles, mélodies, orchestration… Plus personne ne conçoit la
musique ainsi, c'est pour cela que je bénéficie d'une certaine fidélité
de la part du public. L'inspiration, c'est se réveiller le matin et Le
Paradisier tombe. On prend la sèche, les accords viennent, la mélodie
apparaît… À midi, c'est terminé. On est assommé par un choc émotionnel.
C'est vraiment très proche de ce que l'on ne connaît pas nous, hommes,
qui est un accouchement. Je lui fais son berceau, je lui fais ses
habits, je le nettoie, je le nourris… Écrire, composer,
orchestrer, mixer… c'est tout cela. Je réalise seul mes mises au
monde.
**************************************************************************************************************
Capitaine Manset
Par Thierry Gandillot pour Les Échos Le 05/10/18
Dès
son second album, « La Mort d'Orion », Gérard Manset, 26 ans, entre
dans la légende. Qui aurait osé, en 1970, livrer un opéra-rock de cette
ambition ? Plus d'un demi-siècle s'écoulera avant que Gérard Manset
publie un nouvel album concept, « Opération Aphrodite » d'après le
poète Pierre Louÿs (1870-1915). Manset nous emmène cette fois à bord du
Blossom, un sloop commandé par le capitaine Frederick William Beechey
(1796-1856), qui a exploré le Pacifique Nord, visité Rikitea, les îles
Gambier et navigué parmi 23 atolls des Tuamotu. Manset s'empare de
l'histoire pour inventer l'odyssée d'un jeune capitaine à travers des
îles sauvages et des contrées vierges qui n'existent que dans sa tête.
Il nous promène à Surigao, Alao, Lawag, Butuan, Davao, Balabac, parmi
les paradisiers papous, les rois des gobe-mouches, les épimaques, les
diphyllodes à la queue en lyre arrondie et les lophorines à la coiffe
égyptienne. En quinze chapitres, chantés ou récités, c'est tout
l'univers de Manset qui s'offre, avec ses hôtels louches, ses rues de
plaisirs, les paradis perdus où des jeunes filles, collier de fleurs à
la main, offrent des cocktails de bienvenue ; on marche sur des «
rivages enchantés que les étoiles ont chantés », on dort dans « des
chambres à La Havane où les lumières se pavanent ». On aura une pensée
particulière pour les amours du capitaine et d'Amaïti Amaïta, encore à
l'âge de l'immaturité.
« C'était tactile, furtif, ils se
touchaient, se frôlaient, puis s'écartaient l'un de l'autre pour mieux
se détailler et s'apprécier mutuellement car en réalité ayant compris
qu'ils s'adoraient. » Laissons-les à leurs amours et remontons à bord
du Blossom en compagnie du capitaine, forcément courageux, sur cet «
océan qui se voulait à lui ».
******************************************************************************************************************************
Gérard Manset cherche toujours son paradis perdu
par Michel TROADEC pour Ouest-France le 23/09/2018
D’une écriture riche et dense, l’infatigable Manset continue à nous faire voyager.
Cet
« errant permanent dans un monde flottant », comme il se définit, sort
un 22e album en cinquante ans de carrière. D’une obsédante beauté.
Il
y a deux ans, pour écrire son 21e album, Gérard Manset s'était inspiré
de la poésie de Pierre Louÿs, d'Aphrodite,son roman aux accents
érotiques, écrit en 1896, situé dans l'antique Alexandrie. Un
concept-album comme l'avait été son deuxième opus, le mythique La mort
d'Orion (1970), qui contait la mort d'une planète, d'un peuple. Près de
cinquante ans après, le pire étant encore plus probable, Manset, dans
La Vierge pleure ne raconte pas autre chose.
Pour
ce nouvel album, le poète-chanteur a donc repris le principe du
concept-album. Comme pris de passion pour les explorateurs, il conte,
en fil conducteur du disque, l'odyssée d'un capitaine courageux et...
amoureux.
Nostalgique inconsolable
Car,
mine de rien, l'amour, comme dernier refuge, occupe peut-être encore
plus qu'avant les nouvelles chansons du septuagénaire. C'était vrai
dans Opération Aphrodite, ça l'est encore dans À bord du Blossom. Une
chambre à La Havane est un rassurant nid d'amour : « Je me souviens de
chaque chose/Je me souviens de chaque instant/du couvre-lit de satin
rose/que mordait le bout de ses dents ».
Délicieux
souvenir... Car Manset, passéiste assumé, nostalgique inconsolable,
éternellement orphelin d'un paradis perdu, avouant n'être « jamais
sorti de l'état d'innocence », chante aussi, comme dans un élan de
sincère naïveté : « Pourquoi les femmes sont-elles devenues méchantes
?... » Et d'insister : « Mais tout était doux, tout était rose/Pourquoi
les femmes sont devenues tout autre chose... »
Toujours
lyrique, Manset nous promène dans des paysages fortement exotiques, sur
fond de guitares (acoustiques et électriques), des cordes d'un
orchestre, de quelques cuivres. Et n'oublie pas de faire valoir ses
énervements avec l'entraînant On nous ment.
C'est
un 22e album et on ne s'en lasse pas. Pour les plus curieux, une
intégrale de Manset, en 18 CD (Warner) existe. Elle regorge de
chefs-d'oeuvre. Pour les plus littéraires, il a publié, en juin,
Cupidon de la nuit, entre journal de bord, souvenirs, voyages et
réflexions, où le chanteur se dévoile, comme rarement.
***************************************************************************************************************************
Le grand voyage de Gérard Manset
par Benjamin Locoge pour Paris Match |le 05/10/2018
"J’ai toujours l’impression d’être le réalisateur de mes disques" dit Gérard Manset.
Il
est le plus généreux des réfractaires. Le plus mystérieux des
chanteurs. Depuis « Animal on est mal » en 1968, Gérard Manset a passé
sa vie à fuir, à lancer des bouées à la mer pour dire le monde tel
qu’il est, dans sa décrépitude et sa splendeur, sa misère et sa joie.
Il le prouve magnifiquement avec « A bord du Blossom » et a accepté de
se livrer. A sa manière.
Paris Match. D’où vient cette aventure “A bord du Blossom” ?
Gérard
Manset. Comme j’en ai l’habitude, quand je termine un disque, personne
ne l’a entendu. Cette fois, j’ai tenu, il y a trois mois, à le faire
écouter à ma maison de disques. Et, dans ce cas, je me retrouve dans la
position du débutant. Car les gens ne mesurent pas à quel point je me
sens seul au monde avec mon travail. Je suis dans un registre
littéraire du XIXe où l’on reprend 90 fois sa copie. En général, le mec
arrive en studio, fait quelques prises de voix, part à la campagne,
puis on fait appel à des arrangeurs, et le disque sort. On peut
évidemment s’égarer en route, les gens peuvent aussi bien être éblouis
que ne rien comprendre. Après avoir écouté mes titres, Christophe
Palatre, le boss, m’a posé la question qui tue : “C’est quoi le concept
?” [Il rit.] Je n’en avais évidemment pas, sauf celui, après “Opération
Aphrodite”, de sortir neuf chansons qui n’avaient rien à voir entre
elles.
Vous acceptez donc la critique ?
Ce
n’était pas une critique. Mais j’ai écouté. Le matin suivant, je suis
tombé sur un bouquin consacré aux récits de navigateurs et j’ai lu ce
mot, “Blossom”. Ça a fait tilt, j’avais mon concept, moi qui n’avais
jamais rien écrit sur la navigation, les récits de marins. J’étais
fébrile…
Au final, “A bord du Blossom” est un grand disque d’amour…
Selon
certains de mes proches, on ressent dans cet album la jubilation de
celui qui l’a fait. Et seul l’amour permet cela. Mais je suis toujours
dérangé par le “je”. C’est pour cela qu’il y a un capitaine, un
narrateur qui raconte une histoire. Il faut monter à bord…
Il y a certains titres où je me dis vraiment : “Mais enfin, Gérard, personne d’autre n’a ça, c’est un chef-d’œuvre.”
Vous avez publié un livre en mai, “Cupidon de la nuit”, qui évoque notamment votre dépit amoureux.
Oui,
le “dépit amoureux”, c’est une jolie formule. Je ne fais que le
constater, avec pudeur. Mais je réponds à tout un tas de questions à
mon sujet dans “Cupidon de la nuit”. Quiconque ayant décidé de le lire
jusqu’au bout y trouve beaucoup de réponses.
Pourquoi avez-vous cessé de voyager ?
Le
monde a changé, qu’on le veuille ou non. Il faut faire avec ces
quantités de routards qui trimballent le “Lonely Planet”. Je me revois
débarquant seul dans le sud des Philippines où il y avait de vieux
hôtels coloniaux. Je choisissais la chambre la moins décatie avec un
petit ventilateur, j’y restais un jour ou deux et j’allais voir
ailleurs. Mais, désormais, le monde est en marche, avec une quantité de
gens qui voyagent. Je ne suis ni déçu ni nostalgique, mais je ne veux
pas en faire partie. La jeune génération a été sacrifiée par Internet,
par l’anglais, par son épouvantable universalité, qui a tué la poésie,
le voyage, l’écriture. C’est absolument affligeant.
Cette année marque vos 50 ans de carrière. Avez-vous l’impression d’être là depuis cinquante ans ?
J’ai
l’impression d’être là depuis trois jours mais que ce ne sont que les
mêmes trois jours. Je n’ai pas vraiment évolué. Je fais toujours tout
de A à Z, personne n’intervient, hormis de très bons musiciens. Il y a
certains titres où je me dis vraiment : “Mais enfin, Gérard, personne
d’autre n’a ça, c’est un chef-d’œuvre.” Ça peut paraître prétentieux,
mais c’est le gamin qui parle, celui qui fait des châteaux de sable.
Qui a “La vierge pleure” ? Si j’étais américain, je vendrais 100
millions de singles avec un tel titre. Mon problème est que je suis le
dernier artisan de la chanson, je fais de l’ébénisterie, de la
marqueterie.
J’ai les mêmes choses en tête que lorsque j’avais 14 ans
Avez-vous le sentiment d’être de plus en plus inspiré, de plus en plus créatif ?
Non,
au contraire, c’est l’encéphalogramme plat. Je n’ai jamais évolué,
jamais dépassé mon petit cercle, c’est très étrange. Je n’ai jamais
emmagasiné, il faut vraiment que j’en aie vu beaucoup pour être proche
de Pierre Loti ou de Gauguin. Car tout le reste s’efface. C’est très
troublant, à mon âge, de n’avoir rien capitalisé. J’ai les mêmes choses
en tête que lorsque j’avais 14 ans. J’étais récemment à La Forêt des
livres, j’entendais toutes les conversations érudites et je me disais :
“Mais comment peux-tu être aussi loin de tout cela ?” Cela ne me pose
pas de problème, j’en suis même jubilatoirement satisfait. C’est ma
bulle, ma carapace, rien n’a pu la percer. Picasso était dans le même
cas.
Quand je regarde “The Voice”, j’imagine bien que si quelqu’un reprenait “Matrice” ou “Comme un Lego”, cela jetterait un froid
Pas mal de chanteurs se revendiquent de vous. Cela vous touche ?
On
me le dit souvent. Pourquoi pas ? Mais, ce qui m’intrigue le plus,
c’est que personne ne s’empare de mon matériel. “A bord du Blossom”,
c’est une symphonie fantastique d’une heure. Eh bien, aucun réalisateur
ne va m’appeler pour faire une musique de film. Ça fait quarante ans
que c’est comme ça…
Vous n’avez pas aidé à faire vivre votre répertoire, vu votre irascibilité envers la scène.
Ce
n’est pas une irascibilité. Juste une absence. Quand je regarde “The
Voice”, j’imagine bien que si quelqu’un reprenait “Matrice” ou “Comme
un Lego”, cela jetterait un froid. C’est vrai que si l’on m’entendait
chanter “Fauvette” moi-même, cela changerait tout.
Mais tous les autres chanteurs montent sur scène !
Oui,
ils ont commencé jeunes et ils ont un ego démesuré. Au fond, je ne me
vois pas être l’objet, le point de mire. J’ai toujours l’impression
d’être le réalisateur de mes disques, je ne me vois pas les présenter
devant une salle, être applaudi. C’est très inconvenant. Moi, j’ai une
prétention autre, qui réside dans une sorte d’éternité, au-delà du
temporel. Pas mal, non ?
*******************************************************************************************************************************
Aimer Manset
Par Jean-Paul GERMONVILLE -29 septembre 2018 (pour lotrinfo)
Les
années 80 venaient à peine de commencer et on s’est offert, charlotte
et moi, durant quelques petits jours une fugue vers les terres
d’Armore – Pas vu Pas pris ( Christophe ) -.
Dans ma musette
j’avais glissé « Royaume De Siam » de Manset. Nous avions pris pour
habitude de n’écouter, sur un vieux magnéto vraiment poussif, que la
chanson-titre. Cette semaine-là a pris des allures d’éternité tant
chaque instant devenait intense, à fleur de peau, à fleur d’âme. Tout à
coup, même les circonvolutions les plus banales de cette terre au bout
du continent avaient des allures de paradis terrestre, celui qu’il
chantait dix ans plus tôt, quand je l’ai découvert, avec ce coup
d’audace que constituait l’opéra pop cosmique « La Mort d’Orion ».
Déjà, Gérard Manset psalmodiait à propos de cette utopie bien humaine…
« Voyez ce qu’il en reste. C’est une terre aride, les yeux perdus au
fond des rides ».
J’aurais dû écouter l’ensemble de l’album «Royaume
de Siam », y lire, avant qu’elle ne me fracasse en plein vol, le prix
de la vanité et le poids désespéré du destin : « Toi qui nous quittes
pour ce pays-là, où tu dis que les gens sont beaux »…. Et ailleurs
encore : « C’est un homme dont le corps se penche. Comme un arbre mort
il tend ses branches. Le froid est là, la neige est blanche ». Tout
était écrit !
Si longtemps après, Manset est toujours bien là. Les
thèmes sont les mêmes, l’émotion aussi, mais abordés différemment, même
si sa partition conserve cette tonalité unique, un son identifiable
entre tous où se vautrent, avec un délice parfois douloureux, cordes,
guitares électriques, claviers, cuivres et gimmicks hispanisants. Si
longtemps après, dès l’introduction, le Vingt-deuxième chapitre de «
Mansetlandia » – l’œuvre -, il impose cette vérité : « Mais ce pays ,
que vous dites, il n’existe pas, avec du soleil et de l’ombre, je l’ai
cherché longtemps… ». Fin 2018, le bonheur est tout aussi, sinon plus,
insaisissable. Alors, il reste la mémoire pour brûler jusqu’à
l’obsession une nuit torride dans une chambre de La Havane, promené sa
déglingue entre Manille et Le Mali… Seul, toujours, mais en rêvant
d’absolu : « Sur la photo y’a plus qu’un tas de cendres. Une larme a
coulé qu’on voit descendre ». Aujourd’hui comme hier, le poète
s’ingénie à mêler les mondes. Cette fois, il superpose les errances
amoureuses et terrestres de Frédérick William Beechey, capitaine du
Blossom, à sa propre vie, ses errances, aux nôtres. Les formats des
morceaux se moquent de l’ordinaire et des normes du show biz pour
glisser de l’exotisme musical à de solides rock habillés de dentelles.
Du corps affolant de Amaïta Amaïta, perdue jusqu’à l’ivresse dans la
folie hypnotisante d’une danses enfiévrée au fond d’un bouge, au
mensonge institué par les médias contemporains, et des hommes dits
responsables, « On nous ment le matin. On nous vend. On nous vend de
l’espoir ».
Celui qui a écrit un jour « Il Voyage en Solitaire »,
plusieurs parmi les plus belles chansons de Bashung. Celui qui refuse
la scène par choix, écrit, compose, dessine, peint, photographie mérite
beaucoup plus qu’une simple chapelle, si importante soit-elle. « A Bord
Du Blossom » est l’occasion, unique, de recoller les morceaux cassés,
de refaire son retard… «Le monde fait la grimace, qui tourne sur son
erre, tandis que de partout, les poings se serrent.
***************************************************************************************************************************
Le capitaine Manset nous entraîne à nouveau dans une odyssée musicale hypnotique, teintée de nostalgie et d’idéalisme.
par Valérie Lehoux Telerama n°3584 du 19/9/2018
Il
y a quelque chose de définitivement troublant chez Manset. De troublant
et de fascinant à la fois, dans sa façon d’avancer en suivant un idéal
d’esthétisme qu’on pourra trouver désuet, voire kitsch, et qui n’en
demeure pas moins habité par un souffle saisissant. Cet album, plus
encore que le précédent (qui déclinait le mythe d’Aphrodite), affiche
sa prétention : tisser le récit romanesque des pérégrinations d’un
capitaine naviguant vers un pays de cocagne — quête d’une société et
d’un âge d’or qui obsède l’artiste. Une sorte de livre-disque, sans
livre, mais ponctué d’intermèdes parlés qui scellent le concept. A
l’heure du streaming et du single triomphant, Manset sanctuarise l’idée
même d’album, à prendre comme un tout. Sur ce point, on lésera Sa
Majesté en détricotant l’œuvre et en oubliant les transitions — y
compris celle où une jeune indigène vient blottir son corps frissonnant
contre celui du capitaine… On se concentrera plutôt sur les chansons,
des fresques hypnotiques capables de jeter leur charme étrange sur
l’auditeur réceptif. Comment Manset parvient-il encore à ne pas se
parodier tout en creusant le même sillon stylistique depuis des années
— titres longs, flot verbal incompressible, voix tremblée, mélodies
lancinantes ? Comment balaye-t-il nos réserves, lorsque l’on
s’interroge sur le fond d’une pensée teintée de passéisme (quand il
chante, par exemple, « pourquoi les femmes sont-elles devenues
méchan–tes ») ? En affirmant, tranquille, sa radicalité. Manset n’a
jamais rien concédé à personne. Au contraire : il insuffle à ses
chansons une certitude — la sienne, sans doute — qui ne cesse
d’impressionner, et finit toujours par nous gagner.
******************************************************************************************************************************
Grandes traversées en solitaire
Par YVES BIGOT pour ROLLING STONE N° 108 (Octobre 2018)
Vingt-deuxième album étonnant pour le coureur de fond de la chanson rock.
Annoncé
par son auteur révisionniste comme son album numéro 22, À bord du
Blossom est attribué à Mansetlandia, périmètre sous lequel il
réunissait déjà, en 2016, l'ensemble de son œuvre encore disponible
dans un coffret de 19 CD. Annoncé par "On nous ment", en playlist sur
France Inter tout l'été, son titre le plus dynamique depuis "Paradis"
(1994) et le plus prophétique depuis "Banlieue Nord" (1989), tout en
guitares aiguisées, cuivres free et coq-à-l'âne comme au temps de
"Animal on est mal" et de "On sait que tu vas vite", ce voyage
initiatique renoue thématiquement avec ses années Gauguin et poursuit
structurellement son précédent ‘’Opération Aphrodite’’ (intermèdes
récités, interventions des chanteuses antillaises Lycinaïs Jean et
Tanya Saint-Val, voix d'enfant).
Manset a toujours eu son côté
prog (La Mort d'Orion, 2870), et il y repique (quatre morceaux
dépassent les huit minutes) avec ce second album-concept d'affilée,
traversée exotique de "Mailla Bay" à "Mon karma", en passant par "Une
chambre à La Havane" comme dans un rêve, dans lequel, chez lui, il faut
toujours entrer.
On est là en droite lignée de son fourmillant
"Cupidon de la nuit" (Albin Michel, 2018), autobiographie masquée,
éclatée et nostalgique, comme un requiem pour une liberté et une
diversité disparues. Avec sa philosophie poétique onirique, son
écologie primate, Manset se révèle conservateur, au sens scientifique,
patrimonial, préservatif. "Ce pays" désiré, s'il n'existe sans doute
pas plus que l'île de la série Lost, en tout cas n'existe plus. Et,
comme tous les paradis perdus, il en devient mythique, baigné ici d'un
érotisme raffiné parallèle à celui d'"Opération Aphrodite", alors
inspiré du roman correspondant de Pierre Louÿs. Dans "Pourquoi les
femmes", aux quelques accords bluesy, Manset dit finalement son
tourment, celui d'un capitaine abandonné, par son époque, par ses
semblables, par toutes celles qui donnent la vie - et son sens à
celle-ci -, sous l'enseigne #MeToo.
Il y a pourtant tant de
raisons de l'aimer, le Solitaire: sa singularité, son univers et sa
musique à nuls semblables, conjuguant ici préciosité, mythologie et
naturalisme à la Buffon. "À bord du Blossom" est sans doute son album
le plus intéressant depuis longtemps, qui fait le tour, avant le
successeur possiblement -très rock-, de nombre de ses arcanes,
retrouvant des accents oubliés, entre guitares de retour (on croirait
entendre Steve Howe dans "Le Paradisier") et cordes majestueuses.
****************************************************************************************************************************
Avec « À bord du Blossom », son 22ème album, le chanteur reste radical et nostalgique, mais dynamique
Par YANNICK DELNESTE pour SUD-OUEST/ 12 novembre 2018
« On a tué l'Imaginaire »
A
la table du café parisien, à l'heure de la première rencontre, on ne
fait pas le fiérot. De «Animal » en 1968 au « Blossom » de cet automne,
la même exigence distante, traînant comme sa voix un parfum de mystère.
Manset est une légende et un fantôme, jamais monté sur scène, fuyant
jusqu'il y a peu les entretiens pendant des décennies, rétif à une
société médiatique bruyante et broyeuse. Et le voilà devançant la
première question, s'enquérant du nom du chroniqueur taurin de «
Sud-Ouest»... « Zocato, oui ! Au soleil avec un coup de rosé, lire "
Sud-Ouest ", c'est chouette quand je viens du côté de Libourne ou
Bordeaux. J'étais à genoux devant ses papiers.»
-« Sud-Ouest » : Connaissez-vous bien la région ?
-Gérard
Manset : Mes parents venaient en Charente-Maritime, du côté de
Saint-Georges-de-Didonne, par là... Moi aussi, plus tard. Je me
souviens me promener en 1975 sur la plage de Saint-Palais et d'entendre
« Le Solitaire » sortir de tous les transistors. Très étrange
sensation.
-Est-il vrai que vous n'avez pas bien vécu le succès de ce « Il voyage en solitaire » ?
-J'ai
eu du mal à m'adapter aux conséquences d'un tube de l'été. La renommée,
les ventes, je ne suis pas contre, mais dans la discrétion. Je suis
devenu une sorte d'objet et je n'aime pas ça.
-La discrétion est-elle possible ?
-Elle
est attaquée de toutes parts par les réseaux sociaux, la société,
l'administration. Il y a trente ans, on pouvait déchirer son passeport,
passer une frontière. Plus un pays maintenant où votre identité n'est
pas enregistrée. Je suis un humaniste qui voit l'humanité aller à sa
perte avec la fin de la liberté de penser, de bouger et donc de
disparaître. La vraie aventure n'est possible que si elle est anonyme.
-Après « Opération Aphrodite », un nouvel album récit avec « À Bord du Blossom » : comment est-il né ?
-Depuis
quelques années, j'aime assembler des choses hétérogènes. L'album était
prêt avec les chansons qu'il contient aujourd'hui, les gens de Warner
avaient l'air content. Et puis un matin, je prends un livre sans
raison... y lis les mots «A bord du Blossom » puis l'histoire de ce
capitaine qui passe le Cap Horn vers l'archipel des Pomotou. Et là, je
suis parti sur cet hommage aux navigateurs du XIXème, excité comme
jamais : j'ai écrit la narration, cherché les nouvelles illustrations,
inventé l'indigène Amaïti Amaïta, trouvé des choristes caribéennes...
Trois semaines plus tard, c'était fini. Je n'ai jamais dépassé les
(beaux) budgets que j'avais.
-L'époque actuelle ne vous intéresse-t-elle pas ?
-Je
suis nostalgique de la fraîcheur des années 1980 où on pouvait aller
partout, où la naïveté existait encore, où Abba faisait danser tout le
monde, où Kim Wilde, où Laura Branigan... Aujourd'hui, tout est
boursouflé, du rap à Beyonce. Elle n'est pas responsable, c'est le
monde qui a changé. L'abjection de la communication qui couvre la
planète, avec la vérité qui vaut son contraire. On a tué l'imaginaire,
remplacé par des connaissances factuelles et imbéciles. On nous vend du
fond, mais on s'en fout : depuis Néfertiti, c'est le même. L'important
est comment on nous emmène. Je ne peux pas lire de littérature
contemporaine : en 300 pages, il y a une page et demie au niveau de
Théophile Gautier. La photo omniprésente a détruit l’œil, la 3D
grotesque a détruit le rêve.
-Et la chanson ?
-Plutôt
les Stones et Lennon. Jamais été fan de Brel ou Ferré : j'admire les
personnages, mais ils sont passés à côté de la polymorphie artistique,
cadenassés dans un format au demeurant très beau.
-Sur scène, où vous n'êtes jamais allé, vous pourriez retrouver un peu de cette vérité, non ?
-C'est
délicat. L'histoire du mec qui prend jamais le train, qui les voit
passer... Je serais comme un prêtre faisant un sermon devant des gens
au téléphone, qui jouent aux jeux vidéo, au bridge, aux boules.
L'attention n'est plus.
L’âge d’or du capitaine
Persister
à faire un album, croire encore à ce voyage en 15 morceaux. Ici, un
capitaine de vaisseau rêvant d'un éden dans un 19e siècle fantasmé par
un Manset conteur chanteur de disque roman. Radicalité esthétique que
d'aucuns diront désuète ou prétentieuse. On y sentira ce souffle
unique, la voix hypnotique, ce récit unique, aussi étrange que
saisissant. Serti de perles comme « Une Chambre à La Havane » ou «
Manila bay». Hors du temps donc fascinant.
LES CHANSONS CULTES DE GÉRARD MANSET
KIM WILDE, « CAMBODIA »
«Eh oui. Le texte est sublimissime, le phrasé incroyable et puis Kim Wilde, petite campeuse magnifique de ces années 1980. »
EAGLES, « HOTEL CALIFORNIA »
«
Entendu, réentendu oui... et puis vous faites attention au texte et
réalisez qu'il est absolument étonnant. Des raccourcis, des inversions.
Du cinémascope. On comprend alors pourquoi les Américains ont couvert
la planète de leur univers. »
MADONNA, « FROZEN »
« La fin des années magnifiques, avant le chaos. Le clip est somptueux.»
JOHN LENNON, «INSTANT KARMA»
« Beau à pleurer »
CHARLES TRÉNET, «LE JARDIN EXTRAORDINAIRE»
« La poésie, l'imaginaire. Et lui sautillant, les yeux écarquillés. C'est Pagnol. Une autre époque nirvana. »
*****************************************************************************************************************************
Gérard Manset reprend le large "A bord du Blossom" pour un voyage musical et nostalgique.
Par Franck Vergeade pour Les Inrocks (21 Septembre 2018)
Septuagénaire, le musicien maintient son cap et nous entraîne à la découverte de "mondes lointains".
En
vieux routard de la chanson française, Manset nous embarque
A bord du Blossom. Avant de nous dérouter, dès la
deuxième plage, sur un single en trompe-l'œil, au propos désabusé: mais
au rythme entrainant et aux arrangements cuivrés- On nous
ment- vrai tube potentiel. Quatre minutes immédiates parmi
soixante-huit effilochées, tantôt contemplatives (Une chambre à La
Havane, La vierge pleure), tantôt verbeuses (Pourquoi les femmes et son
texte polémique), entrecoupées d’interludes parlés (La Falaise, Amaïti
Amaïta, L’équipage, Le Hamac…) et même d'interventions lyr1ques (Ce
pays, Le Paradisier).
Du conte musical au carnet de voyage
Pour
son vingt-deuxième album, successeur de l'oublié «
Opération Aphrodite » (2016), l'ermite chantant signe encore un disque
conceptuel, inspiré par les "mondes lointains", les "océans à peine
cartographiés "et les "capitaines emblématiques".
Mansetlandia
(2016), son coffret rétrospectif amputé du cultissime premier album.
"Même avant de voyager j'ai toujours voyagé"; avoue-t-il lui-même
dans sa récente autobiographie « Cupidon de la nuit »
(2018).
Ambition monomaniaque
Orchestrateur en chef de
son propre répertoire, Gérard Manset n'a jamais dérogé aux écarts
instrumentaux (Mon Karma et surtout Manila Bay) qui résonnent
comme des anomalies, finalement admirables
d'entêtement. Dans ce "cabotage en solitaire", déjà décrit par
Libération à la sortie de Jadis et naguère (1998), le chanteur
septuagénaire tient son cap contre vents et marées, entre conte musical
et carnet de voyage.
Avec un sens descriptif déjà
rodé et ses arrangements désuets, Manset s'entoure d'un casting
pléthorique (pas moins d'une vingtaine de musiciens jouent
sur le disque) pour assouvir son ambition monomaniaque. Dans une
époque qui nous vante un soit- disant "nouveau monde", Manset
incarne avec constance et acharnement l"'ancien monde".
###################################################################################################
Inventeur
de l'autarcie pop car chanteur, compositeur, auteur, musicien,
orchestrateur, producteur, éditeur et mixeur de ses propres œuvres,
Gérard Manset tient les médias en peu de considération et n'a
jamais donné de concert.
C'est à ce prix qu'il
incarne le mythe absolu de la chanson hexagonale, rock et
psychédélique, empreinte de spiritualité. Né en 1945, fils de
bonne famille élevé à Saint-Cloud, recalé au bac (pour une note
éliminatoire en français), puis étudiant aux Arts déco, il
bifurque vers la musique en autodidacte, collabore avec William
Sheller et ... Dalida, et conquiert son autonomie en 1968
avec l'édition d'Animal on est mal (d'une inspiration proche de
La Métamorphose de Kafka). La chanson est à la fois victime
du mois de mai (les gens n'ont plus la tête à acheter des
disques), mais simultanément rescapée de l'époque (les
programmateurs de radio sont bien contents de mettre la main sur
ces sons étranges). En 1970, La Mort d'Orion, faux péplum d'heroic
fantasy mais authentique descriptif d'un univers de désolation et
concept album à la française, consacre le chanteur comme
l'empereur d'un style amphigourique, qui convient parfaitement à ce que
l'on identifiera plus tard comme un oratorio rock et initiatique, porté
par les voix d'Anne Vanderlove et du récitant Giani Esposito.
Mais
c'est en 1975, alors que Manset se pelotonne dans le
douillet statut de culte vivant, que la réalité du commerce le
rattrape avec le phénoménal succès d'Il voyage en, solitaire (et,
en mode mineur, de Y’a une route). 300 000
exemplaires vendus plus tard, et une concession ténue à la
télévision (en 1981, il accepte de se produire en play-back
pour le compte des Enfants du rock), il peut se consacrer aux
voyages, toutefois sensible aux hommages (une compilation rassemble en
1996 Françoise Hardy ou Alain Bashung). Et vingt-deux albums plus tard,
particulièrement vigilant à sa propre postérité, via la réédition
de ses disques sous son complet contrôle, ce faux ermite, également
photographe (passionné par l'Asie en général et la Thaïlande en
particulier), graveur, dessinateur et écrivain, a collaboré avec René
Joly (l'OVNI Chimène), Florent Pagny, Raphaël, Julien Clerc ou Bashung.
Christian Larrède (Les Inrocks)
*****************************************************************************************************************************
S’il
n'était pas de Manset, cet album n'aurait aucune chance de sortir
aujourd'hui chez une major... Notre homme a acquis de haute et longue
lutte, une sorte de passe-droit lui permettant de faire ce qu'il veut,
quand il veut, comme il veut. Et d'obtenir, en retour, un respect sans
égal. Ce n'est que justice : ceux qui ont connu nos tristes seventies
se souviennent que, vers 1975, le rock français c'était Ange, Little
Bob Story ou Manset. Entendre ses longs tigres majestueux, tard le soir
à la radio, pouvait changer une vie. Seul contre tous, il se hissait au
niveau de groupes anglo-saxons comme Pink Floyd, les préférés d'alors,
Quarante ans plus tard, tout a changé, Tout te monde révère Manset Mais
personne n'a plus besoin de lui. Pourtant, il continue à enregistrer
des disques étranges, qui sonnent toujours pareil, sur lesquels il
évoque encore et toujours d'obscures histoires du bout du monde
remplies de références incompréhensibles — de la petite bière à côté de
son dernier roman, « Cupidon De La Nuit ». A l'instar de son seul vrai
maître, Léo Ferre, Manset n'a peur de rien, surtout pas du ridicule.
Qui d'autre pourrait nous infliger cette histoire d'explorateurs des
mers du 19ème siècle, ces passages parlés ou chantés par des nymphettes
à l'insupportable phrasé R&B, ces sons de guitares ou de cordes
ultra cheap ?
Manset est anachronique, intemporel ou largué, au
choix. En marge. Il trace invariablement le même sillon. Comme un
Modiano de la chanson. Et son public suit. Par contre, cet album n'a
aucune chance de charmer les néophytes, à qui l'on conseillera
vivement, pour comprendre le génie de Manset, de se pencher sur son
chef-d’œuvre de 1978, l'indépassable "2870".
Stan CUESTA pour Rock'n'Folk n°614 (Octobre 2018)
******************************************************************************************************************************
Le
voyageur ne ralentit pas sa course. A coup d'un album par an (sans
compter Mémoires et compil), au titre codé. Après Hergé (« Manitoba »)
et Pierre Louÿs (« Aphrodite »), Robert Louis Stevenson ? Île au
trésor, lointains océaniens, naufrageurs, exquises Marquises ? On est
en terre connue de Manset : gentilshommes de fortune, capitaines
courageux, volcans éteints, hamac, chambre avec vue, archipel des
Perles, jeunes fines en fleurs, paradis évanouis. Le poète a retrouvé
le goût du rock (cocktail Lennon/Young/Seger). Longues plages ou
histoires courtes, vagabonde reggae ou grondent guitares, embarquez
dans le rêve.
FRANÇOIS ARMANET pour le Nouvel Obs ( 20/09/2018)
******************************************************************************************************************************
Jean
noir, chemise noire et lunettes noires - sans oublier une guitare :
telle est la panoplie de Gérard Manset, voyageur solitaire qui promène
depuis des années son désespoir jusqu'aux bouts du monde.
LES PARADIS PERDUS DE GÉRARD MANSET
L'auteur
de « Lumières » fait paraître son 22e album. Il y est question d'un
long voyage dans l'archipel polynésien et d'un pays qui n'existe
peut-être pas.
Il n'a jamais composé avec le star-système et
encore moins avec le show-business. Exemple parmi d'autres de son
intransigeance : il a toujours refusé de passer à la télévision, de
jouer en public et, en règle générale, de se faire prendre en photo.
Que l'on y ajoute un album (sic), Caesar, chanté en latin, et c'est
ainsi que naissent les légendes — et Gérard Manset en est une. De jour
comme de nuit, il porte des lunettes noires pour ne pas être reconnu.
Il a choisi de traverser l'existence incognito — de préférence en
seconde classe, comme les anonymes, car il croit sincèrement que la
célébrité fait mal à l'homme. L'auteur d'Il voyage en solitaire est
allé jusqu'à faire disparaître de sa discographie quelques titres qu'il
jugeait indignes de son niveau. C'est dire l'exigence artistique de cet
homme opposé aux compromissions, auteur d'une œuvre poétique et
photographique qui cornplète ses créations musicales. Dernier détail —
qui n'en est pas un : Manset écrit toutes les paroles et mélodies de
ses chansons, dans lesquelles il joue de chaque instrument (re-sic), et
s'enferme seul durant des semaines dans un studio pour y enregistrer
quelques instants de pureté qui ne vous quittent plus une fois
entendus. Son nouvel album, intitulé A bord du Blossom, narre la
découverte des populations de Polynésie par un équipage anglais au
début du XIXe siècle. Il y est question, avec beaucoup d'émotion, d'un
amour impossible, et néanmoins réel, entre le capitaine du vaisseau et
une jeune Tahitienne nommée Amaïti Amaïta. Comme souvent, Manset chante
à la fois un nouveau monde et le paradis perdu. « La vérité, dit-il,
c'est que je suis habité par Ronsard et Rimbaud. » Ce soir-là, il avait
une édition du Cousin Pons dans la poche...
Jean-René Van der Plaetsen pour le Figaro Magazine (19 octobre 2018)
**************************************************************************************************************************
Planète Manset
par Philippe Cornet De Le Vif/L'Express (08/11/18)
A
bord du Blossom, le septuagénaire explorateur vogue vers les paradis
perdus. Racontant d'exotiques plaisirs disparus, ponctués d'une paire
de chansons aux thèmes contemporains. Un ovni qui fait du bien.
On
ferme les yeux et le voilier grand format sillonne déjà les eaux
turquoise et lointaines de destinations aux noms d'évanescences
parfumées : Alao, le portail des Samoa américaines ou encore ce
confetti de mer des Balabac séparant les Philippines de la Malaisie.
Les mots - santal, anachorète ou madrépore - semblent, eux aussi,
chercher les confins de la langue française, et même si Manset n'est
pas le premier à citer les goémons en chanson, - Ferré et Gainsbourg
l'ont précédé -, sa boussole reste ici aussi personnelle que
magnétique. Déconcertante dans une époque codifiant le voyage comme la
sédentarité, de tropismes obligés. A bord du Blossom est d'abord un
récit musical conçu comme pourrait l'être une rêverie audio éveillée,
un inédit des Histoires de l'oncle Manset. Où les images pour garnir la
pochette, sont des illustrations anciennes, en partie contemporaines de
Frederick William Beechey (1796 - 1856), navigateur et géographe
anglais, inspirateur d'un voyage réel ici ré-imaginé par Manset. La
voix de celui-ci, plus grave dans les passages récitatifs calés entre
les parties chantées, se charge d'une émotion supplémentaire. Friable
patine au lustre émotionnel, la voilà soutenue par des vagues de cordes
allant et venant selon le ressac narratif.
Les sons ambiants d'une
plage ou d'une jungle ramènent sans cesse à la notion de film invisible
livré à l'imaginaire de l'auditeur. Une gangue enveloppante et cette
vision insulaire parfois grandiloquente qui dope les créations de
Manset depuis maintenant un demi-siècle : on pense bien sûr à La Mort
d'Orion, son second disque qui, en 1970, consacre l'intégralité d'une
face à un oratorio sympho-rock, l'un des tout premiers concepts-albums
européens. Mais ici, la dérive mène aux merveilles du Pacifique : les
rencontres y semblent plus tactiles et naviguent entre sensations
ethnologiques (Sa tribu primitive) et séduction des corps (Une chambre
à La Havane).Voilà, dans Le Hamac, comment Manset raconte le désir : "
Je me balançais doucement en estimant le sol du bout des doigts quand
j'ai senti une chose qui s'allongeait délicatement à mes côtés. J'ai dû
me tourner, c'était une jeune épaule, olivâtre, molle comme un fruit,
qui paraissait appartenir à un être de ma taille. [...] Une fille
d'amande aux yeux si sombres et j'ai compris que l'un pour l'autre,
nous étions identiques, similaires, frères et sœurs en bivalves dans ce
rivage très spécifique, l'ambiguïté des genres... ".
Temple suprême
Il
y a quelques années, de passage en radio à la RTBF, Gérard Manset
refusa tout de go d'être filmé par les mini-caméras de studio. Pas
seulement parce que la technologie avait alors la pauvre allure d'une
texture VHS mais pour des raisons plus ontologiques : le chanteur et
auteur-compositeur - né le 21 août 1945 à Saint-Cloud - s'est toujours
montré avare de sa propre image. Croyant qu'une rareté médiatique ou
tout au moins visuelle protège aussi de la dispersion exagérée de
l'âme. Ainsi, hormis quelques photos promotionnelles de l'artiste, il
n'existe - sauf erreur - que trois moments de télévision où il daigne
apparaître : deux versions clippées d'Il voyage en solitaire, morceau
qui dope sa popularité en 1975, et cette vidéo très sixties d'Animal on
est mal, son tout premier 45-tours, paru en mai 1968. Dans le chaos
ambiant qui ne servira pas les ventes de la chanson, d'un dandysme
plutôt étanche à la variété française d'époque. Fils de famille
bourgeoise - père ingénieur en aviation, mère violoniste - l'élève
Manset s'était d'ailleurs déjà singularisé en ratant le bac,
principalement pour insuffisance en langue française. La musique arrive
dans la foulée d'un diplôme aux Arts décoratifs de Paris et devient
vecteur de revanche pour celui qui ne va plus cesser de voyager, aussi
en dehors des sillons de la musique.
En cinquante années d'un
parcours exigeant qui choisit son public, Manset va donc réaliser une
vingtaine d'albums - dont Matrice en 1989, disque d'or - mais également
quinze romans et carnets de voyage où l'Amérique latine et l'Asie
prennent de la place. Dans un style qui tient à la fois de la poésie,
du reportage in situ et du commentaire anthropologique, les photos noir
et blanc complétant régulièrement l'offre des mots. Ainsi dans 72
heures à Angkor (Les Belles Lettres,2000), Manset raconte ses trois
journées du mois d'août 1998 passées à explorer le fabuleux site
incrusté dans la profonde forêt cambodgienne. Une façon de déambuler en
transgressant le temps, à la recherche du temple suprême : " Tout sauf
découvrir en bagnole. Tout sauf n'avoir qu'une seule portion de
l'espace si large, si haut, si calmé à la fraîche. Forest domestiquée
et sage, en partie intacte. Le colossal mammouth va apparaître. Il sera
dans son écrin de verdure, entouré de ses bassins, l'immense parure
d'eau mort dans sa majesté millénaire. [...] J'ai vu la bête, le site,
l'indescriptible décor. Mille et une nuits à la manière d'Angkor. "
Goûts de jeunesse
A
bord du Blossom n'est pas qu'une dérive poétique vers l'infiniment
tropical. Manset y retrouve aussi ses goûts de jeunesse incarnés dans
une poignée de titres davantage au format chanson-rock. Avec des
cuivres quasi rhythm'n'blues qui rejoignent ces guitares électriques
qu'il a toujours aimées (Manila Bay), les chauffant même à blanc dans
Pourquoi les femmes. Ces neuf minutes quarante-deux secondes d'un blues
indolent posent la question des rapports des sexes, Manset y regrettant
visiblement une forme d'amour courtois : " Nous pouvions à
l'époque/Croiser des ingénues/Dont les cheveux au vent/Et dont les
genoux nus/Riaient de ces désordres/De ces jeux, de ces lèvres qu'il
fallait mordre ". Texte moins macho que venant d'un autre temps où il
n'était pas encore question de #BalanceTonPorc. Manset étant d'ailleurs
le père de deux filles adultes, l'une d'entre elles, Caroline manageant
depuis plusieurs années le chanteur Raphaël. Même si l'époque actuelle
ne peut pas vraiment satisfaire la légère misanthropie du chanteur,
exprimée dans le second morceau de l'album, le très pop On nous ment :"
La vie c'est comme ça, on nous ment toujours/On nous ment tout, on nous
ment tout/On nous Mantega, on nous Mante Christo. " Manset en a imaginé
le clip - en jolie animation - comme il a conçu ce Blossom de près de
septante minutes, bien évidemment écrit et composé par lui, mais aussi
orchestré et mixé par celui qui demeure un éternel corsaire de la
chanson.
****************************************************************************************************************************
Gérard Manset : « Je n'ai pas quitté l'enfance... »
Recueilli par Michel TROADEC pour Ouest-France (6 octobre 2018)
Depuis
un demi-siècle, il voyage en solitaire ... Gérard Manset accorde peu
d'interviews. Mais quand il parle, c'est dense, difficile à
retranscrire. Cela éclaire une œuvre d'une grande richesse où la
recherche d'un paradis perdu est centrale.
-Votre nouvel album, À bord du Blossom est un hommage aux navigateurs du XIXe siècle. Comment est née cette idée ?
-Après
Aphrodite, mon précédent album, je ne voulais pas partir sur un nouveau
concept. Ma maison de disques m'a interrogé... Dans la nuit, ça a dû me
travailler. L'intrus m'a visité et un mot m'est venu en tête : Blossom.
Je ne savais pas trop à quoi ça correspondait. J'ai cherché : un bateau
commandé par le capitaine Frederick Je-ne-sais-quoi, qui a franchi le
cap Horn, vers les Pomotou (Polynésie), en 1825. C'était parti. Dans la
matinée, j'ai écrit un texte (qui sert de fil conducteur à l'album).
-Vous êtes-vous demandé d'où venait cette inspiration ?
-J’ai un fonds personnel autour des navigateurs du XIXe siècle, Les révoltés du Bounty, Lord Jim...
« Épouvantables » réseaux sociaux
-En
un an, vous avez publié un livre de photos, une autobiographie (Cupidon
de la nuit) et cet album. Vous n'avez jamais été aussi
prolifique...
-« Je ne me suis jamais arrêté quelque part pour poser mon sac. Une fois découverts, défraîchis, je me lasse des paradis. »
Le
point de départ de ce triptyque, c'est le livre de photos pour lequel
j'ai pioché dans mes voyages, tapant dans le Brésil, le Nicaragua, le
Pacifique. Ces lieux, je les connais et je défends l'idée que le petit
bonheur de la fin du XXe siècle que j'ai connu, il était identique
partout, qu'on soit à Lomé ou aux Samoa. Ces visages, ces sourires, ces
regards étaient les mêmes, le monde était charmant. Ça, j'ai beaucoup
de mal à le faire avaler aujourd'hui.
-Le monde n'est plus charmant que dans des lieux exotiques ?
-Malheureusement,
oui. En France, aujourd'hui, je suis très rarement touché par des lieux
un peu épargnés, des gens qu'on voit traverser une rue, des petites
écoles. Les enfants ne sont plus les mêmes, les adultes non plus. Il y
a la télé, les informations. La dernière marche, c'est le net, les
réseaux sociaux, mais on ne va pas ouvrir ce chapitre épouvantable.
-Ce que vous définissez joliment comme le petit bonheur, il a donc existé en France ?
-Quand
j'avais dix ans. La poésie, l'onirisme, cette sorte d'infantilisme, ces
choses belles et succinctes qui sont dans mes albums, cela me vient
d'où ? Je ne fais que transporter le bagage du gamin qui allait avec sa
grand-mère trois fois par semaine au marché, avec l'église, la place,
la mairie, deux-trois petites rues et La Marne. J'ai voulu partout
revoir ces très jolies choses. Et je les ai vues.
-Le nœud de votre œuvre, finalement, c'est l'émerveillement de la découverte ?
-Oui,
c'est ça, le mot : « Émerveillement ». La claque que j'ai prise quand
j'ai débarqué à Bangkok en 1978 ! Et après, à Manille. Comme si on
m'avait ouvert une porte en me disant que tout ce qu'on m'avait raconté
entre dix ans et la trentaine, c'était du flan.
-Cet émerveillement retrouvé, vous n'avez ensuite cessé de le chercher et de le raconter...
-Évidemment.
Et aujourd'hui, je procède par amalgame de couches, en additionnant des
choses qui n'ont pas de rapport entre elles, ça embellit, ça amplifie.
Une forme de poésie qui est celle des gouaches découpées de Matisse. On
prend du bleu, du vert. des lapins, des oiseaux... Et puis on met ça
l'un à côté de l'autre. On en revient à l'élémentaire des coloriages.
Ça résout aussi la question de ceux que ça agace de me voir
égocentrique. C'est le principe du petit garçon qui a fait son château
sur la plage avec deux coquillages, des algues, un bout de bâton. Il
est fier. J'en suis là. Je n'ai pas dépassé ça. Je n'ai pas quitté
l'enfance.
-Dans votre nouvel album, La Vierge pleure (titre d'une chanson) parce que la terre se meurt ?
-On
peut tout imaginer. Oui, elle pleure devant la terre abîmée, mais plus
généralement à cause de la violence, des guerres fratricides...
L'humanité est dans une sorte d'histoire d'amour qui a mal tourné.
« Tout est dans Paul et Virginie »
-L'amour est au cœur de cet album, c'est aujourd'hui l'unique refuge sur Terre ?
-Peut-être
pas le seul, mais le premier par lequel les autres sont accessibles. La
femme, l'amour c'est un bien grand mot, mais disons les approches
amoureuses sont une sorte de langage qui permet aux hommes de profiter
de tout un tas de choses. Dans A bord du Blossom apparaît immédiatement
une femme, Amaïti Amaïta. Il fallait bien qu'il y ait une héroïne qui
résume toutes les héroïnes.
-L'une de vos chansons avance que les femmes sont devenues méchantes...
-Je
pensais qu'on allait m'interpeller là-dessus, mais non. Les femmes,
soit elles désertent, soit elles abdiquent, soit elles deviennent
méchantes. Pourquoi ? Il faut lire Paul et Virginie (roman de Bernardin
de Saint-Pierre, 1788). Toutes les réponses y sont.
-À 73 ans, vous continuez de voyager ?
-Ces
dernières années, j’ai beaucoup produit. Mais, oui, je vais peut-être
aller au pied levé revisiter des endroits que j'aime encore. Je pense
au Brésil. à Salvador de Bahia, quand même un des plus beaux endroits
au monde, un monde en soi. Même si le Salvador des années 1980 a
changé. Il y avait le Pelourinho, quartier du centre, sorte de
coupe-gorge à la Londres de Dickens. Maintenant tout est propre,
retapé, lustré, poli. Bien sûr, il vaut mieux que les gens vivent dans
des trucs beaux, mais bon... Allez, je suis encore parti...
**********************************************************************************************************************************
Gérard Manset a-t-il largué les amarres?
Par Pascale Tournier, publié le 26/10/2018 pour L’Express
Le chanteur-poète, toujours à contre-courant.
Dans A bord du Blossom, l'artiste inclassable livre des chansons envoûtantes, mais gâchées par une mentalité néo-réac.
Dès
les premières secondes, le décor est planté. "Ce capitaine voulait un
océan à lui, un présent de la nature, qu'il espérait comme une prière
", chante une choriste. Inclassable, fuyant les médias et la scène,
Gérard Manset part à nouveau explorer ses obsessions. Cette fois, elles
prennent les traits d'un capitaine qui cherche son jardin d'Eden, un
paradis perdu peuplé de jeunes filles à fleurs, où la modernité n'a pas
encore terni les paysages verdoyants.
A 73 ans,
l'auteur-compositeur-interprète d'Animal on est mal continue de creuser
son sillon d'artiste en marge. A rebours des codes imposés par le
streaming, le poète délivre un album concept à l'ancienne, dans lequel
alternent des récits soutenus par quelques cordes et des chansons
envoûtantes mêlant calypso, rock symphonique, psalmodies enfiévrées et
des mots oubliés comme " ménure-lyre " ou " paradisier ".
Indéniablement,
on se laisse captiver par la sensualité ambiante qui rappelle les
tableaux du Douanier Rousseau ou le roman de Michel Tournier Vendredi
ou les limbes du Pacifique. Mais quand il n'est pas incompréhensible -
cela lui arrive, chose habituelle chez lui -, le propos est totalement
néo-réac. Manset est nostalgique d'un monde qui n'est plus, se montre
critique envers le progrès et flirte même avec les idées complotistes
(On nous ment). Dans Pourquoi les femmes, il chante : "Pourquoi les
femmes sont méchantes et les hommes se sont tus ? " Un point de vue à
contre-courant de #MeToo, dont il aurait pu se passer. De quoi gâcher
cet appel du large au charme insolite.
**************************************************************************************************************************